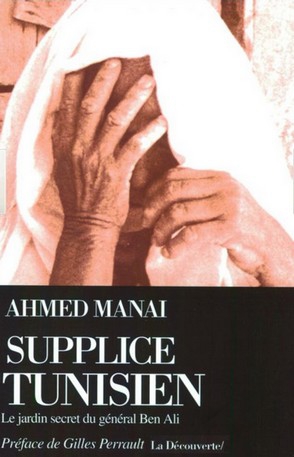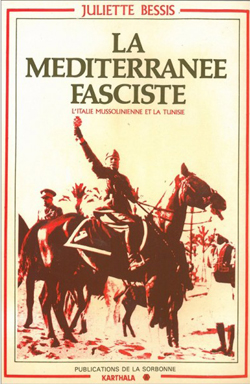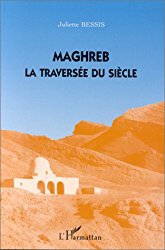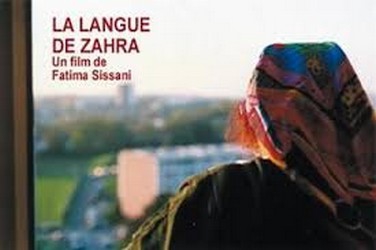L’anniversaire de la mort du sociologue de l’immigration Abdelmalek Sayad, décédé le 13 mars 1998, est l’occasion de republier un article que lui a consacré Saïd Bouamama, paru dans le n° 16 de Contretemps (première série) en mai 2006.
La question dite de « l’héritage colonial » est désormais posée.
Des polémiques surgissent périodiquement pour stigmatiser ou caricaturer les partisans d’une prise en compte du « fait colonial » comme un des éléments importants structurant, encore aujourd’hui, les rapports de domination subis par les immigrés issus des anciennes colonies et par leurs enfants français. Les accusations pleuvent pêle-mêle : repli communautariste, démarche racialiste et/ou raciste, approximations historiques, analogies excessives, divisions des dominés, production d’une autonomie de repli suicidaire. Abdelmalek Sayad fut précurseur sur cette question. Le fait que son œuvre soit méconnue n’est pas une réalité anodine : dans le domaine scientifique, comme dans le domaine politique, agissent des facteurs qui bloquent la prise en compte de la réalité sociale de l’immigration et de ses enfants français. Pierre Bourdieu caractérisait Abdelmalek Sayad comme « un analyste de l’inconscient ». Effectivement, en débusquant les implicites, Sayad ne pouvait que rencontrer le « fait colonial » comme un des éléments clef de l’inconscient collectif français.
Une immigration exemplaire issue d’une colonisation exemplaire
La vigueur de la polémique qu’a suscitée la publication de l’Appel des indigènes de la République est un révélateur de la difficulté à prendre en compte la spécificité de l’immigration issue des anciennes colonies. Une des critiques les plus récurrentes a ainsi été de rappeler les difficultés vécues par les immigrations non coloniales antérieures ou présentes. Pour ce faire, la comparaison a été fréquemment réalisée avec des pays n’ayant pas eu d’empire colonial et dans lesquels les populations issues de l’immigration rencontrent des difficultés « similaires » à celles rencontrées en France par les descendants des anciens colonisés. Un des apports essentiels d’Abdelmalek Sayad est justement de refuser la scission binaire entre deux problématisations tout aussi réductrices : celle consistant à nier les invariances à toutes les immigrations ; celle consistant à nier les dimensions particulières de l’immigration issue des anciennes colonies. En soulignant le caractère « exemplaire » de l’immigration algérienne, il souligne son caractère « d’idéal-type » de l’immigration en tant que rapport de domination. L’immigration algérienne réunit, en les poussant à l’extrême, les traits et les processus en œuvre pour toute immigration à des degrés moindres et moins exacerbés. L’idée clef de Sayad sur cette question est de relier « l’exemplarité » de l’immigration algérienne à « l’exemplarité » de la colonisation de l’Algérie :
« colonisation totale, systématique, intensive, colonisation de peuplement, colonisation des biens et des richesses, du sol et sous-sol, colonisation des hommes (corps et âmes), surtout colonisation précoce ne pouvant qu’entraîner des effets majeurs ».
C’est donc parce qu’en Algérie l’idée coloniale a été poussée le plus loin dans ses dimensions de « peuplement », de « dépossession de la paysannerie », de « violence de la conquête », qu’elle constitue en quelque sorte un « laboratoire » des autres immigrations. Dans les deux cas, nous avons affaire à des rapports de domination et d’exploitation. Mais, pour l’immigration postcoloniale, l’activation d’un « imaginaire colonial » lui fait jouer une fonction de « miroir grossissant » ou de « révélateur » des processus en œuvre. La sous-estimation de ces « spécificités » essentielles conduit à une cécité de l’analyse.
La prolongation en métropole de « l’imaginaire » et du « rapport » colonial
L’analyse des implicites présidant au fonctionnement des foyers pour travailleurs migrants permet à Sayad de souligner l’importation en métropole de « l’imaginaire colonial ». Que ce soit dans les personnels recrutés lors de la mise en place de ces foyers, dans les conceptions architecturales, dans la définition des droits et devoirs du résident, dans les représentations sociales des besoins des locataires, l’analogie avec la colonisation est permanente. Voici par exemple comment il analyse l’absence d’intimité qui caractérise ces foyers :
« Ainsi la perception naïve et très ethnocentrique qu’on a des immigrés comme étant tous semblables, se trouve au principe de cette communauté illusoire. Il s’y ajoute, dans le cas des immigrés algériens et plus largement marocains et tunisiens, la représentation de la “nature” psychologique de l’Arabe, telle qu’elle est vulgarisée par les “spécialistes” de la “mentalité primitive”, de “l’âme et de la psychologie nord-africaine, musulmane” (…). “Nature” grégaire, qui ne peut être satisfaite que par la vie en groupe, nature “patriarcale”, “tribale”, etc.»[1].
Nous retrouvons dans cette représentation sociale de la « nature de l’Arabe » ou du « musulman » ce qui fait le cœur de la domination coloniale : la légitimation d’un traitement d’exception par une « nature » ou une « culture » censées produire des besoins spécifiques. L’inégalité est à la fois reconnue et présentée comme nécessaire et légitime. Dans le regard du colonisateur, les inégalités produites par le système colonial ne sont pas niées mais leur genèse est refoulée, recouverte par une explication biologique ou culturelle : le manque d’ardeur au travail du colonisé n’est pas expliqué par le rapport social colonial qui impose au colonisé des conditions de travail éreintantes tout en le privant de toute initiative et de toute jouissance du fruit de son travail, mais par l’indolence congénitale de « l’Africain » ou par l’incorrigible indiscipline du Maghrébin[2]. Cette reproduction de l’imaginaire colonial conduit ainsi inévitablement à l’idée d’une « mission éducative » des foyers, étrangement ressemblante avec la « mission civilisatrice » de triste renom. Sayad met en évidence les fonctions de cette « mission éducative » en les mettant en analogie avec celles de la « mission civilisatrice » : justifier un traitement d’exception tout en valorisant l’image du dominant. La « mission civilisatrice » se caractérise en effet par une double fonction : légitimer l’inégalité présente tout en valorisant l’image du colonisateur. Le rapport colonial inverse donc l’ensemble de la relation. Il présente les dominants comme des « altruistes » soucieux de faire « évoluer » les colonisés et de développer les « lumières » et met en scène les dominés comme étant les véritables bénéficiaires de la colonisation. La société d’immigration
« n’a que trop tendance, écrit encore Sayad, à porter à son bénéfice ce qui, pourtant, est l’œuvre des immigrés eux-mêmes : aussi est-ce fréquemment qu’on présente au moins les aspects les plus positifs (ou considérés comme tels) de l’expérience des immigrés, c’est-à-dire, en gros, l’ensemble des acquisitions qu’ils ont su imposer au gré de leur immigration (…) comme le résultat d’un travail diffus ou systématique d’inculcation, d’éducation qui s’opère à la faveur de l’immigration (travail qui consiste à produire ce qu’on appelle les “évolués” et du même coup, à discriminer ces immigrés “évoluables”, “éducables”, “amendables” des immigrés qui ne le sont pas ou ne veulent pas l’être) et dont le mérite revient à la société d’accueil et à elle seule »[3].
Il suffit d’entendre aujourd’hui certains propos ministériels sur la récente révolte sociale des jeunes des quartiers populaires (polygamie, démission des parents, réseaux intégristes), de lire le rapport Bennisti et son analyse de la délinquance comme issue des « patois » parlés au sein de la famille, d’analyser les débats justifiant la loi du 23 février 2005, pour saisir l’actualité politique d’Abdelmalek Sayad. Nous ne sommes pas en présence de survivances anodines et marginales du passé que le temps fera disparaître par épuisement. Nous avons à faire à un rapport social qui se reproduit, caractérisé par une « ethnicisation » du dominé, une teneur « éducative » ou « civilisatrice » du rapport avec lui, une négation des violences sociales qu’il subit.
Les jeunes issus de la colonisation
Sayad s’attache également à déconstruire les discours sur les enfants de l’immigration devenus Français. L’expression « jeunes issus de l’immigration » participe de la reproduction du rapport colonial mais cette fois-ci à l’endroit de « Français ». Nés et socialisés en France, dotés de la nationalité française, ils restent perçus comme des « immigrés » et construits comme tels. Pour eux aussi se met en place un rapport « éducatif » ou « civilisateur », les injonctions « d’invisibilité » et de « politesse » sont émises officiellement, les « visibilités » sont jugées ostentatoires et nécessitant des interventions étatiques fermes. Pour eux, la distinction permanente est faite entre la figure du héros positif (l’intégré) et le héros négatif (la racaille).
C’est en déconstruisant de manière remarquable le concept « d’intégration » et les discours qu’il structure, que Sayad met en évidence la reproduction, par delà les générations, du rapport colonial.
« Une des premières manifestations du changement qui s’opère de la sorte, écrit-il, se traduit à travers le langage, surabondant aujourd’hui, de l’intégration : l’intégration est ici non seulement celle de personnes “extérieures” à la société française (…) mais celle du phénomène lui-même, l’immigration étant “rapatriée”, “internalisée” pour ne pas dire “intériorisée”, perdant de la sorte une bonne partie de la représentation qu’on en avait comme pure extériorité »[4].
Nous avons à faire à une réalité sociale spécifique : la production d’immigrés qui n’ont immigré de nulle part. C’est au travers du prisme de la reproduction du rapport colonial que Sayad analyse les nombreuses caractéristiques du discours tenu sur et à ces français construits socialement comme « exceptionnels ». Le processus idéologique d’inversion de la relation par ethnicisation du colonisé (puis de l’immigré et de ses enfants français) et par imposition d’une « grille éducative de lecture » se réalise à partir du paradigme « intégrationniste ». Ce dernier réalise le tour de force d’imputer la responsabilité des inégalités à ceux qui les subissent :
« L’invite à l’intégration, la surabondance du discours sur l’intégration ne manquent pas d’apparaître aux yeux des plus avertis ou des plus lucides quant à leur position au sein de la société en tous les domaines de l’existence, comme un reproche pour manque d’intégration, déficit d’intégration, voire comme une sanction ou un parti pris sur une intégration “impossible”, jamais totalement acquise »[5].
Alors que « l’intégration » au sens sociologique du terme interroge la société dite « d’accueil », l’usage idéologique du terme (y compris à gauche et à l’extrême gauche) oriente la réflexion et l’action vers des dimensions culturalistes imputant aux premiers concernés (ou à leur culture, leur religion, leur héritage) la responsabilité de leur situation. Au-delà de la polysémie du concept d’intégration qui rend impossible le débat serein, c’est l’usage social, politique et idéologique de ce concept auquel s’intéresse Sayad. Ce faisant, il aide à penser une sociologie anti-intégrationniste qui s’attache aux processus de domination touchant ces Français construits comme « sujets à intégrer ».
L’assimilation derrière l’intégration
L’approche critique de l’intégrationnisme à la française permet à Sayad de souligner la reproduction d’un autre trait de l’imaginaire colonial : la scission binaire et permanente entre « intégrés » à valoriser et « inintégrés » à réprimer. C’est au travers de l’analyse des discours tenus sur les « beurs » que Sayad souligne la signification de ce processus : l’assimilationnisme. La volonté de distendre artificiellement la relation entre « parents immigrés » et « enfants français » qui a caractérisé la décennie 1980 apparaît alors comme une des conséquences logiques d’un « chauvinisme de l’universel », celui-là même qui avait servi à justifier « l’œuvre coloniale » :
« Aussi comprend-on l’intérêt objectif – intérêt qui s’ignore comme tel – qu’on a à distendre au maximum la relation entre, d’une part, des parents immigrés (…), et, d’autre part, les “enfants de parents immigrés” qui seraient alors, selon une représentation commode, sans passé, sans mémoire, sans histoire (…), et par là même vierges de tout, facilement modelables, acquis d’avance à toutes les entreprises assimilationnistes (…) mues par une espèce de “chauvinisme de l’universel” »[6].
Nous retrouvons, ici, à propos des « beurs », les deux formes historiques de l’idéologie coloniale. Si cette idéologie a pris une première forme explicitement raciste, elle a également eu une forme « de gauche », « bien intentionnée », c’est-à-dire s’argumentant d’une « œuvre positive » de la colonisation. Sayad souligne les formes contemporaines de ce « chauvinisme de l’universel » à travers l’analyse de « toute une série de clichés, de lieux communs » mais également à travers la déconstruction des « discours savants » : la célébration du pouvoir d’intégration de l’école française, la réussite ou l’échec scolaire des jeunes issus de la colonisation, l’islam et les signes extérieurs d’appartenance à cette « religion d’immigrés », la dénonciation de l’intégrisme musulman, les femmes issues de la colonisation.
Le « chauvinisme de l’universel », qui a jadis été à la source d’un « colonialisme bien intentionné », conduit aujourd’hui à des logiques de raisonnement lourdes de conséquences en termes de violences sociales subies par les immigrés et leurs enfants français. Il conduit selon Sayad à s’autoriser l’idée d’une « émancipation contrainte » qui correspondrait « aux vrais intérêts de la nouvelle génération », même si celle-ci n’en a pas conscience. Les implicites des débats sur la loi sur le « foulard » relèvent à l’évidence de cette logique. De la même façon, Sayad souligne la parenté entre ce « chauvinisme de l’universel » et les discours récurrents sur la « perte d’autorité » des pères, sur leur « démission », leur « infériorisation », leur « disqualification ». Enfin, la même parenté permet à Sayad de donner sens aux explications sur les hystéries régulières à l’égard des jeunes issus de la colonisation : ceux-ci sont coupables d’être ingrats, d’être trop visibles, d’être ostentatoires, de ne pas se comporter en « immigrés » ou en « colonisés » ou encore de se comporter simplement comme s’ils étaient chez eux. Nous sommes ici en présence d’une autre analogie avec la période coloniale : l’illégitimité de la présence chez soi. Se comporter comme citoyens exigeant des droits est une attitude impensable pour l’imaginaire colonial qui ne laisse place qu’au statut de sujet. Le processus de diabolisation des attitudes revendicatives en œuvre aujourd’hui à l’égard des enfants français a d’ailleurs commencé avec leurs parents immigrés algériens. Cette virulence particulière à l’égard des immigrés algériens, Sayad l’explique par la relation avec l’époque coloniale:
« C’est, sans doute, pour apurer ce contentieux colonial et ses vestiges (parmi lesquels l’immigration), qu’on s’acharne volontiers sur les jeunes (…). Si on s’attaque plus précisément à l’immigration qu’on dit “non européenne”, n’est-ce pas dans une certaine mesure, en raison du passé colonial qui a produit cette immigration et dont elle constitue une manière de survivance : colonisés comme n’ont pas été les sujets coloniaux, les immigrés algériens se comportent en France comme ne se comportent pas les autres immigrés. Ayant acquis de la société française et de ses mécanismes, malgré les handicaps qu’ils subissent, une familiarité que seul un long “commerce” peut donner (et cela avant même l’émigration), les Algériens immigrés d’aujourd’hui – hier immigrés originaires de la colonie – peuvent s’autoriser de plus grandes libertés, à commencer par la liberté de défendre leurs droits »[7].
La décolonisation des territoires n’a pas signifié la remise en cause du « chauvinisme de l’universel » qui avait permis la légitimation « bien intentionnée » de la colonisation. L’idée d’assimilation que porte ce type particulier de chauvinisme ne fait alors que se transférer des anciens colonisés vers les nouveaux immigrés puis sur leurs enfants. Ces derniers restent perçus et construits au travers des droits et devoirs (c’est-à-dire essentiellement des devoirs) du sujet : la politesse, l’invisibilité et l’apolitisme.
Les trois séries d’analogies entre immigration et colonisation
Il existe certes des invariances réunissant toutes les immigrations. Celles-ci sont en particulier issues de la fonction économique de l’immigration dans une économie de marché. Ces invariances étant posées, elles ne suffisent pas à décrire l’ensemble de ce « fait social total » que constitue chaque immigration. Elles ne nous autorisent pas à faire l’économie de la prise en compte des contextes historiques qui déterminent les modalités concrètes de l’existence sociale et politique de chaque immigration et, pour celles issues des anciennes colonies, de ses enfants français. En fonction de ces contextes historiques différents, des représentations de l’Autre qu’ils véhiculent et ancrent dans les imaginaires politiques et les inconscients collectifs, l’acuité du rapport de domination, son champ d’exercice et sa durée varieront. Marx a bien étudié cette interaction entre passé et présent, et le rôle que joue l’imaginaire social hérité[8]. C’est à travers cet imaginaire que les hommes déchiffrent leur réalité vécue, qu’ils déterminent les frontières entre un « nous » et un « eux » et fondent leur action présente. C’est, en l’occurrence, au travers de l’imaginaire colonial qu’ont été appréhendés les immigrés postcoloniaux et qu’a été légitimée leur relégation économique, sociale et politique.
La virulence des critiques à l’égard de l’Appel des indigènes de la République souligne l’existence d’une véritable difficulté à intégrer les spécificités issues de la colonisation dans l’analyse des dominations concernant l’immigration. Trois d’entre elles nous semblent significatives. La première critique faite aux « indigènes » est celle de nier les autres formes de racismes et ainsi de contribuer à une « concurrence des victimes ». Or, affirmer fortement l’existence d’une forme de racisme sous-estimée ne signifie pas nier l’existence d’autres formes de racisme. Le racisme en tant que processus de hiérarchisation sociale, économique et politique, c’est-à-dire en tant qu’outil des systèmes de domination, s’ancre dans un terreau historique. L’Appel ne dit rien d’autre que ceci : la colonisation n’est pas un aspect secondaire du terreau historique français. Ailleurs (pour des pays n’ayant pas eu d’empire colonial) ou ici, pour d’autres populations (n’ayant pas été colonisées), ce sont d’autres moments historiques et d’autres imaginaires hérités qui sont mobilisés. Si les Indigènes voient la « colonisation » à l’œuvre là où beaucoup ne veulent pas la voir, cela ne signifie pas qu’ils la voient partout. La deuxième critique importante a été la dénonciation de l’amalgame que réaliserait l’Appel entre la période coloniale et la situation actuelle. Ici aussi l’on fait dire aux indigènes de la République ce qu’ils n’ont pas dit. Mettre en analogie deux facteurs ne signifie pas qu’on les considère comme identiques. C’est tout simplement souligner qu’ils empruntent des processus, des logiques et des représentations qui sont en proximité. Parler de racisme postcolonial, ce n’est donc pas non plus prétendre que les descendants de colonisés vivent une situation identique en tous points à celle de leurs ancêtres. Le préfixe « post » utilisé par les Indigènes est à cet égard suffisamment clair : il marque à la fois un changement d’ère, une filiation et un héritage. La troisième critique récurrente à été celle « d’ethnicisation » du débat, de la situation et de la question sociale. La grille de lecture en termes de classes sociales est, dans ce cas de figure, brandie en opposition à l’Appel. Or, l’Appel des indigènes n’a jamais posé que la grille sociale de lecture était erronée et/ou dépassée. Bien au contraire : souligner le facteur postcolonial, c’est insister sur une des dimensions nodales des processus de domination, à savoir l’opposition des dominé(e)s entre eux par la gestion d’un ordre des dominations qui s’appuie sur des imaginaires hérités (celui du patriarcat pour le genre, celui de la colonisation pour notre sujet). Ainsi, de la même façon que Sayad ne considérait pas comme contradictoire de poser des invariances tout en soulignant des spécificités, il n’est pas irraisonnable de penser l’explication en termes de classes sociales comme non contradictoire avec l’analyse en termes de rapport colonial, ce dernier n’étant en définitive qu’une des formes exacerbée des rapports de domination. La négation des spécificités liées à la colonisation, la mise en avant frénétique des ressemblances n’est donc pas un non-sens : elle participe, volontairement ou non, aux processus de domination de cette immigration.
Le principe de l’existence d’analogies entre immigration et colonisation avait d’ailleurs été déjà formulé de manière précise par Sayad. Celui-ci soulignait en particulier trois facteurs confortant le raisonnement analogique. En premier lieu, il mentionnait les liens historiques entre certaines immigrations et la colonisation. L’immigration est fille de la colonisation, directement ou indirectement. Il suffit d’appréhender la colonisation et l’immigration comme un rapport social, pour saisir comment les caractéristiques des rapports colonisateur / colonisé / système de colonisation peuvent se reproduire dans le nouveau rapport social groupe majoritaire/groupes minoritaires/système social capitaliste. Il est bien entendu évident pour Sayad qu’analogie ne signifie pas similitude. Il s’agit d’une reproduction, c’est-à-dire d’une articulation nouvelle entre invariance et mutation faisant survivre dans le présent des traits du passé en fonction de besoins contemporains du système social et économique. La deuxième analogie mise en exergue est celle de structure. Sayad ne pense pas les rapports sociaux « colonisation » et « immigration » comme étant constitués de deux partenaires : colonisés / colonisateurs et immigrés / Français. Il réintroduit un troisième partenaire essentiel : la société colonisatrice pour l’un et la société d’immigration pour l’autre. De la même façon que le colonisé comme le colonisateur sont le résultat d’un système social, le groupe majoritaire comme les groupes minoritaires sont des produits d’un système social. Ce dernier, ayant pour finalité la production et la légitimation de la domination, est fondateur d’un ordre dans lequel le colonisé hier, l’immigré postcolonial et ses enfants français aujourd’hui, occupent la place la plus désavantageuse. La troisième analogie est logiquement celle de système. La colonisation comme l’immigration font système : les rapports de domination qui les caractérisent sont travestis et intégrés dans le fonctionnement légal et banal des institutions, des procédures, des différentes sphères de la vie sociale. Sayad démontre ainsi comment l’existence de discriminations légales (comme par exemple l’exclusion des droits politiques ou de certains emplois dits « réservés ») conduit à autoriser la production massive de discriminations illégales. De la même façon, les discriminations et inégalités liées au logement ont des effets logiques en termes d’inégalité dans les domaines scolaires ou d’accès à l’emploi. C’est, comme à l’époque coloniale, l’ensemble d’un système qui est en œuvre et non simplement quelques colonisateurs véreux hier ou quelques racistes repérables aujourd’hui :
« Outre la série d’analogies qu’on peut saisir entre les deux phénomènes – analogies d’ordre historique (l’immigration est souvent fille de la colonisation directe ou indirecte) et analogies de structure (l’immigration, actuellement, occupe dans l’ordre des relations de domination la place qu’occupait hier la colonisation) – l’immigration s’est, d’une certaine façon, érigée en système de la même manière qu’on disait que la “colonisation est un système” (selon l’expression de Sartre) »[9].
En nous invitant à questionner notre système social pour comprendre l’immigration, Sayad nous mène au développement d’une véritable sociologie critique. Ses hypothèses doivent certes être discutées et/ou contestées. Cependant, nombre d’entre elles nous semblent avoir des effets heuristiques d’une grande actualité : l’articulation entre émigration et immigration, l’articulation entre colonisation et immigration, la notion d’imaginaire et de transfert de celui-ci, la prise en compte de l’héritage que constitue le « chauvinisme de l’universel », l’appréhension de l’immigration comme rapport social, la prise en compte du système comme structurant ce rapport social et produisant le groupe majoritaire, les groupes minoritaires et le type d’interactions inégalitaires qui les relient, le lien entre domination des « pays d’origine » et domination dans la société française des immigrés qui en sont originaires
Le savoir des premiers concernés
Il n’est pas possible de conclure sans mentionner le rapport que Sayad avait lui même avec les immigrés et leurs enfants français, c’est-à-dire sans mettre en exergue la posture adoptée vis-à-vis des dominés qui constituaient ses objets de recherches. La pratique de longs entretiens était sa méthode privilégiée. Leur lecture est suffisante pour souligner l’existence d’un savoir des dominés. Certes, il est éparpillé, empli de contradictions, non formulé de manière logique et structurée, mais il est bien présent. La pratique de l’entretien est d’ailleurs le moment d’une mise en ordre des éléments de ce savoir transformant ces moments de parole en véritable autoanalyse. Nous sommes ici à l’antipode des postures dominant le monde de la recherche aujourd’hui. Ces dernières cantonnent en effet les premiers concernés au rôle d’acteurs (ou de témoins) ne sachant rien de l’histoire qu’ils font, laissant ainsi au « scientifique » la prétention de dire le « vrai ». Outre le refus d’une coupure entre pratique (qui serait le fait des acteurs) et savoir (qui serait le fait de « savants » étudiant les acteurs), la posture de Sayad est également celle du refus de l’opposition entre une approche des trajectoires individuelles et une approche macrosociologique. Pour Sayad, les trajectoires individuelles et/ou familiales incorporent, dans tous les sens du terme, y compris le sens fort de marques sur le corps en termes de maladies professionnelles ou liées à la place sociale, les effets de l’histoire sociale et politique et des dominations qui les caractérisent. L’immigration ne saurait ainsi se réduire à de simples décisions individuelles, celles-ci étant elles-mêmes déterminées par un contexte historique, économique et social. Il n’est pas étonnant que ses derniers travaux se soient orientés vers une sociologie de l’État. Sayad nous invite ainsi à dépasser les acteurs visibles pour interroger les liens entre État, nation et immigration. Ce faisant, son œuvre est un apport immense à la dynamique militante de ceux qui prétendent agir contre les inégalités. Transformer les rapports de forces suppose en effet de s’attaquer aux causes et non seulement aux conséquences, au système producteur et non seulement à ses effets, aux acteurs réels et non seulement aux acteurs visibles, au « Dieu caché » (et donc efficace parce que caché) et non seulement à l’apparence.
Saïd Bouamama 13 mars 2017 Immigration, colonisation et domination : l’apport d’Abdelmalek Sayad
https://www.contretemps.eu/immigration-colonisation-sayad/
Notes:
[1] A. Sayad, « Le foyer des sans-famille », in L’Immigration et les paradoxes de l’altérité, Paris-Bruxelles, De Boeck Université, 1997, p. 92 et 93.
[2] Cf. A. Memmi, Portait du colonisé, Paris, Gallimard, 1957.
[3] A. Sayad, op. cit., p. 67.
[4] A. Sayad, « Le mode de génération des générations immigrées », Migrants-formation, n° 98, septembre 1994, p. 10.
[5] A. Sayad, La Double Absence, « le poids des mots », Paris, Seuil, 1999, p. 314.
[6] A. Sayad, « Le mode de génération… », art. cit., p. 14.
[7] Ibid., p. 76-77.
[8] K. Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Paris, Mille et une nuits, 1997.
[9] A. Sayad, L’Immigration ou les paradoxes de l’altérité, op. cit.