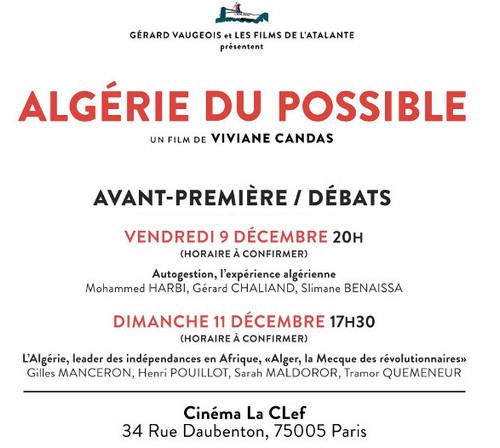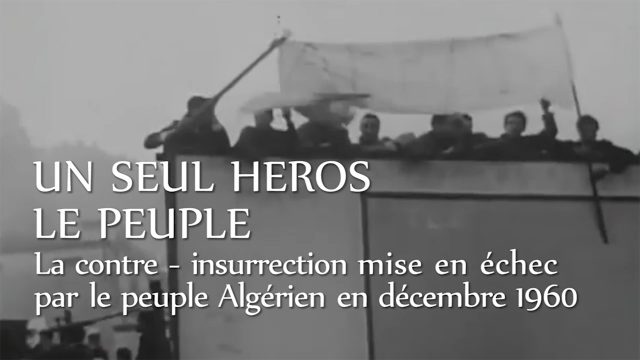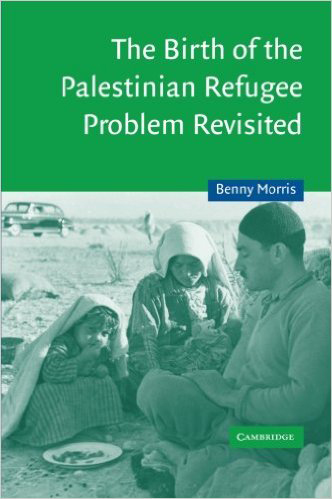Le titre était pourtant intrigant : “Le plan secret des pays arabes pour évincer le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas”. Mais cet article, publié fin mai sur le site Middle East Eye, n’a guère suscité de réactions au-delà des cercles s’intéressant encore à la question palestinienne. Le journaliste David Hearst y livre des informations sur la volonté des Émirats arabes unis, de l’Égypte et de la Jordanie d’anticiper une « ère post-Mahmoud Abbas » et de remplacer celui-ci, à terme, par Mohammed Dahlan, ancien responsable de la sécurité préventive à Gaza. Ce qui constituerait un changement générationnel radical : en 1961, année où Mohamed Dahlan venait au monde dans la bande de Gaza, Mahmoud Abbas (nom de lutte : Abou Mazen), alors au Qatar, rejoignait le Fatah créé en 1959 au Koweït voisin.
Cet éventuel remplacement ne devrait cependant pas advenir tout de suite : mardi 29 novembre, en ouverture de son 7ème congrès qui se tient à Ramallah, en Cisjordanie, le Fatah a reconduit son vieux leader, pour un mandat de 5 ans. Au terme de cette échéance, il aura 86 ans.
« Abbas est l’un des derniers du noyau historique », résume Julien Salingue, politologue, auteur de plusieurs ouvrages sur la Palestine [1]. Farouq Kaddoumi, « pas consensuel », est écarté. Abu Jihad, Abu Iyad et Yasser Arafat, les autres fondateurs historiques du Fatah, sont morts. Surtout, « il ne reste aucun ancien qui aurait, comme Mahmoud Abbas, accompagné d’aussi près la séquence Oslo », souligne le chercheur. De fait, sa réélection mardi apparaît surtout comme une dilatation artificielle du crépuscule politique d’Abou Mazen. Crépuscule qui est avant tout celui, interminable, du “processus de paix”, que la plupart des dirigeants internationaux, incapables de tracer de nouvelles perspectives, tentent de maintenir artificiellement en vie.
Dans la “cuisine” d’Oslo
Face à cette peur du vide, celui qui préside non seulement l’Autorité palestinienne (AP) depuis janvier 2005 mais aussi le Fatah et le comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), offre quelques gages de continuité. Et demeure un acteur régional d’importance qui, contrairement aux propos du premier ministre israélien qui l’accuse régulièrement de soutenir le “terrorisme”, est toujours resté fidèle à sa ligne politique adoptée il y a quarante ans : celle de la négociation avec l’occupant pour parvenir à une solution à deux États. Dans cette région sujette aux bouleversements, les chancelleries occidentales ne sont pas pressées de voir partir un dirigeant aussi constant. Interrogé, le Quai d’Orsay ne se mouille guère : « La France soutient les autorités palestiniennes légitimes, au sein desquelles toute évolution devra passer par le fonctionnement démocratique des institutions ».
Au cœur des années 70, alors que l’OLP amorce son virage stratégique vers la solution de deux États, il est l’un des premiers à nouer des contacts avec la gauche israélienne. Mais l’époque des fedayins n’est pas encore totalement révolue et, dans un environnement où la lutte armée est magnifiée, Abou Mazen a déjà cette réputation d’homme de dialogue plus que de combat. « On disait d’Arafat qu’il savait à la fois manier le fusil et le rameau d’olivier et c’est à mon sens ce qui expliquait sa popularité ; Abbas, lui, se contente du rameau d’olivier... », relève Taoufiq Tahani, président de l’Association France Palestine solidarité (AFPS). « Le vieux problème de Mahmoud Abbas est celui de la légitimité, ajoute Nicolas Dot-Pouillard, chercheur à l’Institut français du Proche-Orient (IFPO), auteur de La mosaïque éclatée, ouvrage consacré à l’histoire récente du mouvement national palestinien, qui vient de paraître [2]. Bien que faisant partie des historiques du parti, il n’est pas une de ses figures combattantes comme Abu Jihad ou Abu Iyad, assassinés ; il a toujours été le bureaucrate. »
En l’occurrence, ses qualités d’organisateur permettent au militant, né à Safed en 1935, exilé avec sa famille en Syrie en 1948, passé par le Caire et le Collège oriental de Moscou (où il a étudié l’histoire), d’intégrer le comité exécutif de l’OLP en 1981. Trois ans plus tard, il est chargé des relations extérieures de l’organisation. Mais c’est au début des années 90 qu’il acquiert une place réellement incontournable dans le dispositif de la centrale palestinienne. Au printemps 1993, alors que les négociations initiées à Madrid piétinent, les Israéliens cherchent à savoir qui est réellement en coulisse à Oslo, où se déroulent des discussions parallèles et secrètes. Ils parviennent à la conclusion qu’Abou Mazen est « le véritable maître d’œuvre de l’opération ». Son bureau est alors appelé “la cuisine” [3]. Il le quitte quelques mois plus tard pour aller parapher, aux côtés de Yasser Arafat, Ytzhak Rabin et Shimon Péres, la déclaration de principe sur la terrasse de la Maison blanche. Cette signature leur vaudra de partager un Nobel de la paix dont Abbas sera, dit-on, vexé d’avoir été privé. Mais à la suite de ces accords, il peut enfin retourner en Palestine. Ce qu’il fait en 1995. Devenu secrétaire général de l’OLP un an plus tard, il va y conforter au fil des ans sa position d’interlocuteur privilégié des Américains et des Israéliens.
Un proviseur en costume sombre
En septembre 2000, la deuxième Intifada éclate. Mahmoud Abbas condamne les attentats-suicides et, convaincu qu’elle mène à l’impasse, la militarisation du mouvement. Un positionnement qui sied aux américains et à l’UE : au printemps 2003, ils imposent à Arafat, assiégé à la Mouqata de Ramallah, d’en faire son premier ministre. Il le restera à peine quelques mois, démissionnant en septembre. Après la mort de Yasser Arafat à Paris, en novembre suivant, Mahmoud Abbas, soutenu par le Fatah, remporte les élections du 9 janvier 2015, recueillant plus de 62% des voix. Il assure qu’il « respectera l’héritage d’Arafat ». Mais au visage expressif du vieux chef militaire arborant toujours un keffieh sur la tête et, souvent, une arme à la ceinture, succède la figure austère de cet homme au sourire hésitant, vêtu d’un costard sombre et portant d’épaisses lunettes. Tout un symbole : « En 1994, l’ossature de l’Autorité palestinienne (AP) est constituée du noyau militant Fatah-OLP, souligne Julien Salingue. En 2005, quand Abbas prend le pouvoir, c’est déjà assez largement une bureaucratie non politique qui gère l’AP, avec des purs technocrates, comme l’ancien premier ministre Salam Fayyad. Et ce type de profil n’aide pas à prendre des décisions qui vont à l’encontre de la structure ! »
Aujourd’hui, onze ans plus tard, la “structure”, sous perfusion permanente de l’aide internationale, est confrontée à un bilan objectivement désastreux pour le peuple palestinien : la fracture territoriale et politique Hamas-bande de Gaza / Fatah-Cisjordanie, survenue en 2007, n’est pas résorbée ; “l’intifada des couteaux”, menée sporadiquement depuis octobre 2015 par des jeunes agissant hors cadre collectif, témoigne d’un degré de désespérance politique inégalé ; et le nombre de colons en Cisjordanie est passé d’environ 250.000 fin 2004 à 513.000 en 2014 selon l’organisation B’Tselem.
« Je considère que Mahmoud Abbas n’en fait pas assez et ne suis d’accord ni avec sa politique économique intérieure, ni avec son choix de la négociation à tout prix avec Israël », assène B. un Palestinien de Cisjordanie, responsable associatif. Depuis qu’un ami travaillant aux renseignements lui a conseillé de faire attention après qu’il a posté une caricature sur Facebook, il préfère garder l’anonymat. « Ici, il se dit qu’il aurait été un bon proviseur de lycée mais que, comme chef de l’Autorité, il est nul. La coordination sécuritaire avec les Israéliens [un volet d’Oslo que Mahmoud Abbas a toujours fermement défendu] est vue comme une génuflexion devant l’occupant. Et depuis 2007 et la séparation entre Gaza et la Cisjordanie, son image dans la société est celle d’un lâche. Il n’a jamais été dans la bande de Gaza alors que le territoire a subi de nombreuses offensives meurtrières. Beaucoup pensent que, même retenu par les Israéliens, Arafat aurait pris sa voiture pour se rendre sur place, ou qu’il aurait au moins essayé. » Pour lui, « Abbas n’est pas un homme courageux. Quant à la réconciliation Hamas-Fatah, c’est un véritable feuilleton égyptien, c’est du n’importe quoi ! Ils se retrouvent tous les ans à Doha, discutent, parviennent à un accord qui n’entre jamais en application... Or c’est quand même à lui, le président, d’impulser quelque chose de sérieux à ce niveau. » En juin dernier, l’énième “round de négociation” qui s’est tenu entre les deux partis, toujours à Doha, n’a rien donné.
L’homme d’un système désavoué
S’il regrette lui aussi l’absence de « gestes forts » du président de l’AP au moment des offensives israéliennes dans la bande de Gaza (en 2008-09, 2012 et 2014), Taoufiq Tahani tempère cette sentence : « Au plan politique, il n’y a pas eu de grande différence avec Arafat. Simplement, quand Yasser Arafat laissait les groupes armés agir lorsque cela l’arrangeait, Mahmoud Abbas, lui y a toujours été opposé et l’a fait savoir. Il reste d’ailleurs un homme de parole : quand il dit quelque chose, il le pense. Et dans les faits, il n’a renoncé ni au droit au retour, ni à l’État palestinien dans les frontières de 1967. N’oublions pas qu’en 2005, lorsqu’il parvient au pouvoir, il n’y a aucune offre internationale sur la table. Et qu’en 2006, lorsque le Hamas gagne les élections législatives, il joue pleinement le jeu de la démocratie en nommant un premier ministre du Hamas. C’est ensuite la communauté internationale qui l’a contraint à revenir là-dessus ».
De fait, nul ne pourra reprocher à Abbas d’avoir triché avec les exigences des “parrains” internationaux. Au contraire. « Il a toujours misé sur les Américains en pensant que s’il arrivait à poser les bases d’un État, ils l’aideraient », note Taoufiq Tahani, qui regrette son incapacité à se démarquer du champ institutionnel : « Il s’est beaucoup adressé à la communauté internationale officielle, mais pas assez à l’opinion publique internationale, me semble-t-il. Comme s’il n’avait pas mesuré l’importance de la solidarité populaire, oubliant l’exemple, entre autres, de l’Afrique du Sud ».
Ce pari obstiné sur le processus d’Oslo – en dépit de son torpillage constant par les gouvernements israéliens successifs – et sa volonté de ne jamais fâcher Washington ont souvent conduit le président palestinien à prendre des positions très peu goûtées par l’opinion. En 2009, cédant aux pressions américaines, il accepte de suspendre la procédure d’examen du rapport Goldstone sur la guerre menée par Israël à Gaza en décembre 2008-janvier 2009. En novembre 2012, il dit avoir le droit de voir Safed (sa ville natale, dont tous les habitants ont été expulsés en 1948 et qui est désormais sur le territoire israélien), mais plus celui d’y vivre ; en décembre 2013, il affirme, lors d’une conférence de presse en Afrique du Sud, qu’il ne « soutient pas le boycott d’Israël », marquant ainsi sa distance avec la campagne BDS [4].
Des positions répétées et signifiantes mais qui, selon Julien Salingue, posent moins de question sur l’homme lui-même que sur le système qu’il a choisi de servir : « Ce n’est pas une question de personne, mais d’orientation politique. Il s’est juste coulé dans le moule d’Oslo et de l’Autorité palestinienne. Ce que l’on a pu observer au cours de la décennie passée s’inscrit dans le prolongement ce qui se passait avant : le clientélisme, les réseaux financiers parallèles, ce n’est pas Abbas qui les a mis en place. Simplement, là aussi, il a accompagné le processus général de dépolitisation. Il est responsable de s’en être accommodé. » Et d’avoir laissé s’amalgamer au fil des ans un “appareil proto-étatique”, l’AP, et une formation politique, le Fatah.
Le libéral et le diplomate
Si au cours des dernières années, la question de la dissolution de l’AP a régulièrement été évoquée comme une réponse politique possible au blocage de toute avancée par les Israéliens, cette éventualité pose d’autres questions internes, passées plus inaperçues : « La distinction entre le Fatah comme mouvement politique et l’Autorité palestinienne comme structure administrative n’a pas été réglée, regrette Julien Salingue. Et des orientations fondamentales n’ont pas été prises : comment faire en sorte que l’AP ne se substitue pas au mouvement de libération ? Comment refondre une OLP élargie, incluant le Hamas et l’ensemble des composantes du mouvement national de libération ? Le problème est que le débat sur l’AP est complètement biaisé par le fait qu’elle est le principal pourvoyeur d’emplois en Palestine... » L’Autorité palestinienne et les gouvernorats locaux employaient, mi 2012, en Palestine, 192.000 personnes, soit une hausse de 5% par an depuis la création de l’AP [5].
À la tête de cet appareil donnant le pouvoir de la distribution des salaires, Mahmoud Abbas a mené une politique intérieure plutôt libérale. « C’est vrai qu’il n’a aucune, ou une très faible, marge de manœuvre pour lutter contre l’occupation israélienne, reconnaît B. Mais la situation intérieure s’est elle aussi détériorée. Aujourd’hui, les services publics sont en très mauvais état. Ceux qui le peuvent vont dans les hôpitaux privés pour se soigner. Les universités sont payantes ; on a vu cinq ministres assister à l’inauguration d’un établissement scolaire privé dont l’un d’eux est actionnaire. Et les secteurs qui pourraient rapporter un peu d’argent à l’État, comme par exemple la téléphonie mobile, ont été cédés à des grandes familles de Cisjordanie... Il faut être honnête, Abbas n’est pas à l’origine de cette dérive, Arafat avait déjà commencé. Mais cela s’est poursuivi et il est clair que lorsque tout est privatisé, cela profite généralement aux proches du pouvoir. » Récemment, le nom de Tareq Abbas, le second des trois fils du président (en plus de Mazen, mort en 2002, et de Yasser) est apparu dans l’affaire des Panama Papers. Membre du conseil d’administration d’un gros distributeur de produits de consommation, il avait aussi été nommé, au début des années 2000, vice-président d’un fonds d’investissement de la diaspora.
Restent les batailles menées à l’ONU : l’entrée de la Palestine à l’Unesco comme membre officiel (octobre 2011), le rehaussement de son statut au stade d’État observateur non-membre (novembre 2012), son adhésion à la Cour pénale internationale (avril 2015). Des victoires symboliques mais importantes, acquises en dépit des menaces et manœuvres de Washington et Tel Aviv. « Cela a contribué à acter une légitimité à l’échelle internationale de la revendication d’un État palestinien et montré qu’Israël est isolé dans les institutions étatiques, estime Julien Salingue. Mais cela a aussi contribué à entretenir l’illusion qu’il existe quelque chose s’apparentant à un État palestinien, alors qu’aujourd’hui sur le terrain, il n’y a absolument rien qui ressemble à un début d’État... » Une réserve à laquelle abonde B. : « Des fêtes solennelles ont été organisées à Ramallah. Mais ici, ces évolutions n’ont aucun effet. Il fallait mener ces batailles, mais cela ne méritait pas autant de battage. La mise en valeur surjouée de ces événements est une sorte de mensonge à haute voix : on va se montrer à New York, on dresse le drapeau sur l’esplanade de l’Unesco, mais ici, en Palestine, rien ne bouge, la situation d’occupation ne change pas. »
Luttes de succession
Tout laisse aujourd’hui à penser que, en cohérence avec son parcours, ces faits d’armes livrés dans l’arène diplomatique seront les plus saillants, positivement, de Mahmoud Abbas en tant que président de l’AP. Mais après ? Le scrutin municipal qui était initialement prévu le 8 octobre a été reporté à une date encore inconnue. Pour d’éventuelles consultations présidentielles et / ou législatives, rien n’est encore fixé. « Il a fait le ménage autour de lui, écarté des gens qui lui étaient proches tels que Salam Fayad ou Ahmed Qoreï, explique Nicolas Dot Pouillard. Il est aujourd’hui assez isolé. On a affaire à une présidence problématique ». Majid Faraj, le responsable des services secrets, serait le candidat du sortant. Mais sa jubilation assumée après l’arrestation d’activistes armés lui a valu une condamnation de quasiment toutes les factions palestiniennes. Si il en avait la possibilité, B. voterait, lui, pour Marwan Barghouti – « sa situation de prisonnier est le reflet exact de celle du peuple palestinien, nous sommes enfermés, détenus ». Mais le “Mandela palestinien” est emprisonné depuis 2002 en Israël et, s’il bénéficie d’un grand crédit au sein du mouvement de solidarité international, c’est moins le cas dans les territoires et parmi les plus jeunes Palestiniens.
Reste donc l’hypothèse Dahlan, bien au chaud dans le Golfe, apprécié par Le Caire et Tel Aviv mais détesté par la gauche palestinienne et une très grande partie de la population. « Les informations circulant sur Dahlan sont globalement fondées, estime Nicolas Dot-Pouillard. Il est en quelque sorte le commis voyageur des Émirats arabes unis et utilise cette position pour tenter de se placer en candidat incontournable pour la présidence palestinienne. Il dispose d’argent, c’est évident, et a des soutiens dans certains camps de réfugiés. Le scénario de son parachutage n’est donc pas exclu, même si cela s’apparenterait clairement à un coup d’État télécommandé de l’extérieur... Au delà, mon analyse est qu’il n’y a pas vraiment de désaccord stratégique entre tous ces hommes. Mais des divergences de personnes et des luttes pour la prise de l’appareil de l’Autorité nationale. La réalité du Fatah, aujourd’hui, est qu’il fonctionne comme un ensemble de féodalités locales lié à des financements de divers personnages. Au Liban, on le voit très bien dans les camps de réfugiés : Il y a les pro-Abbas, les pro-Fayyad, les pro-Dahlan. »
Un délitement politique auquel Abou Mazen, dupé plus ou moins consentant d’Oslo, n’est pas totalement étranger. En le reconduisant à sa tête, le Fatah semble avoir écarté l’hypothèse Mohamed Dahlan. Mais, vu l’âge d’Abbas, ce n’est que temporaire. Les incertitudes sur "l’après", accrues par l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche, demeurent nombreuses. Une seule chose est sûre : si c’est bien Dahlan - figure archétypale, au début des années 2000, de la dérive autoritaire de l’AP et de sa soumission aux exigences de Tel Aviv - qui finit par s’imposer, cela apporterait une terrible réponse aux questions que se posait le négociateur Abbas le 12 septembre 1993 dans l’avion qui le menait de Tunis à Washington [6] : « (…) ce que nous apprêtions à faire allait-il nous ouvrir les portes de l’avenir ou les refermer ? Avions nous trahi ou préservé les droits de notre peuple ? »