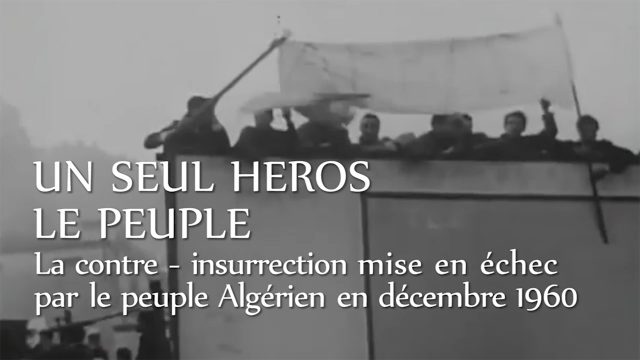Quelques mois après la destruction des tours jumelles de Manhattan le 11 septembre 2001, un prince saoudien, doté des responsabilités politiques, déclara au cours d’une interview : « Nous qui avons fait nos études en Occident sommes pour la démocratie que dis-je ? nous sommes de vrais démocrates. Mais si nous donnons au peuple le droit de vote, pour qui pensez-vous qu’il votera, sinon pour les islamistes ? Comment voulez-vous que nous introduisions la démocratie en Arabie ? Ce n’est pourtant pas l’envie qui nous manque »1 Ce point de vue sous-entend que les islamistes sont les ennemis de la démocratie, même si, pour arriver au pouvoir, ils empruntent la voie démocratique. Pourtant par là aussi, peut-être à son insu, le prince reconnaissait la légitimité des islamistes ainsi que l’impopularité de la famille royale.
La crainte que les islamistes ne viennent troubler la vie politique saoudienne a provoqué des mesures de répression sans précédent depuis la révolution iranienne de 1979 et l’occupation de la grande mosquée de la Mecque par des salafistes armés la même année. Au cours des dernières décennies, des dizaines de milliers de personnes ont été embastillées et des milliers d’autres assassinées au nom de la stabilité du régime. Et pourtant, il existe en Arabie saoudite bon nombre de mouvements sociaux qui s’inspirent pour partie de l’islamisme dans ses formes diverses et qui cherchent à créer des mouvements de masse et à organiser des protestations contre cet environnement si répressif. Ces mouvements n’ont guère de relais institutionnels puisque les partis politiques ont été interdits en 1932, les manifestations et les grèves en 1956. Et depuis 2014, toute action collective est assimilée au terrorisme et réprimée en conséquence. Malgré tout, ces mouvements, souvent issus de l’islam politique, parviennent à faire descendre des gens dans la rue et à les envoyer aux urnes pour contester telle ou telle orientation de l’État. Ils luttent pour imposer des réformes, dénoncer les abus de pouvoir, revendiquer une monarchie constitutionnelle et le respect des droits humains. Cet article a pour objet d’expliquer la réussite de quelques-uns de ces mouvements et l’échec des autres, et d’évaluer leur éventuel apport à l’avenir de la politique saoudienne.
Sahwa, l’« éveil islamique »
Al-sahwa al-islamiyya, « l’éveil islamique » (couramment appelé « Sahwa »), est l’un des mouvements sociaux les plus anciens d’Arabie saoudite. C’est l’expression saoudienne de réseaux transnationaux composés d’activistes égyptiens, syriens, irakiens, indiens, yéménites et saoudiens, venus de divers horizons politiques, certains étant des immigrants entrés dans le pays à partir de 1952. Dans le passé, la famille royale Al-Saoud a accueilli favorablement les Frères musulmans d’Égypte et de Syrie en exil, tout en interdisant la création d’une confrérie saoudienne.
Les Frères musulmans saoudiens sont répartis entre quatre groupements informels, dont deux dans le centre du pays, l’un dans la province orientale (Al-Charqiya), et un autre dans le Hedjaz. À partir des années 1970, les Frères musulmans ont été actifs dans le système éducatif et dans les médias. Ils se faisaient les défenseurs d’une culture islamique plus inclusive et plus moderne que celle de l’enseignement religieux officiel. Ils critiquaient aussi l’influence d’experts étrangers au sein des institutions de l’État.
Dans les années 1960 et 1970, en même temps que les Frères musulmans, des groupes salafistes ont émergé dans le cadre de la Sahwa.
Nés d’une volonté de réinterpréter les textes religieux où l’État puise sa légitimité, ils se sont divisés aussi en plusieurs groupes, et leur interprétation du dogme va du quiétisme aux doctrines révolutionnaires. l’État tire sa légitimité, mais eux aussi se sont divisés en plusieurs groupes, dont les interprétations des dogmes vont du quiétisme aux doctrines révolutionnaires. Certains salafistes soutiennent l’État et sa politique religieuse, d’autres critiquent les institutions religieuses officielles. Les uns demandent des réformes politiques tandis que d’autres appellent à combattre par les armes l’État et ses soutiens occidentaux. Ils sont unis par une tendance à récuser l’impératif d’action politique organisée, sommant l’individu de se modifier lui-même d’abord pour devenir un musulman régénéré. Les Frères musulmans, en revanche, croient en la nécessité de l’organisation politique et en la possibilité de réformer la société de bas en haut. La Sawha se compose aussi bien de salafistes que de Frères musulmans.
Comment des islamistes peuvent-ils s’opposer à un État qui doit sa légitimité à son adhésion bruyante à l’orthodoxie sunnite la plus stricte ?
Les salafistes comme les Frères musulmans soutiennent que la famille Al Saoud a abusé de la religion en la transformant en outil de pouvoir. Contre cet assujettissement du religieux au politique, ils espèrent utiliser la capacité des réseaux religieux comme remparts potentiels contre l’autoritarisme. Les islamistes croient que mobiliser ainsi les réseaux religieux permettra d’opposer la loi de Dieu aux méthodes de la famille royale, y compris sa coopération avec les États-Unis et l’Europe, perçue comme une tentative de recoloniser le Proche-Orient.
Des militants de la Sahwa ont pris part aux protestations de masse contre la première guerre du Golfe (1990-1991), lorsque l’Arabie saoudite servait de base arrière aux armées occidentales déployées contre Saddam Hussein. Les islamistes saoudiens réclamaient la rupture des accords militaires avec les États-Unis et l’Europe, ainsi que l’indépendance de la magistrature, le respect des droits humains, la liberté d’expression, l’interdiction de la torture, une extension de l’État-providence et la fin de la corruption. Les Al Saoud ont répondu en renforçant leurs pouvoirs, avec l’adoption en 1992 de la Loi fondamentale et en réprimant le mouvement islamiste à partir de l’année suivante. Lors de leur sortie de prison à la fin des années 1990, des militants seront autorisés à participer à la mise en œuvre de réformes très limitées. Au cours du bref « Printemps saoudien » de 2003, ils réclameront de nouveau des changements politiques, apporteront leur soutien à une monarchie constitutionnelle et exigeront une fois de plus que les droits humains soient respectés. Les attentats de 2000-2005 visant les Occidentaux susciteront des arrestations massives et ce projet de réforme sera vite étouffé.
Cependant, des candidats islamistes ont remporté les élections municipales de 2005 à Riyad, Djeddah, Dammam, La Mecque, Taëf et Tabouk.
Ils sont parvenus à déjouer les règles draconiennes du système électoral qui interdisaient à la fois les coalitions de candidats et les programmes fondés explicitement sur la religion. La riposte des islamistes — y compris des salafistes, qui remportèrent quelques sièges à Dammam et Djeddah — a consisté à nouer des alliances clandestines, à l’aide de réseaux militants déjà en place. Mais ces élections ne présageaient d’aucune ouverture politique. Les électeurs ne désignent que la moitié des conseillers municipaux, l’autre moitié étant nommée par le gouvernement ; et ces conseils n’ont aucun pouvoir, leur rôle est uniquement consultatif. La faible participation (environ 11 % à Riyad) montre à quel point la population s’est désintéresée d’un scrutin largement perçu comme dénué de signification. Cependant ces victoires des islamistes ont surpris et n’ont jamais été reconnues par l’État. Pour les élections suivantes, l’administration a modifié le code électoral pour empêcher une autre victoire islamiste, tout en réprimant toute action politique organisée avec une rigueur accrue.
En 2011, à la veille des soulèvements arabes, des activistes de la Sahwa ont publié plusieurs pétitions adressées au roi Abdallah Ben Abdelaziz Al-Saoud, dont l’une, intitulée « Vers un État de droit et des institutions », plaidait en faveur d’élections libres et une autre, à coloration plus salafiste, s’intitulait « Appel à la réforme ». En 2013, ils ont apporté aussi leur soutien au président égyptien déchu, Mohamed Morsi. En février 2011, des militants salafistes ont fondé le Parti de l’oumma (Hizb al-umma) malgré l’interdiction des partis politiques, réclamant des élections libres et la séparation des pouvoirs. Les membres fondateurs ont tous été arrêtés et les réformateurs de nouveau réduits au silence.
L’Association pour les droits politiques et civiques
Le mouvement politique le plus important issu de l’islamisme sunnite est l’Association pour les droits politiques et civiques (jam‘iyya al-huquq al-siyasiyya wa-l-madaniyya) ou HASM, un acronyme signifiant « détermination ».
Créé en 2009 par des militants de la Sahwa de haut rang, défenseurs des droits humains et membres de la société civile, HASM a « réinventé l’islamisme en tant qu’activisme », et esquissé « une vision de réforme politique ». Le mouvement réclamait la fin de la répression, prenant fait et cause pour les droits des prisonniers politiques et appelant de ses vœux une monarchie constitutionnelle.
L’action directe non violente est au cœur de la stratégie des militants de HASM. Comme l’affirme le militant islamiste Abdallah Al-Hamid, la « lutte par la parole » (jihad al-kalima) ou la « lutte paisible » (jihad selmi) devraient être les principaux moyens de s’opposer aux injustices de l’État. Les membres de HASM ont dans leur collimateur aussi bien de ne conseiller le roi qu’en privé (nasiha), défendue par l’establishment religieux, que la répression de l’activisme politique, tolérée par le clergé. Pour eux, la répression étatique et l’interdiction des manifestations pacifiques sont les principales causes de l’escalade de la violence politique en 2003-2004, quand Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA) a lancé une série d’attaques contre des conseillers occidentaux militaires et policiers à l’intérieur du royaume.
Les procès publics des militants de HASM en 2011-2012 ont offert l’occasion d’actions collectives et de lobbying, les activistes s’en servant comme tribune pour critiquer la répression et exprimer leurs points de vue sur la réforme politique. Tous les fondateurs du mouvement ont néanmoins été condamnés à de lourdes peines par le tribunal spécial créé en 2008 pour juger les affaires de terrorisme. En 2013, ce tribunal a prononcé la dissolution de HASM2.
La place des chiites
La majorité des chiites saoudiens habite Al-Charqiya, la province orientale, riche en hydrocarbures. Même si les élites régnantes qualifient volontiers l’islamisme chiite saoudien de sous-marin iranien, ce mouvement a en réalité pris naissance dans les villes irakiennes de Nadjaf et Kerbala dans les années 1950 et 1960, et au Koweït dans les années 1970. Les islamistes chiites saoudiens sont affiliés au mouvement transnational Shirazi, du nom de l’ayatollah irakien Mohamed Al-Shirazi, qui a passé les trente dernières années de sa vie au Liban, au Koweït et en Iran. En 1979, les « shirazis » saoudiens se sont élevés contre la répression et la marginalisation dont ils étaient victimes, créant l’Organisation de la révolution islamique dans la péninsule arabique (munazhzhama al-thawra al-islamiyya fi-l-jazira al-arabiyya), rebaptisée en 1991 « Mouvement réformiste saoudien » (al-haraka al-islahiyya fi-l-sa’udiyya) puis se sont rapprochés de la Sahwa et de la famille royale. Le seul groupement chiite islamiste qui entretient des relations avec Téhéran est le Saudi Hezbollah, qui est beaucoup plus petit et qui a mené des opérations armées à l’intérieur du pays vers la fin des années 1980 et au milieu des années 1990.
Des militants du Mouvement réformiste saoudien ont signé les appels nationaux en faveur de réformes politiques au cours du Printemps saoudien, et ont publié leur propre pétition, « Partenaires dans la nation », qui réclamait la reconnaissance officielle de la jurisprudence de l’islam chiite, l’égalité entre tous les citoyens et une meilleure représentation des chiites au sein des administrations et des tribunaux. Lors des élections municipales de 2005, les islamistes chiites ont emporté la majorité des sièges élus dans la ville de Qatif et la moitié à Hofuf. Les manifestations dans la province orientale, Al- Charqiya, ont débuté en 2006 en réaction à la guerre israélienne au Liban et en soutien au Hezbollah ; plusieurs manifestants ont été arrêtés. En 2009, des heurts entre pèlerins chiites et sunnites en route pour La Mecque ont déclenché des manifestations de masse. Lors du soulèvement à Bahreïn en 2011, des chiites saoudiens sont descendus dans la rue par solidarité avec les protestataires du pays voisin. Un dissident shirazi, Nimr Al-Nimr a organisé plusieurs manifestations dans la ville d’Awamiya, qui se sont étendues à Qatif, Satwa et Hofuf. Les manifestations de rue et leur répression par la police se sont poursuivies tout au long de l’année 2014, avec des dizaines de militants abattus en pleine rue ou exécutés, dont Nimr Al-Nimr, mis à mort au début de 2016. Entre 2011 et 2014, ce soulèvement dans la province orientale a été l’incarnation la plus tangible d’une version saoudienne des soulèvements arabes de 2011.
En finir avec la corruption
Le mouvement anticorruption s’est formé au cours des violentes inondations qui frappèrent la ville portuaire de Djeddah en 2009, 2011 et 2015. Le 25 novembre (dit « mercredi noir »), des pluies diluviennes ont provoqué des inondations sans précédent qui ont balayé la ville, tuant entre cent et quatre cents habitants, détruisant maisons et infrastructures, surtout dans les quartiers pauvres. Militants et habitants des environs se sont organisés pour apporter des secours aux zones sinistrées, puisque les membres de la défense civile et les pompiers étaient mobilisés en vue de l’imminent pèlerinage à La Mecque. À Djeddah, les réseaux de militants propalestiniens, des militants de la conservation des monuments ainsi que des islamistes sunnites ont soutenu la mobilisation en faveur des victimes des inondations.
L’étendue du désastre a conduit les habitants de Djeddah à une recherche collective des causes. Les militants montraient du doigt la municipalité, accusée d’avoir accordé des permis de construire n’importe où et d’avoir négligé la modernisation du réseau d’évacuation des eaux pluviales. Pour eux, les inondations sont une catastrophe naturelle causée par l’homme. En raison de la corruption municipale, affirmaient-ils, les zones inondables ont été loties, les canaux d’évacuation n’ont pas été entretenus et le système des égouts ne desservait que 8 % de la ville. Le 28 novembre 2009, l’avocat et militant des droits humains Walid Abou Al-Khair, représentant les familles des victimes, a porté plainte contre la ville de Djeddah. L’indignation générale a obligé le roi Abdallah à nommer une commission d’enquête, et plusieurs dizaines de fonctionnaires municipaux ont été condamnés à des peines de prison.
Une répression tous azimuts
Après les attentats de New York de 2001, Riyad a collaboré à la guerre contre la terreur conduite par les États-Unis, notamment en invitant des agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) à assister aux interrogatoires de personnes suspectées de terrorisme3. Après qu’AQPA eut lancé une campagne d’attentats à la bombe contre des occidentaux en 2000-2005, des milliers de personnes ont « disparu » entre les mains des services de sécurité. Dès 2010, le pays comptait entre douze et trente mille prisonniers politiques. Tortures, mauvais traitements, viols, aveux extorqués étaient monnaie courante, et le sont toujours. La répression et les violences de l’État ont eu pour effet de sensibiliser le public à la situation politique et de déclencher la mobilisation des familles de prisonniers en un mouvement qui était alimenté par la répression au lieu d’être freiné par elle. Plus il y avait de détenus, plus il y avait de chances de voir des militants parmi leurs familles.
Ce mouvement a démarré en octobre 2003 lorsqu’une grande manifestation a encerclé le lieu où se tenait le premier congrès des droits humains de Riyad4. Les parents des prisonniers politiques ont organisé des manifestations à répétition et des sit-in dans les mosquées de Riyad, devant le ministère de l’intérieur et dans plusieurs villes de province, surtout dans le centre du pays, ou le mouvement des « partisans » (al-munisarun) a organisé des dizaines de manifestations et a eu souvent maille à partir avec la police. Ces manifestations se sont poursuivies pendant les soulèvements arabes de 2011. Au début de cette année-là, par exemple, des dizaines de femmes se sont rendues au ministère de l’intérieur pour exiger des procès équitables pour leurs proches. Parmi d’autres slogans, elles scandaient : « libérez nos innocents » et « Où sont nos enfants ? ».
À la suite des soulèvements arabes, les Al Saoud ont donné un tour de vis supplémentaire à la répression. En 2014, un décret royal a défini le terrorisme comme étant « toute action… visant à nuire à l’ordre public ou perturbant la sécurité de la société ou la continuité de l’État… ou insultant la réputation et l’honneur de l’État »5. Cette même année, une ordonnance du ministre de l’intérieur définissait comme actes terroristes :
 « le fait de propager l’athéisme et la mise en doute des principes de l’islam sur lesquels la nation est fondée » (article 1) ;
« le fait de propager l’athéisme et la mise en doute des principes de l’islam sur lesquels la nation est fondée » (article 1) ;
 « le fait de prêter allégeance à quelque parti politique, organisation, mouvement, groupe ou individu » (art. 2) ;
« le fait de prêter allégeance à quelque parti politique, organisation, mouvement, groupe ou individu » (art. 2) ;
 « le fait de soutenir, rejoindre ou sympathiser avec toute organisation, groupement, mouvement, rassemblement ou parti politique », y compris sur les réseaux sociaux (art. 3) ;
« le fait de soutenir, rejoindre ou sympathiser avec toute organisation, groupement, mouvement, rassemblement ou parti politique », y compris sur les réseaux sociaux (art. 3) ;
 « le fait d’appeler à des sit-in, des manifestations, des meetings, signer des communiqués ou inciter à y participer ou à en faire la publicité » (art. 8) ;
« le fait d’appeler à des sit-in, des manifestations, des meetings, signer des communiqués ou inciter à y participer ou à en faire la publicité » (art. 8) ;
 « le fait d’assister à des conférences, des réunions ou des meetings […] qui sèmeraient […] de la discorde dans la société » (art. 9).
« le fait d’assister à des conférences, des réunions ou des meetings […] qui sèmeraient […] de la discorde dans la société » (art. 9).
Selon ces définitions vagues, toute action organisée, même non violente, est désignée comme terroriste et réprimée. Les Frères musulmans eux-mêmes sont étiquetés terroristes.
Relance des grèves
Les syndicats ouvriers sont interdits en Arabie saoudite depuis 1947 et les grèves le sont aussi depuis 1956, après que la compagnie américaine Aramco a été paralysée par des mouvements sociaux en 1945, 1953 et 1956. Malgré cette répression de longue date, des conflits de travail sont reparus récemment en raison de la chute du prix du pétrole et la dégradation des conditions de vie, surtout parmi les ouvriers non qualifiés et les diplômés de l’enseignement supérieur. Depuis la fin des années 2000, des diplômés au chômage, des personnels hospitaliers, de l’éducation nationale et des autres services publics, et même les employés de la grande mosquée de La Mecque ont organisé des actions collectives et des grèves pour protester contre le chômage, les bas salaires, les salaires impayés ou la privatisation des entreprises publiques. L’exemple de ces travailleurs du secteur public — des Saoudiens pour la plupart, mais parfois aussi des étrangers — a été suivi dans le privé. Les restructurations économiques et les privatisations rend paradoxalement les mouvements sociaux plus efficaces : dans le contexte saoudien, les sociétés privées pâtissent davantage de la perte d’heures de travail et de bénéfices que les entreprises d’État. Les employés d’un opérateur téléphonique privé, Etihad Etisalat, ont ainsi fait grève en 2011 pour obtenir des augmentations. Le mouvement s’est répandu dans plusieurs régions et la compagnie a dû réévaluer ses échelles de salaire.
Des ouvriers du bâtiment, secteur où l’on engage surtout des étrangers, ont également commencé à se rebiffer. Les travailleurs du Saudi Binladin Group, l’un des fleurons de la construction, font depuis 2010 des grèves à répétition contre les bas salaires, les salaires impayés et les licenciements massifs. En 2016 encore, des milliers d’entre eux ont participé à des manifestations et des grèves.
Des succès réels mais limités
Quatre mouvements sociaux — mouvements de réforme chiite et sunnite, mouvement contre la corruption et mouvement ouvrier — sont parvenus au cours des dix dernières années à introduire en Arabie saoudite des changements, si limités fussent-ils. Ils ont gagné dans plusieurs villes les élections municipales de 2005, fait comparaître devant les tribunaux des fonctionnaires corrompus et obligé les employeurs publics et privés à prendre en compte les revendications de leurs travailleurs.
— Les islamistes se sont jetés à fond dans la bataille électorale de 2005 malgré la répression qui s’était abattue sur leurs mouvements et nonobstant le pouvoir limité des conseils municipaux. Leur victoire est un indice de leur capacité de mobilisation potentielle, et de la désaffection relative de la population envers la famille royale et les élites du régime. Elle a montré aussi qu’au lieu de boycotter des élections imparfaites, les islamistes pouvaient adhérer aux procédures électorales tout en contournant les règles complexes du scrutin. Le prince cité en tête de cet article avait à la fois raison et tort : des élections ont été organisées et les islamistes les ont remportées, mais elles ont surtout montré que les Al Saoud et les élites soutenues par l’État ne sont pas les seuls à vouloir jouer le jeu de la politique électorale. La participation des islamistes à ces élections et le soutien que depuis longtemps ils apportent à l’idée d’une monarchie constitutionnelle sont la preuve qu’ils tiennent les élections pour un outil de réforme légitime.
L’État n’a jamais admis que les vainqueurs soient des islamistes ; selon les médias officiels, ces élections n’avaient qu’un caractère technique, nullement politique, les élus aux conseils n’étaient que des technocrates sans partisans organisés. Les fonctionnaires de l’État ont retardé la première réunion de ces conseils municipaux pendant plus d’une année, voulant par là souligner leur insignifiance. En conséquence, lors des élections de 2011 et 2015, la participation, déjà faible en 2005, était encore plus basse. Pendant ce temps, l’État a poursuivi sa répression de toute action politique, identifiée au terrorisme depuis 2014.
— Le mouvement anticorruption a conduit à une enquête publique sur les causes des inondations à Djeddah et à la condamnation de plusieurs fonctionnaires. Le succès était incomplet, cependant, car les principaux décideurs — et parmi eux des princes saoudiens — n’ont pas été inculpés. Le scandale causé par le nombre de morts n’explique pas à lui seul les résultats de la mobilisation. Les infrastructures municipales et le développement du secteur immobilier sont deux des principales voies par lesquelles la rente pétrolière est injectée dans l’économie. L’immobilier et les infrastructures sont au cœur du système de gouvernement saoudien. Les princes font don des terres en échange de la loyauté des bénéficiaires, et pour des secteurs importants du monde des affaires, ces terres sont source d’enrichissement. Les promoteurs, investisseurs immobiliers et propriétaires fonciers bénéficient tous de prêts publics gratuits et sont ainsi liés à l’État à la fois par cet endettement et par leurs espoirs financiers (les emprunts immobiliers privés n’ont été introduits qu’en 2012). De plus, en développant les villes et en les transformant en immenses banlieues, l’État a non seulement créé des occasions d’investissement, mais il a aussi rendu la mobilisation et les manifestations plus difficiles en raison de la dispersion de la population. Naguère rassemblés dans des agglomérations denses, les Saoudiens sont aujourd’hui atomisés en maisons individuelles éparpillées à travers un vaste paysage d’autoroutes, d’échangeurs et de banlieues mornes. La terre est par essence politique, elle est au cœur du système de pouvoir de la famille Al Saoud, que l’intervention du roi Abdallah à Djeddah visait à préserver.
— Les succès du mouvement ouvrier ont été réels, mais très limités. Les grèves ayant contraint les entreprises à négocier sont rares et elles mettent en péril les ouvriers. L’interdiction des syndicats et la répression qui s’abat sur toutes les actions collectives, y compris les grèves et les manifestations, rendent particulièrement vulnérables les ouvriers les plus mal payés, dans leur immense majorité des immigrants asiatiques et arabes.
Le plus grand échec des mouvements contestataires saoudiens est leur incapacité à surmonter les barrières géographiques et politiques pour réunir leurs forces. Les groupes islamistes sunnites sont aussi fragmentés que les groupes chiites. Les mouvements contre la répression et la corruption n’ont souvent qu’une base locale. En général, les mouvements protestataires saoudiens sont mal outillés pour s’opposer à la répression étatique. L’absence d’un mouvement national au moment des soulèvements qui ont mis fin au règne de Zine El-Abidine Ben Ali en Tunisie, de Hosni Moubarak en Égypte, de Mouammar Kadhafi en Libye et d’Ali Abdallah Saleh au Yémen est un symptôme de cette fragmentation. Certes, il y a eu des manifestations en janvier 2011 : des centaines de Saoudiens ont défilé contre la corruption et en faveur de la transparence. Pendant plusieurs jours, des manifestations ont eu lieu devant des bâtiments municipaux et des ministres clés ; quelques immolations par le feu se sont produites entre 2011 et 2013 en réponse au suicide par le feu du vendeur ambulant Mohamed Bouazizi qui avait marqué le début de la révolution tunisienne. Les plus grandes manifestations se sont déroulées dans les zones chiites de la province orientale. Pourtant ces protestations ne se sont pas fondues en un soulèvement national. Toute possibilité de mobilisation générale a été écrasée dans l’œuf par un massif déploiement de policiers dans la capitale, la mise en détention de nombreux militants (y compris des membres du HASM et des dizaines d’activistes chiites) et par une escalade de la violence entre chiites et forces de sécurité dans la province orientale.
Répression partout, réforme nulle part
L’autoritarisme saoudien est peu subtil. Il consiste en une interdiction de toute action politique, un recours fréquent à la violence policière, l’opacité et la désinformation. Il y a des raisons historiques à cette situation. La famille Al-Saoud a consolidé son emprise sur le pays contre les protestations et l’insatisfaction populaires avec l’aide de la compagnie pétrolière américaine Aramco et la coopération d’experts sécuritaires occidentaux et arabes. Au cours des dernières décennies, l’État saoudien a bénéficié de l’aide jordanienne, égyptienne, française, britannique et américaine pour mettre sur pied un appareil de répression particulièrement brutal. Cette répression tous azimuts ne signifie pourtant pas que des membres des élites islamistes n’ont pas, de temps en temps, été intégrés aux ministères de l’éducation, des médias et des affaires islamiques. Mais chaque fois que des islamistes contestent l’autoritarisme et critiquent l’alliance américano-saoudienne, les Al-Saoud ont recours à des tactiques plus violentes.
La répression des années 1990 a sans doute contribué à la radicalisation de certains secteurs marginaux de l’islamisme, à la création d’Al-Qaida ainsi qu’à une escalade de la violence dans la région et dans le monde. La guerre contre la terreur dans sa version saoudienne a été accompagnée dans les années 2000 par certaines réformes limitées, dont l’introduction de ces élections municipales. Or ces ouvertures très contrôlées n’ont pas modifié fondamentalement la formule du pouvoir. Et les lois de 2014 sur le terrorisme ont étendu la définition de celui-ci pour inclure toute contestation pacifique, toute parole politique et toute action organisée. L’État saoudien conserve entre ses mains les pleins pouvoirs, qui lui permettent d’écraser toute protestation et toute critique, si paisible ou si constructive soient-elles.
L’arrivée au pouvoir en 2015 du roi Salman n’augure rien de bon quant à l’avenir politique, qui semble plus sombre que jamais. Son prédécesseur, le roi Abdallah était à l’origine des réformes — très limitées — des années 2000 (il a également été l’architecte principal de la guerre contre la terreur version saoudienne). À la différence de celui-ci, le roi Salman est resté muet sur les réformes politiques. Sa « Vision saoudienne 2030 » présentée en 2016 préconise l’austérité, la diversification économique et la privatisation des services publics. Elle promet aussi davantage d’emplois et de divertissements. En l’absence de toute réforme politique et à mesure que diminuent les dépenses publiques, la répression policière demeurera l’alpha et l’oméga du système politique saoudien. Moins que jamais, les Al Saoud pourront prétendre être de « vrais démocrates » dans ce pays.