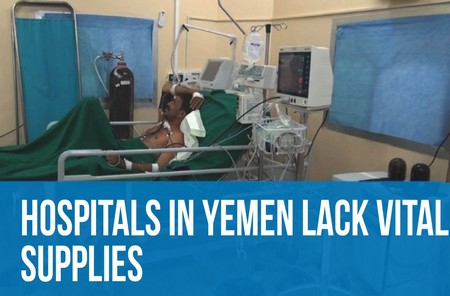Entretien avec Majd al-Dik
En mai 2017, deux quartiers de Damas (Qaboun et Barzeh) ont été repris par le régime syrien et les habitants déportés. Par conséquent le siège s’est accru dans la banlieue de Damas, sur la Ghouta Est, et ses habitants sont à leur tour menacés de déportation. Ces déportations s’accompagnent entre autres d’une destruction du tissu social et de la vie civile, soit avec les conseils locaux d’organisation de la survie, les structures associatives, médicales, éducatives.
Bombardés par le régime de Assad, assiégés depuis 2013, de nombreux civils syriens de la banlieue Est de Damas (la Ghouta orientale, entre 350’000 et 400’000 habitant·e·s) cherchent à organiser «la vie au quotidien». Parmi eux Majd al-Dik, qui a grandi dans la Ghouta et a pris part à la révolution syrienne, a fondé des centres éducatifs comme Nabea El-Hayat (Source de vie). Il continue de s’occuper aujourd’hui, depuis la France, de l’appui à ces centres qui offrent un soutien psycho-social aux enfants. Cet entretien témoigne d’un aspect de la lutte pour la vie dans la Ghouta. Il a été publié dans le n° 9 de la revue de l’Emancipation syndicale et pédagogique. L’entretien a été effectué par Laure Jinquot. La traduction a été assurée part Luiza Toscane. (Avril 2017)
Comment t’est venue l’idée de fonder un centre éducatif et psychologique?
Majd al-Dik: En 2007, j’ai travaillé pour le projet “Child Friendly Spaces”, mené par le Croissant-Rouge et l’Unicef à destination des enfants irakiens réfugiés en Syrie. Avec la révolution syrienne, la répression et les bombardements, j’ai vu que ce qui se passait avec les enfants syriens, c’était comme ce qui se passait avec les enfants irakiens.
On a eu ce rêve de développer un projet éducatif, mais pas comme l’éducation officielle sous la dictature de Assad, un projet alternatif. Les écoles avaient souffert de deux choses : les bombardements et les salaires qui n’étaient plus payés aux instituteurs.
Le premier centre a ouvert en 2013. Au début, il ne devait être que provisoire. Aujourd’hui Nabea El-Hayat a neuf centres pour enfants. En parallèle à l’enseignement, nous avons mis en place un soutien psychologique et une aide alimentaire pour les enfants.
Comment s’organise la journée pour les enfants?
Majd al-Dik: Les enfants arrivent à 9h. Quand tous sont à la porte du centre, nous regardons s’il y a des avions ou non, nous évaluons si la situation est dangereuse pour que, si besoin, les enfants puissent repartir. Mais l’école est en général plus sûre que les maisons. Il y a trois ou quatre jours, il y a eu 90 survols d’avions dans la journée. On faisait chanter les enfants pour qu’ils n’entendent pas le bruit des avions.
La matinée commence toujours par une activité avec des jeux, pour que les enfants oublient, afin qu’ils puissent ensuite se concentrer. De façon générale, l’enseignement n’est pas traditionnel, il y a toujours une part de jeu qui y est intégrée. Il y a des jeux, beaucoup de jeux collectifs, de la musique, des activités poétiques quotidiennes. L’objectif est de voir les enfants heureux, pour casser la routine quotidienne de la mort.
Après manger, il y a une autre séance pour que les enfants révisent ce qu’ils ont fait dans la journée. Puis nous attendons que les parents viennent chercher leurs enfants. C’est là que nous rencontrons le plus de problèmes, nous sommes souvent obligés de ramener les enfants chez eux. Si un enfant est absent, nous voulons savoir pourquoi, nous nous sentons une responsabilité. Un matin, un enfant était absent, il avait été tué chez lui à cause d’un bombardement d’avion.
Le repas du midi est préparé sur place?
Majd al-Dik: Non, nous avons une cuisine centrale dans le Ghouta, dans laquelle dix adultes travaillent. Ils achètent la nourriture, préparent les repas. Puis les voitures amènent les repas dans chacun des neuf centres. Il y a souvent des problèmes pour circuler, à cause des bombardements. Il y a aussi des problèmes pour trouver et acheter de la nourriture à cause du siège.
A 9h, des enfants arrivent avec la tête qui tourne à cause de la faim, car ils n’ont rien à manger chez eux. C’est pourquoi aussi le matin, dans les centres, nous leur donnons un petit en-cas.
Comment s’organisent les sessions?
Majd al-Dik: Au début les sessions étaient de trois mois, mais ce n’était pas assez important pour arriver à mettre en place un suivi psychologique. Aujourd’hui, les sessions vont de quatre mois et demi à un an. Sur les neuf centres, quatre prennent en charge les petits, de quatre à six ans, et cinq écoles prennent en charge les plus grands, de sept et huit ans. Dans les deux types de centres, il y a un soutien psychologique. Chaque centre accueille 150 à 170 enfants, pour chaque session, et cela six jours sur sept.
Les parents remplissent une fiche au moment de l’inscription pour qu’on sache qui est l’enfant. Des enfants amenés ont parfois un lourd handicap (comme des enfants sourds, à cause des bombardements, ou comme des enfants nécessitant la pose d’une prothèse). Se pose alors la question de savoir s’il faut d’abord accueillir l’enfant dans une structure d’enseignement ou d’abord le soigner. Après l’attaque chimique d’août 2013, de nombreux enfants étaient orphelins et avaient besoin d’adultes qui jouent le rôle de parent. D’autres associations prennent en charge les enfants blessés mais elles ont peu de moyens et sont aussi débordées. Nous nous sentons impuissants face à ces handicaps.
En début de session, lors de la première période, toutes les activités sont collectives. Puis nous évaluons les enfants pour voir comment ils se comportent. Par exemple quelle est leur réaction à un bombardement: est-ce qu’ils cherchent à se réfugier à l’intérieur ou non? Puis, dans la deuxième période, nous adaptons les activités à l’état de l’enfant.
Le soutien psychologique les aide, mais les enfants, quand ils rentrent chez eux, voient du sang dans la rue tous les jours. Nous travaillons au quotidien, mais la cause du problème est là au quotidien.
Les centres présentent-ils des aménagements spécifiques?
Majd al-Dik: Les centres sont localisés dans les sous-sols d’immeubles, pour qu’ils soient protégés des bombardements. En 2011, l’État a commencé à couper plusieurs fois par semaine l’accès à l’eau, l’électricité, le gaz et l’accès à internet. En 2012, les coupures ont été définitives. Pour obtenir l’électricité, la méthode alternative mise en place est l’utilisation de générateurs. Mais cela nécessite d’importer du diesel, ce qui coûte cher. Dans les centres éducatifs, nous obtenons de l’électricité grâce à des panneaux solaires. Mais l’éclairage est parfois insuffisant.
Les locaux que nous occupons sont soit prêtés par le Conseil local des villes soit loués à des particuliers. Les centres sont localisés dans huit villes de la Ghouta orientale contrôlées par différentes forces (l’Armée Syrienne Libre et Jaish al-Islam [qui parfois s’affrontent – réd. A l’Encontre]).
Comment se répartit le personnel?
Majd al-Dik: Par centre, pour 150-170 enfants environ, on compte: une directrice, quatre institutrices, quatre animatrices (pour les activités), deux personnes pour le nettoyage, une personne pour les menus travaux (réparation,…), une personne formée aux premiers secours. Il y a également un photographe, qui travaille sur plusieurs centres. Les réunions d’équipe sont quotidiennes.
Une partie du matériel utilisé est celui qui était présent avant la mise en place du siège. Nous fabriquons aussi du mobilier (chaises, tables, tableaux…) et pouvons faire rentrer du petit matériel (stylos, livres…) par des tunnels, au niveau de points de passages. Depuis un mois, les tunnels sont fermés, le régime ayant bombardé nombre d’entre eux. Par conséquent, les taxes prélevées aux points de passage d’entrée du siège ont augmenté de 3% à 12%.
Les salaires perçus par le personnel sont obtenus grâce à des ONG. Ces ONG, souvent internationales, passent des accords avec nous. Nous devons, en contrepartie, constituer une documentation sur ce que nous faisons.
Aujourd’hui, nous avons trois bailleurs pour tous les centres. A chaque fois se pose la question de comment on va arriver à financer ces activités. Parfois, les financements durent trois mois, parfois un an. Le financement d’un de nos centres va s’arrêter en juin. Mon rôle est de chercher les financements. C’est le devoir du monde de protéger cette société civile.
Nabea El-Hayat prend part à d’autres aspects de la vie civile, en plus des centres éducatifs?
Majd al-Dik: En plus des neuf centres pour enfants, nous avons cinq centres délivrant une formation professionnelle pour les femmes: premiers secours, couture, informatique, langue, gestion de la maison en cas de blocus. Il y a environ 125 femmes par centre. Comme dans les centres pour enfants, tout est gratuit.
Nous distribuons aussi des chèvres, à raison de quatre par famille. Ceci permet de produire du lait et maintenir une activité économique pour certaines familles. Depuis octobre 2016, nous louons des terres où sont cultivés du blé, du maïs et des légumes. Une quarantaine de personnes travaillent ces terres puis distribuent les récoltes aux familles, gratuitement toujours.
Au total, il y a 185 personnes qui travaillent dans la Ghouta orientale dans les centres éducatifs, dans les centres pour femmes et dans l’agriculture. (Avril 2017)