

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.


Le 14 juillet 1953, une manifestation anticoloniale - appelée par le MTLD (Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques) fondé par Messali Hadj, la CGT et le PCF - était réprimée dans le sang. 6 jeunes ouvriers algériens et un métallurgiste français, syndicaliste CGT, furent tués par balles, pour avoir revendiqué la fin du colonialisme et l'indépendance de l'Algérie.
Dans ce texte, extrait de son livre La police parisienne et les Algériens (Nouveau Monde Editions, 2011), Emmanuel Blanchard revient sur ce massacre occulté et nous permet non seulement d'honorer la mémoire de ceux et celles qui, au péril de leur vie, combattirent le colonialisme et ses horreurs, mais aussi de souligner la continuité entre la violence de la répression coloniale et la harcèlement policier dont sont l'objet les descendant·e·s de colonisé·e·s aujourd'hui - y compris sous la forme de crimes presque toujours impunis.
On pourra également visionner le documentaire de Daniel Kupferstein et consulter le livre de Maurice Rajsfus : 1953 : un 14 juillet sanglant (Agnès Viénot éditions).
Les circonstances de la répression de la manifestation du 14 juillet 1953 ne sont pas encore exactement connues. Les lacunes de l’historiographie se mêlent aux méandres de la mémoire faisant que cet événement reste aujourd’hui encore « porté disparu » : il s’agissait pourtant de la première fois depuis 1937 que la police parisienne faisait mortellement feu sur des manifestants. Le fait que cette répression ait visé les membres du PPA-MTLD qui, quelques mois plus tard, allait connaître une scission qui conduit à l’émergence du FLN, aux prétentions hégémoniques, explique en grande partie que les sept victimes de ce « massacre d’État »1, n’aient jamais véritablement été commémorées, ni en France, ni en Algérie.
Le « mensonge d’État » érigé en mode de légitimation de l’action des forces de l’ordre n’a par ailleurs pas empêché que la vérité, notamment judiciaire, soit faite sur une répression dont le bilan (sept morts2) fut cependant immédiatement connu des contemporains. Si cette « tuerie politique » ne fit pas véritablement événement, c’est aussi parce qu’elle intervint à un moment où ces formes de maintien de l’ordre étaient monnaie courante dans l’empire et qu’elle fut par la suite occultée par le déclenchement de la guerre d’indépendance algérienne. Enfin, dans les décennies suivantes, la lente constitution du massacre du 17 octobre 1961 en « lieu de mémoire » n’a pas été intégrée à une séquence longue de la répression policière et des résistances algériennes aux forces de l’ordre.[...]

Résistances et maintien de l’ordre en contexte colonial
[...] Au Maroc, après l’écrasement des manifestations de Casablanca les 7 et 8 décembre 1952, qui fit des centaines de victimes, le gouverneur général Guillaume avait interdit l’Istiqlal, le parti nationaliste. Il manoeuvra ensuite de longs mois pour réduire à néant le pouvoir du sultan Mohammed V, qui fut déposé le 20 août 1953. La radicalisation terroriste d’une partie des nationalistes, les ratissages policiers, l’implication des forces de l’ordre dans les attentats « contre-terroristes » faisaient qu’en cette année 1953, le Maroc était en proie à une véritable lutte armée. Depuis février 1952 et le déploiement de troupes coloniales au cap Bon, la Tunisie était également aux prises avec le « fellaguisme », les actions armées et les violences de polices particulièrement actives dans les organisations « contre-terroristes » telle la « Main rouge ». La presse parisienne – dont les quotidiens populaires – relaya abondamment ces épisodes et l’implication des forces de l’ordre : le fait que tant en Tunisie qu’au Maroc, les manifestations politiques et syndicales donnaient l’occasion aux forces de l’’ordre d’ouvrir le feu était relaté par certains journaux et apparaissait ainsi que dans d’autres empires coloniaux, comme la seule façon de tenir l’ordre. La plupart des gardiens de la paix savaient donc qu’une partie des indépendantistes d’Afrique du Nord avaient fait le choix de passer au stade de la lutte armée et que les tutelles politiques des protectorats étaient prêtes à utiliser tous les moyens pour préserver l’ordre colonial et éviter que le scénario indochinois ne se répète. [...]
La manifestation et la répression du 14 juillet 1953
[...] Des consignes de discrétion avaient été données aux forces de l’ordre qui, pour la plupart, n’étaient pas visibles des manifestants. La circulaire officielle rappelait pourtant la fermeté attendue en cas de transgression des limites imposées aux organisateurs de la manifestation :
Aucune banderole ou pancarte, dont l’inscription (en langue française ou étrangère) aurait un caractère injurieux tant à l’égard du gouvernement ou de ses représentants que d’un gouvernement étranger ou de ses représentants, ne pourra être portée par les manifestants.
Aucun cri ou aucun chant séditieux ne devront être prononcés3.
[...] Jusqu’à la place de la Nation, il n’y eut pas d’accrochages avec les forces de l’ordre, mais les manifestants furent attaqués par des parachutistes retour d’Indochine en permission à Paris. Ces derniers, après quelques escarmouches à l’entrée du faubourg Saint-Antoine avec des membres du PCF, avec qui ils se coltinèrent à nouveau en soirée, se heurtèrent aux militants du PPA-MTLD. La bagarre dura une vingtaine de minutes et tourna à l’avantage des Algériens. Six parachutistes ayant participé à échauffourées furent emmenés dans les hôpitaux avoisinants. Les autres soldats impliqués furent reconduits à leur cantonnement de la porte de Versailles par des cars de police. [...]
C’est à partir de 17 heures et sur la place de la Nation que la journée prit un tour dramatique. Les archives de police consultées laissent transparaître le caractère subit et imprévu de l’événement, ainsi que la volonté ultérieure d’en donner une interprétation qui dédouane les forces de l’ordre. Dès la dispersion définitive de la manifestation, les rapports des différents commissaires de police engagés dans ce maintien de l’ordre privilégièrent « l’interprétation émeutière délibérée »4. Ils tentèrent d’accréditer la thèse de la légitime défense que tous les échelons hiérarchiques la préfecture de police souhaitaient imposer. [...]
Deux éléments sont avérés : la réaction des Algériens fut extrêmement vive et les forces de l’ordre ouvrirent le feu sans sommation dès les premiers engagements, sans qu’on puisse déterminer lequel de ces événements détermina l’autre.
Jusqu’à 17 h 30, sous une pluie battante qui contribua à augmenter la confusion, la place de la Nation, abandonnée par les organisateurs du défilé qui avaient quitté la tribune officielle, fut transformée en champ de bataille. Environ 2 000 Algériens, épaulés par quelques manifestants métropolitains – l’immense majorité d’entre eux s’étaient déjà dispersés ou avaient reflué3 –, prirent un temps le dessus sur les forces de l’ordre. Les barrières en bois installées place de la Nation à la demande des organisateurs furent brisées et servirent de projectiles ou de matraques, une vingtaine de véhicules de police furent endommagés dont au moins deux incendiés. Dans l’attente de renforts, les forces de l’ordre massées dans le cours de Vincennes se replièrent dans les rues adjacentes. Ces renforts arrivèrent principalement des boulevards de Charonne et de Bel Air. Ils prirent les manifestants à revers dans une manœuvre dont on peut imaginer la violence réciproque. Ils réussirent à traverser une place de la Nation jonchée de débris et de corps de manifestants tués ou blessés par des tirs qui furent particulièrement nombreux et nourris. À 17 h 30, le calme était revenu et à 18 heures, la place de la Nation était dégagée. Des groupes de gardiens continuaient cependant de poursuivre, notamment grâce aux informations de passants, les manifestants, souvent blessés, qui étaient allés se réfugier dans des immeubles des rues adjacentes.
Le bilan humain laisse peu de doute quant à l’usage différencié de la force par les deux groupes en présence : d’après le bilan officiel de Ia préfecture de police, au vu des blessures déclarées – 16 gardiens furent hospitalisés à la suite de la manifestation, une cinquantaine « cessèrent le service »– l’immense majorité des Algériens étaient armés des seules « armes par destination » que constituèrent les manches de banderoles et les barrières cassées. Entre trois et cinq gardiens furent cependant superficiellement blessés par des « objets tranchants », sans doute des couteaux. Si cette arme avait été aussi massivement employée que le suggèrent certains rapports, le bilan aurait été tout autre. [...] Il reste qu’une dizaine de gardiens furent grièvement blessés – un fut trépané –, victimes de traumatismes crâniens et faciaux, occasionnés par la violence de coups répétés portés par les manifestants à l’aide d’objets les plus divers (morceaux de ciments, etc.).
Du côté des manifestants, le lourd bilan des blessés (50 dont 44 Algériens, d’après les états de la préfecture de police) est sans doute très largement sous-estimé : certains médecins hospitaliers étaient réticents à répondre aux injonctions de la préfecture de police et des blessés préférèrent ne pas se rendre dans les hôpitaux plutôt que de risquer d’y être arrêtés. Les sept morts et les 40 blessés par balles recensés témoignent cependant de l’usage massif des armes par les forces de l’ordre. [...]
« Mensonge d’État » et contournement de l’arène judiciaire
Cette thèse de la légitime défense s’était initialement appuyée sur des témoignages arguant que les Algériens étaient les premiers à avoir ouvert le feu. Mais même dans une institution rompue à la fabrique du mensonge, cette mise en cause, qui ne pouvait s’appuyer sur aucun élément matériel et tranchait par trop avec ce qu’avaient vu des milliers de témoins, fut abandonnée. Dans le débat public, les Algériens ne furent pas accusés d’avoir utilisé des armes à feu. La mise en cause sur ce point resta métaphorique : « Si leurs yeux avaient été des mitraillettes, nous aurions été tués » fut ainsi la formule reprise par le ministre de l’Intérieur citant un des gardiens engagés ce jour-là5.
Comme ils ne pouvaient pas justifier la violence policière par un usage réciproque des armes à feu, le ministre de l’Intérieur et les hauts dirigeants de la préfecture de police se replièrent sur les régimes de justification rhétorique habituellement utilisés. La police parisienne avait dû faire face à une « émeute » et s’opposer à ce que Léon Martinaud-Déplat, ministre de l’Intérieur qualifiait de :
[...] foule déchaînée, une foule qui, prise de cette fièvre que le déclenchement d’une bagarre provoque toujours, était capable de mettre à mort les quelques policiers qui n’avaient pas pu rejoindre leurs camarades et leurs chefs6.
Cette intervention devant la chambre des députés, fondée sur les rapports de la préfecture de police, est un véritable modèle de « mensonge d’État » : le ministre de l’Intérieur commença ainsi par dire que toutes les pancartes et les calicots avaient été interdits ; insista, en dépit des bilans médicaux disponibles, sur le fait que de nombreux Algériens usèrent de couteaux ; il aggrava sciemment les blessures de ses agents et ne cessa de se référer à des preuves photographiques que nul ne vit et qui ne figurent pas dans les dossiers d’archives. [...]
Les manifestants algériens [...] étaient décrits par certains observateurs comme sous l’emprise d’un « fanatisme politique exaspéré (sic) » ou de la :
« Nefra », [cette] brusque flambée de brutalité sanguinaire. Une sorte de folie collective s’empare de la foule excitée par des cris et des chants (dans la circonstance c’était le slogan : « libérez Messali Hadj »). Si les agents qui étaient en situation manifeste d’infériorité numérique, puisqu’ils ont dû se replier, n’avaient pas fait usage de leurs armes, ils auraient été lapidés et matraqués l’un après l’autre. Il s’agit [...] d’une explosion de fanatisme maghrébin qui a placé la force publique en état de légitime défense7.
Les spécialistes du maintien de l’ordre colonial mobilisaient ainsi des notions forgées outre-mer pour justifier une intervention policière place de la Nation, intervention dont les modalités étaient effectivement très proches de celles alors utilisées pour mettre fin aux cortèges revendicatifs et aux manifestations violentes des colonisés au Maroc et en Tunisie.
Alors que depuis la Libération la police parisienne n’utilisait jamais les armes pour disperser les cortèges, même interdits, les sept morts du 14 juillet 1953 n’occasionnèrent pas véritablement de remous internes. Même le principal syndicat des gardiens, le Syndicat général de la police parisienne (SGP), passa sous silence ces victimes. [...]
Le ministère de l’Intérieur s’en tint au récit forgé par la préfecture de police qui cherchait avant tout à camoufler les défaillances de ses cadres En effet, il semble que les gardiens avaient échappé à l’autorité de leur chefs. Ils ont tiré sans que l’ordre leur en ait été donné, mais ils savaient pertinemment que la hiérarchie n’aurait pas d’autre solution que de les couvrir. Cette interprétation qui ne dédouane en rien un commandement qui fut tout à la fois incompétent et complice, est en tout cas suggérée par plusieurs documents d’archives. Ce témoignage d’un commissaire, qui reflète certes plus ses propres opinions que celles qu’il prête aux gardiens de la paix, est particulièrement édifiant sur la manière dont certains policiers parisiens percevaient les manifestants algériens :
[...] [les gardiens de la paix] affirment que si les parlementaires ont accordé la qualité de citoyens français aux Nord-africains, ils ne se sont pas inquiétés des répercussions de cette décision. Aucune restriction, aucune réglementation n’est venue tempérer chez ces inadaptés le droit incontestable qu’ils ont dans la métropole de vivre et de circuler selon leur bon plaisir. Il résulte de cette liberté inconsidérée accordée à des hommes frustres, illettrés, primitifs, facilement accessibles à des promesses démagogiques de multiples incidents, plusieurs fois quotidiens, souvent graves, que les gardiens de la paix, et eux seuls, sont appelés à résoudre [...]8.
[...]Les réponses apportées à l’usage des armes par les gardiens de la paix et la manière dont furent diligentées les enquêtes judiciaires et internes – aucune sanction ne fut prononcée – ne pouvait que conforter les policiers parisiens dans leur volonté de régler par la violence le « problème nord-africain ». Devant les députés, Léon Martinaud-Déplat avait affirmé que l’enquête judiciaire permettrait de faire la lumière sur les événements. Or, il savait pertinemment que les juges étaient enfermés dans le cadre procédural, ainsi que par le récit de l’événement donné par les rapports internes de la police parisienne.
En effet, dès le 15 juillet, afin d’éviter toute enquête parlementaire9, les pouvoirs publics portèrent plainte contre X et demandèrent l’ouverture d’une information sur les événements de la veille. Le juge d’instruction n’enquêta donc pas sur les tirs policiers mais sur des faits de « rébellion » et de « violences envers des dépositaires de la force publique ». Ce n’est qu’en septembre 1953, suite à la constitution comme partie civile de trois membres de famille de victimes représentés par Pierre Stibbe10, que la saisine du juge d’instruction Jaurès, fut élargie et qu’il put « enquêter » sur la mort des sept manifestants. Dans les faits, même s’il entendit quelques témoins Algériens, il se contenta des éléments fournis par la préfecture de police. L’ordonnance de non-lieu rendue le 22 octobre 1957 par le juge Soulet se contentait de reprendre les réquisitions écrites du procureur général et fut confirmée en appel le 23 janvier 195811. [...]
C’est donc l’interprétation policière des événements et de la juste répression d’une émeute violente qui s’imposa après le 14 juillet 1953. Dans les jours qui suivirent la tuerie de la place de la Nation, les RG de la préfecture de police n’eurent même de cesse de mettre en garde contre de nouvelles « violences » et « vengeances » des nationalistes algériens. [...]
Ces mises en garde récurrentes, démenties tant par les RG de la Sûreté nationale que par la suite des événements, ne pouvaient que contribuer à renforcer le sentiment de défiance, voire de haine, d’une partie de la base policière à l’encontre des Algériens. Dans les heures et jours qui suivirent la manifestation, les descentes de police à la Goutte d’Or furent l’occasion d’assouvir ces sentiments, dans un quartier emblématique des résistances algériennes aux contrôles et répressions policières.
http://www.contretemps.eu/interventions/14-juillet-1953-répression-coloniale-massacre

http://www.france-palestine.org/Cent-ans-apres-les-accords-Sykes-Picot-L-Orient-arabe-trahi
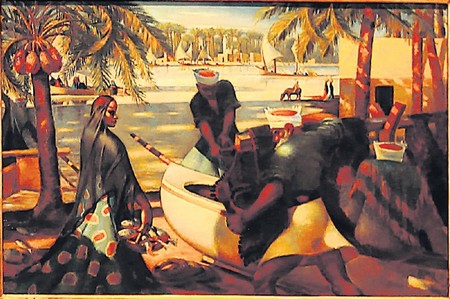
Le texte qui suit est la première partie d’un article publié dans l’ouvrage collectif Le Moyen-Orient en marche : perspectives croisées, qui vient de paraître aux éditions du Cygne. À la fin de l’extrait, on trouvera le sommaire du livre.
Depuis la défaite de juin 1967 et avec le déclin du nationalisme arabe, la Palestine a souvent été considérée comme le dernier bastion (ou l’avant-garde) de la lutte anti-impérialiste et anti-sioniste au Moyen-Orient. La résistance maintenue des Palestiniens à l’occupation et à la colonisation israéliennes, de la lutte armée des années 1970 aux initiatives dites de « résistance populaire » (à partir de 2005), en passant par la première Intifada (décembre 1987), a longtemps servi de point de référence aux peuples de la région, orphelins des idéaux nassériens et/ou panarabes.
Les bouleversements que traverse aujourd’hui le monde arabe interrogent cette approche « classique », selon laquelle les populations de la région accusaient un considérable « retard » sur les Palestiniens, ces derniers étant les seuls à avoir échappé au processus de glaciation politique et sociale entamé dans les années 1970. Certains en étaient même allés jusqu’à considérer que le monde arabe n’était plus un acteur de l’Histoire. Un éditorial du Monde expliquait encore, le 19 mars 2011, au sujet de l’expédition militaire en préparation en Libye, ceci : « Il faut associer le monde arabe aux opérations militaires. Il en a les moyens : il dispose de centaines de chasseurs. Il a l’occasion de faire l’Histoire, pas de la contempler » [1].
Sans tomber dans les excès de l’éditorialiste – anonyme – du Monde, force est de constater que le combat palestinien a longtemps joué un rôle de lutte « par procuration » pour des populations dont les dirigeants avaient depuis longtemps abandonné les idéaux nationalistes. Or, depuis quelques mois, ce n’est plus tant le monde arabe qui « regarde » vers la Palestine, mais bien souvent le peuple palestinien qui « regarde » vers le monde arabe : de même que, par exemple, les bombardements sur Gaza en 2008-2009 avaient fait la « Une » des journaux arabes et généré un élan de solidarité avec la population de Gaza dans toute la région, la chute de Ben Ali, puis de Moubarak, ont occupé la « Une » des médias palestiniens et ont suscité chez les habitants des territoires occupés la sympathie, pour ne pas dire l’admiration, à l’égard des peuples tunisien et égyptien.
Cette sympathie n’est pas seulement à appréhender du point de vue de la « solidarité internationale ». Elles expriment en réalité ce que l’échec des idéologies panarabes avait en partie occulté : la conscience d’une communauté de destin chez les peuples de la région, en raison notamment d’une histoire coloniale et postcoloniale commune, quand bien même les récentes histoires nationales auraient divergé. La singularité de la situation palestinienne et sa surexposition politique et médiatique lui ont conféré une place particulière dans les processus d’identification régionaux. Le renversement que nous venons d’évoquer confirme ce phénomène qui traduisait, en premier lieu, l’aspiration maintenue des peuples de la région à plus de dignité, de justice et de libertés. Avec l’irruption visible des peuples arabes sur la scène politique, les Palestiniens sortent de l’isolement, et semblent en avoir conscience.
S’agit-il pour autant d’un réel renversement de perspective ? En d’autres termes, les bouleversements en cours peuvent-ils contribuer à ce qu’une reconfiguration de la question palestinienne s’opère ? C’est à ces questions que je tenterai de répondre dans cette étude, en trois temps : tout d’abord, en rappelant que la question de Palestine fut, après la création de l’État d’Israël, une question arabe ; ensuite, il conviendra d’interroger l’autonomisation progressive de la question palestinienne avant, dans un dernier temps, de mesurer les premiers effets visibles, sur la scène palestinienne, du processus révolutionnaire en cours.
L’histoire récente nous fait souvent oublier que la question palestinienne (lutte pour la satisfaction des droits nationaux des Palestiniens) a d’abord été la question « de Palestine » (lutte pour la libération de la terre de Palestine) et, à ce titre, une question arabe. Les États arabes ont refusé la partition de 1947 et plusieurs d’entre eux ont été en guerre contre Israël à 3 reprises (1948, 1967, 1973). Lorsqu’en 1964 la Ligue des États Arabes soutient la création de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), ce n’est pas tant pour permettre aux Palestiniens de se doter de leur propre représentation que pour réaffirmer le leadership des États arabes pour tout ce qui touche à la question de Palestine.
Le premier Conseil National Palestinien (CNP, « parlement » de l’OLP), se réunit à Jérusalem en mai 1964 sous l’étroite surveillance des régimes arabes, notamment de l’Égypte et de la Jordanie. Ahmad Choukeyri, à la tête du premier Comité Exécutif de l’OLP (CEOLP), est une personnalité relativement consensuelle auprès des régimes arabes, qui précise, dans son discours inaugural, ce qui suit : « la création de l’entité palestinienne dans la cité de Jérusalem ne signifie pas que la rive occidentale du Jourdain fasse sécession de la Jordanie. Nous voulons libérer notre patrie qui s’étend plus loin, à l’Ouest. En aucune façon nous ne menaçons la souveraineté jordanienne car cette terre a été, tout au long de l’Histoire, le refuge d’une même nation et n’a formé qu’une seule patrie » [2]. Une véritable lutte s’est déroulée, dans les années 60, pour que la question de Palestine soit prise en charge par les Palestiniens eux-mêmes. Ce fut la raison d’être du Fatah, fondé en 1959. Les fondateurs du Fatah en effet déduisent de la débâcle de 1948 et de l’incapacité des régimes arabes à libérer la Palestine, la nécessité d’une prise en charge autonome de la question palestinienne. C’est ce que certains ont nommé la « palestinisation » de la lutte [3], qu’on entendra ici comme le projet de réappropriation par les Palestiniens eux-mêmes d’une cause considérée comme confisquée par les régimes arabes. Pour le noyau dirigeant du Fatah, les États arabes sont incapables de mener à bien la lutte pour la reconquête de la Palestine car ils la subordonnent à leurs intérêts et objectifs propres et l’ont, de fait, reléguée au second plan.
Le Fatah récuse le mot d’ordre en vogue dans les milieux panarabes : « l’unité arabe conduira à la libération de la Palestine ». Ils rendent même responsables les régimes arabes de la défaite de 1948, affirmant par exemple que l’intervention des armées arabes « a échoué car les états arabes ont écarté les forces vives palestiniennes de la bataille en suspendant leurs activités armées révolutionnaires » [4]. Dans la rhétorique du Fatah, la prise en charge de la question palestinienne par les régimes arabes n’est donc pas seulement une erreur, mais un obstacle à la libération de la Palestine. D’où la nécessité d’établir un mouvement palestinien autonome, émancipé de toute tutelle arabe, avec ses propres structures, son propre programme, sa propre direction et ses propres instances de décision. La défaite de juin 1967 donne un écho conséquent au discours du Fatah, qui prendra le contrôle de l’OLP en 1968-69 autour du mot d’ordre de la palestinisation. La guerre de 1973, par laquelle les États arabes indiquent qu’ils n’entendent plus reconquérir militairement la Palestine, confortera les positions du Fatah et le processus de palestinisation qui accompagne la désarabisation du combat pour la Palestine. En effet, l’autonomie acquise par le mouvement national palestinien est aussi le reflet du désengagement des États arabes dans le combat contre Israël, facteur déterminant de la glaciation politique régionale a partir des années 1970.
Une autonomie palestinienne relative
L’autonomie ainsi acquise est cependant à relativiser. Tout d’abord, le Fatah (et l’OLP) sont dépendantes financièrement des régimes arabes. Dès le début des années 1960, le mouvement de Yasser Arafat, qui prônait la lutte armée, a frappé aux portes des argentiers arabes : en 1962, Abu Jihad se rend en Algérie où il rencontre les dirigeants du FLN qui l’assurent de leurs dispositions à soutenir le Fatah. La Syrie et l’Iraq baathistes accepteront eux aussi d’apporter un soutien matériel au mouvement et d’héberger des camps d’entraînement. Le Fatah entend jouer sur les contradictions internes au monde arabe en s’appuyant, dans le cas de l’Iraq et de la Syrie, sur des régimes en compétition avec l’Égypte nassérienne, a fortiori depuis l’échec de la République Arabe Unie. Cette politique conduira Yasser Arafat à solliciter certains de ses proches pour qu’ils recherchent le soutien financier de l’Arabie Saoudite. En 1964, le leader du Fatah missionne Khalid al-Hassan pour établir un contact direct avec les autorités saoudiennes, en l’occurrence le ministre du Pétrole Ahmad Zaki Yamani. Ce dernier organisera une entrevue entre Arafat et le Roi Faysal, qui offrira une somme d’argent considérable au Fatah.
Dépendant des financements et du soutien matériel étrangers, notamment arabes, le mouvement se place dans une situation doublement contradictoire avec sa revendication d’autonomie. En premier lieu, le soutien matériel est subordonné aux jeux d’alliances régionaux : la fragilité de ces alliances place le Fatah dans une situation de précarité extrême. C’est ainsi que plusieurs décennies plus tard, ce « péché originel » du Fatah aura des répercussions considérables lorsque Yasser Arafat apportera son soutien à Saddam Hussein lors de la première Guerre du Golfe, provoquant une véritable hémorragie financière de l’OLP. En second lieu, les pays « donateurs » exigent d’avoir un droit de regard sur les activités du Fatah. C’est ainsi que l’Iraq, puis la Syrie, préféreront rapidement, après avoir tenté à plusieurs reprises d’interférer dans les affaires internes du Fatah, susciter la création de mouvements « palestiniens » qui leur sont en réalité inféodés, afin de peser au sein de l’OLP.
Un second élément renforce le caractère subalterne de l’autonomie revendiquée par le Fatah (et dont héritera l’OLP) :
c’est le principe de « non-ingérence palestinienne dans les affaires intérieures arabes ». Pensé comme la logique et juste contrepartie de la revendication de l’autonomie du mouvement palestinien et donc de la « non-ingérence arabe dans les affaires intérieures palestiniennes », ce principe s’avère en réalité être, lui aussi, une faiblesse structurelle majeure du Fatah, qui aura de tragiques conséquences, en Jordanie puis au Liban. L’idée de la non-ingérence est en effet doublement paradoxale :
— elle trace un trait d’égalité, avec le principe de réciprocité, entre des entités étatiques constituées et un peuple en exil… dans ces entités. Toute activité politique palestinienne au sein des États abritant des réfugiés peut être considérée par ces États comme une ingérence au sein de leurs affaires intérieures. En revendiquant le principe de non-ingérence, le Fatah offre des arguments à des régimes potentiellement hostiles et s’interdit, a priori, d’influer sur la politique des États dans lesquels vivent la majorité des Palestiniens
— elle sous-entend que les Palestiniens pourraient conquérir une place dans le dispositif étatique arabe sans que celui-ci ne subisse de bouleversement majeur ou, plus précisément, sans que les organisations palestiniennes ne prennent en charge tout ou partie du combat contre des régimes autoritaires, conservateurs, voire réactionnaires. Cette analyse contestable sera source de débats et de tensions avec les futures organisations de la gauche palestinienne.
Le principe de non-ingérence renforce le caractère subalterne, voire contradictoire, de l’autonomie revendiquée par le Fatah. Il indique que, malgré une rhétorique très critique à l’égard des régimes arabes, le mouvement n’entend pas entrer en confrontation directe avec eux. Conscients de leur faiblesse numérique et militaire, les dirigeants du Fatah comptent sur le soutien des États arabes dans la lutte pour la libération de la Palestine. La dépendance à l’égard des États arabes est assumée, elle participe du positionnement paradoxal du Fatah et le l’OLP dans le contexte politique et social régional à partir des années 1970. Ce positionnement paradoxal et le caractère structurellement subalterne de l’autonomie palestinienne marquera durablement le mouvement national palestinien. Si la question de Palestine est progressivement devenue une question palestinienne, elle n’en est pas moins demeurée une question intégrée au dispositif régional. À l’heure où ce dernier est en train de vaciller, rien de surprenant dans le fait que les coordonnées de la question palestinienne soient amenées à être rapidement bouleversées.
Les mouvements de protestation contre les régimes autoritaires qui s’élèvent dans tous les pays arabes donnent à voir un autre visage des mondes arabes jusqu’ici nié dans un amas de clichés nauséabonds. De l’inadéquation supposée entre islam et démocratie, au besoin inventé des peuples arabes d’être dirigés par un leader, ces stéréotypes sont aujourd’hui visiblement balayés par des processus qui ont en réalité mûri depuis le mouvement de la Nahda au XIXe siècle.
Si la métaphore du « printemps arabe » renvoie justement à cette idée d’une renaissance, elle cantonne aussi, le temps d’une saison, un mouvement qui promet de s’étendre sur un temps long. Aussi, parler de « printemps arabe » pour qualifier cette lame de fond semble quelque peu inapproprié. D’autant qu’il ne saurait y avoir un « printemps arabe », mais des « printemps arabes » protéiformes, tributaires de particularismes historiques, de systèmes politiques, de tissus sociaux propres à chacun des pays. D’ailleurs les « printemps arabes » sont loin de n’être qu’arabes... et montrent, à ceux qui en douteraient encore, que le peuple est un acteur politique, économique et social à part entière. Comment s’est construite cette prise de conscience et sur quels particularismes repose-t-elle ?
En abordant ce phénomène dans ces aspects juridiques, historiques, politiques, économiques et sociaux, ce cahier — qui s’inscrit dans une série de trois opus consacrée aux révolutions arabes — propose quelques études de cas réalisées à chaud.
Qu’elles soient entamées, maîtrisées, ou figées, ces révolutions promettent, avec des temporalités et selon des modalités différentes, des bouleversements structurels majeurs que tous doivent désormais intégrer dans leur appréhension de la région. Le Moyen-Orient, jusqu’ici perçu comme une région sclérosée, est bel et bien en marche...
L’ouvrage peut être commandé par votre libraire ; il est également disponible sur les divers sites internet de vente de livres.
Ali la Pointe, de son vrai nom Ali Amar, est né le 14 mai 1930 – année où la puissance coloniale célébrait en grande pompe le centenaire de sa présence en Algérie – au lieu dit El Annassers, un quartier situé au milieu des vergers, dans la partie basse de la ville de Miliana.
Le sobriquet «La Pointe» dont a été affublé Ali Amar ne tire pas son origine de la Pointe Pescade (actuellement Rais Hamidou), une localité côtière située à la périphérie d’Alger, contrairement à ce que croient beaucoup d’Algériens, mais de la Pointe des Blagueurs, une esplanade située à l’extrémité sud de la ville des Cerises, qui offre une vue imprenable sur la vallée du Chellif, avec en contrebas le quartier des Annassers et ses vergers plantés d’arbres fruitiers, notamment des cerisiers. C’est de cette esplanade qu’Ali la Pointe se sauvait lorsque les gendarmes se mettaient à ses trousses, sûr de lui qu’ils n’avaient aucune chance de le rattraper.
Le jeune Ali eut une enfance très difficile au cours de laquelle la misère a été accentuée par le déclenchement de la Première Guerre mondiale, alors que les Algériens subissaient déjà les affres de la colonisation française. Privé du privilège de suivre des études qui lui auraient permis de gagner sa place dans la société, il n’eut d’autre alternative que de travailler dans des fermes appartenant à des colons afin d’aider sa famille à se nourrir, subissant au passage les pires humiliations, la domination et l’exploitation. Révolté et rebelle, il était animé d’une aversion prononcée contre le système colonial qui régissait l’Algérie et asservissait son peuple. Ali Amar se révoltait à sa manière contre l’injustice que subissait sa famille.
A treize ans, il fait l’objet d’une première condamnation après s’être rebellé contre des gendarmes.
A sa sortie de prison, il se rend à Alger pour y suivre une formation en maçonnerie. Après les cours, il pratique, au Club sportif d’Alger (CSA), son sport préféré : la boxe. Par pour longtemps, car son caractère turbulent et rebelle lui vaut de connaître, à plusieurs reprises, la prison pour divers délits, dont le vol d’effets militaires, coups et blessures volontaires, violence et voie de faits et tentative d’homicide volontaire.
En 1952, il est incarcéré à la prison de Damiette (Médéa) alors qu’il est âgé de 22 ans. Trois années plus tard, le 2 avril 1955, il s’évade en compagnie de l’un de ses compagnons de cellule. Il prend, dans un premier temps, la direction de Blida puis réussit à rallier Alger où il entre en clandestinité. Jusque-là, l’étiquette de malfrat multirécidiviste qui lui collait à la peau va peu à peu s’estomper pour laisser place à celle d’un stratège de la guérilla urbaine, une sorte de «bandit d’honneur», mais qui ne va pas, non plus, atténuer l’inlassable chasse à l’homme dont il faisait l’objet.
Au contraire, la justesse de la lutte qu’il menait lui valut une traque beaucoup plus accentuée de la part des autorités françaises, décidées à l’éliminer, car il commençait à constituer un réel danger pour le maintien de l’Algérie française. C’est à Alger qu’il fait la connaissance de nationalistes algériens qui lui transmettent l’idée et l’esprit de la révolution. Un certain Ahmed Rouibi, dit Ahmed Chaib, le contacte puis le présente à Yacef Saâdi, l’un des chefs de Zone autonome d’Alger (ZAA).
Après plusieurs tests et mises à l’épreuve qui consistaient à mener des missions périlleuses dans la capitale, quadrillée alors par les parachutistes du général Massu, notamment des attentats contre des gendarmes et des traîtres à la cause algérienne, il constitue avec un groupe de fidayîn, dont font partie Hassiba Ben Bouali et Abderrahmane Taleb, un commando de choc qui allait porter le combat au cœur même de l’état-major français.
Après trois années de lutte armée (avril 1955-octobre 1957), Ali La Pointe est repéré le 8 octobre 1957 par les forces armées coloniales dans un immeuble de la Casbah situé au 5, rue des Abderrames. Il sera tué en compagnie de ses frères d’armes de la ZAA, en l’occurrence Mahmoud Bouhamidi, Hassiba Ben Bouali et Omar Yacef, dit P’tit Omar, âgé de douze ans, après que les parachutistes du 3e Régiment étranger de parachutistes (REP), commandé par le colonel Bigeard, eurent dynamité la maison où ils s’étaient réfugiés. Cette action a entraîné l’effondrement d’un immeuble mitoyen qui a causé la mort de 24 autres Algériens, dont 8 enfants. Au moment de sa mort, Ali La Pointe était âgé de 27 ans. L’ensemble de la presse locale de l’époque était revenu sur les faits du 5, rue des Abderrames. L’Echo d’Alger a faussement précisé qu’«Ali La Pointe ne s’est pas fait sauter» avec le stock d’explosifs qu’il détenait mais qu’«il a été attaqué dans son repaire par les parachutistes». Il est incontestable que l’objectif de ces assertions avait clairement pour but de ne pas en faire un martyr afin de ne pas pousser les jeunes Algériens à suivre sa voie.
Zohra Drif, une grande figure de la Bataille d’Alger, apporte son témoignage de ce que fut Ali La Pointe.
«(…) Il avait la puissance, le courage. Les Français avaient très peur de lui (…). Je dois dire que lorsque je pense à l’engagement d’Ali je ne peux m’empêcher d’y voir une sorte de rachat (…). Nous connaissions le passé d’Ali, qui, d’ailleurs, n’était pas proxénète, car lorsqu’il a mené sont combat, on avait l’impression qu’il voulait racheter ses erreurs, rattraper ses égarements.» Pour Mustapha Cherif, Professeur des universités, écrivain, ancien ministre et ambassadeur, né à Miliana,«son courage, sa témérité, sa fidélité, sa conviction de la justesse de la lutte qu’il menait lui permirent de réussir des actions spectaculaires, qu’il accomplissait en plein jour, de par son sang froid exceptionnel (…)
Ce grand héros de la révolution s’était distingué par sa bravoure sans faille aux côtés de nombreux autres héros de la Bataille d’Alger pour libérer la patrie de l’oppression coloniale (…). »
Aujourd’hui, sur la place de Miliana qui porte son nom, une stèle a été érigée à sa mémoire, à l’endroit où, alors enfant à peine âgé de 10 ans, il aimait faire des pieds-de-nez aux gendarmes qui le harcelaient, lui l’enfant qui ne demandait rien d’autre que de seulement vivre les mêmes sensations à l’âge où de petits Français étaient plus avantagés et choyés dans un pays qui n’appartenait ni à leurs parents ni à la République française, mais appartenait bel et bien aux ancêtres de Ali Amar, en l’occurrence l’Emir Abdelkader, Sid Ahmed Benyoucef El Miliani et bien d’autres encore. Abderachid Mefti.

Alain Krivine est un député européen, ancien porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire (Nouveau Parti anticapitaliste).
L’establishment français observe une sorte d’omerta quand il s’agit de dénoncer des biens mal acquis par des dirigeants algériens. Pourquoi ?
Je crois que c’est dû à un problème plus général qui est la France-Afrique et qui structure les rapports avec toutes les anciennes colonies. C’est ce qui fait que tous les dictateurs et les non-démocrates, qui se sont enrichis dans la période post-coloniale, ont tous placé, en partie, leur argent en France, dans l’ancien empire colonial, ont acheté des immeubles, parfois acquis des biens extraordinaires. Le tout exécuté dans un silence complice. La presse en a parlé un peu, mais les gouvernements se sont tus parce qu’il s’agit d’intérêts stratégiques. Et en France, il faudrait compter aussi sur ce sentiment de culpabilité.
C’est cette attitude qu’on retrouve dans le Parti socialiste, aujourd’hui au pouvoir, et qui a été coresponsable de la guerre coloniale, des assassinats et tortures et qui a fait voter les pouvoirs spéciaux. Chez la droite, ce n’est même plus de la culpabilité mais de la connivence. Et quand on a une alternance droite-gauche, alors tout le monde se tait sur ces phénomènes scandaleux d’enrichissement illicite. C’est cette collusion qu’on retrouve ces jours-ci dans cette affaire d’exploitation de gaz de schiste autorisée en Algérie alors qu’elle est proscrite en France.
Levée de boucliers quand il s’agit d’anciennes colonies de l’Afrique subsaharienne ou centrale, omerta et impunité quand il s’agit d’Afrique du Nord : les liens sont-ils aussi forts ?
Les liens sont forts. Il y a un phénomène avec l’Algérie que les Américains par exemple n’ont pas connu avec le Vietnam. Je parlais de culpabilité. Il ne faut pas oublier que le contingent était parti en Algérie. Il y a des milliers, des millions de Françaises et Français qui étaient liés directement à la guerre d’Algérie. Les soldats ont assisté pour la plupart à des scènes de torture, à la différence des soldats américains, ils se sont tus, ont complètement culpabilisé d’y avoir participé… D’où cette vague de silence.
Le sentiment de culpabilité peut-il tout expliquer ? N’est-ce pas les appétits voraces, l’intéressement, la prédation qui motivent ces silences complices ?
Oui. C’est certain. C’est pour cela qu’on parle de néocolonialisme parce que justement les liens coloniaux persistent à ce jour sur le plan économique. S’il n’y a pas de cogestion, il une cosolidarité avec les dirigeants algériens qui date de l’Algérie française et qui se traduit sur le plan économique.
Qu’est-ce qui vous choque le plus dans ces rapports franco-algériens ?
C’est l’existence de rapports coloniaux avec la direction algérienne. Avec sa bourgeoisie, sa bureaucratie et ses appareils pourris. Quand on voit ce qui se passe avec Bouteflika, c’est une caricature de démocratie ; quand on voit la répression qui s’abat sur les Algériens, les vrais démocrates, on se rend compte du degré de connivence avec les milieux politiques et dirigeants français. Et même si formellement l’Algérie française, c’est fini, ça continue quand même ! Il y a des bénéfices colossaux qui sont réalisés en Algérie par les entreprises françaises parce qu’entre autre la main-d’œuvre algérienne est bon marché, que les Algériens travaillent toujours pour nous.
Techniquement, comment cette France-Afrique s’organise, agit avec et envers l’Algérie ?
C’est un classique. Elle s’organise avec les milieux financiers, les banques… et puis après on met le vernis idéologique des droits de l’homme, des libertés, de la démocratie.

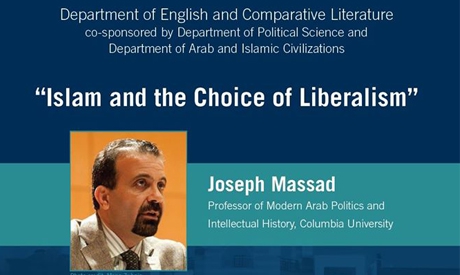
Des Antilles à l’Afrique du Nord, jusqu’au Moyen-Orient et à l’Asie du Sud-est, les Français sont majoritairement considérés comme des tortionnaires chevronnés, dont la langue gracieuse et raffinée ne sert pas tant à décrire une sauce crémeuse ou un décolleté plongeant, qu’à enrober les douleurs et les souffrances indicibles qu’ils infligent à des millions d’innocents.
Les Français sont peut-être mieux connus, tant à leurs yeux qu’à ceux des Européens de l’Ouest et des US-Américains blancs, comme des créateurs de haute couture et des maîtres dans l’art culinaire dont le langage amoureux est particulièrement adapté à la romance. Cependant, les Américains blancs, comme les Allemands et les Britanniques, ont une relation d'amour-haine avec les Français, mais clairement faite de plus d’amour que de haine, comme en témoigne tout récemment la publication dans le New York Times d’une tribune de Marine Le Pen, leader du Front National d’extrême-droite.
Mais dans le reste du monde – des Antilles à l’Afrique du Nord, de l’Ouest et centrale, jusqu’au Moyen-Orient et à l’Asie du Sud-est –, les Français sont majoritairement considérés comme des assassins et des tortionnaires chevronnés, dont la langue gracieuse et raffinée ne sert pas tant à décrire une sauce crémeuse onctueuse ou un décolleté plongeant sur une robe de soirée, et moins encore à faire la cour ou à flirter, qu’à enrober les douleurs et les souffrances indicibles qu’ils infligent à des millions d’innocents.
Pourtant, la culture dominante française persiste à ne vouloir se voir qu’à travers ses propres yeux, et la plupart des Français sont scandalisés à l’idée même que quiconque dans le monde puisse seulement remettre en question l’image élogieuse et raffinée qu’ils ont d’eux-mêmes.
BARBARIES COLONIALES
Ce contraste est à la fois dû à l’histoire de la France et à sa politique actuelle. Commençons par l’Histoire : un rapport sur les atrocités coloniales françaises en Indochine pour les années 1930-33, suite au déclenchement de la mutinerie de Yên Bái en février 1930, recense certaines des méthodes monstrueuses de torture chères aux officiers français. Selon la célèbre militante française Andrée Viollis, les méthodes de torture incluaient – en plus de l’utilisation de l’électricité – la privation de nourriture, le bastinado (flagellation de la plante des pieds, aussi appelée falaka), les épingles introduites sous les ongles, les semi-pendaisons, la privation d’eau et l’usage de tenailles appliquées sur les tempes (pour faire jaillir les orbites), entre autres. Une méthode plus délicate comprenait l’utilisation d’ « une lame de rasoir [pour] couper la peau des jambes en longs sillons, combler la plaie avec du coton et brûler ce coton [1]. »
En 1947-48, les autorités coloniales françaises se sont déchaînées à Madagascar, tuant et violant la population et incendiant des villages entiers, en guise de châtiment suite au soulèvement nationaliste malgache. Certaines des pratiques et spécialités de torture spécifiquement françaises qui furent employées contre le peuple de Madagascar incluaient les « vols de la mort », où des indigènes étaient jetés depuis des avions militaires au milieu de la mer, se noyaient et devenaient des « disparus ».
Cette méthode meurtrière était une spécialité dont la France s’enorgueillissait tellement que les autorités coloniales françaises en Algérie continuèrent à y recourir plusieurs années plus tard, pendant la bataille d’Alger en 1956-57. Dans le cas de l’Algérie, les parachutistes français ont décidé de perfectionner cette méthode lorsque des cadavres d’Algériens ont commencé à refaire surface, exposant cette pratique. La modification consistait à attacher des blocs de béton aux pieds des victimes pour s’assurer qu’ils coulent définitivement (les généraux argentins soutenus par les Usa trouveront cela très utile dans leurs efforts pour réprimer la résistance à leur dictature à la fin des années 1970).
Ce ne sont pas des méthodes de torture ad hoc que les Français ont élaboré sur place, mais des cruautés bien conçues et bien rodées. Dans l’Algérie du 19e siècle, le général Saint-Arnaud enfumait les révolutionnaires algériens dans des grottes et ses soldats violaient les femmes algériennes, comme le feront les soldats Français tout au long de la révolution algérienne, des années 1950 au début des années 1960.
Les estimations des morts causées par les Français s’élèvent à un million de Vietnamiens et un million d’Algériens. Quant à Madagascar, on estime que plus de 100 000 personnes ont été tuées par les Français. Ce ne sont là que quelques exemples de la barbarie coloniale française dans certaines colonies, et en aucun cas une liste exhaustive. Le colonialisme français, sous le titre grandiose de « mission civilisatrice », a clairement échoué à civiliser, avant tout, les Français eux-mêmes. La « mission », semblerait-il, reste inaccomplie !
CATHOLICISME LAÏQUE
La question de la façon dont les Français sont perçus ne se limite pas seulement à l’histoire, mais reste pertinente dans le présent. Tandis que l’assimilation des indigènes aux coutumes du Français colonisateur a été le noyau du programme colonial français, cette philosophie est venue hanter les Français après qu’ils se sont partiellement retirés des colonies pour constater que les immigrants africains, arabes et indochinois, entre autres, n’étaient pas « assimilables » aux usages des « Français ». Il semble que seuls les immigrants allemands, russes, espagnols, italiens et certainement hongrois en France puissent être maintenant assimilés à la société française, mais pas les immigrés plus basanés et surtout non-chrétiens.
Le massacre des Algériens français commis par la police française en octobre 1961, qui s’inspirait clairement de la spécialité des « vols de la mort » de l’armée française en Algérie et à Madagascar, a entraîné la mort de plus de 200 manifestants musulmans (certaines estimations vont jusqu’à 400) qui furent abattus ou jetés dans la Seine.
Il a fallu attendre 1998 pour que le gouvernement français à dominante catholique [2] reconnaisse enfin que la police a tué à peine 40 des 200 à 400 Musulmans français assassinés. Les victimes du gouvernement français à dominante catholique considèrent ces actes barbares et cruels comme une des principales caractéristiques de la culture catholique française, voire comme une définition de celle-ci. Et non seulement n’est-ce pas une vue propre aux Musulmans français (les autorités coloniales françaises ont inventé la catégorie des « Français musulmans » dans l’Algérie du 19e siècle afin d’imposer légalement aux Algériens de renoncer à la « loi islamique », y compris la polygamie, pour pouvoir accéder à la pleine citoyenneté française), mais les Français juifs eux-mêmes ont également compris l’antisémitisme catholique français comme un élément central de la culture catholique française.
Après tout, les Juifs français avaient été soumis par Napoléon à un « test pH » similaire – ou était-ce un test de « catholicité » ? – en 1806, visant à rassurer ses craintes au sujet des lois juives sur la polygamie et le divorce qui contredisaient les lois nationales françaises, et qui ne devaient plus être appliquées : c’était là une condition de l’émancipation juive. Bien sûr, ces lois de l’État étaient conformes à la monogamie catholique, mais pas à la polygamie juive. Pourtant, les Français continuent à se voir et à se présenter au monde et à eux-mêmes comme des amants sensibles et pensifs, des intellectuels engagés et des défenseurs du sécularisme ou « laïcité » !
C’est ce dernier point qui fait désormais partie intégrante des campagnes sectaires et racistes officielles et officieuses des Catholiques français, « laïques » bien sûr, contre les Musulmans français, sans parler des musulmans hors de France. C’est là-bas que les Musulmans français sont considérés comme ayant en quelque sorte leurs origines géographiques, religieuses et culturelles, hors de France, une accusation qui n’est jamais portée contre les citoyens français d’origine immigrée italienne, allemande, russe, espagnole ou hongroise.
Si les Catholiques français ont insisté pour que les Musulmans et Juifs algériens deviennent Français sous l’Algérie française (les Juifs français d’origine algérienne ont été considérés comme ayant réussi à effectuer cette transition avec succès depuis le décret Crémieux de 1870 qui les a légalement transformés en citoyens français et non plus Algériens, un statut qui a ensuite été révoqué sous le régime collaborationniste de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, révélant la fragilité de la tolérance catholique française), les mêmes Catholiques français insistent pour que les Français d’origine musulmane algérienne en France soient contraints à s’assimiler encore à une sorte de francité fantasmatique prétendument séculaire ou « laïque » et en aucun cas chrétienne.
Il est difficile de savoir si les Bretons, les Corses ou les Basques et les Alsaciens – en 2011, Nicolas Sarkozy croyait que ces derniers vivaient toujours en Allemagne – se sont déjà entièrement assimilés à cette francité présumée ou s’ils sont toujours dans l’attente de nouvelles instructions.
LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE
Au lendemain de l’attaque contre les bureaux du magazine Charlie Hebdo par deux Musulmans français, et l’attaque d’un supermarché juif français par un troisième (les origines géographiques des parents de ces hommes ont été immédiatement identifiées par les médias français comme significatives voire centrales dans leurs crimes), l’ancien président français d’origine catholique hongroise Nicolas Sarkozy (son grand-père maternel était un Juif grec qui s’est converti au catholicisme), a proposé « d’expulser tout imam [musulman français] qui soutient des points de vue qui ne respectent pas les valeurs de la République. »
On ne sait pas si Sarkozy serait d’accord avec la proposition de l’expulser en Hongrie ou en Grèce s’il venait à épouser des vues « qui ne respectent pas les valeurs de la République ». De même, il reste difficile de savoir si cela devrait aussi être le sort réservé aux prêtres catholiques français et aux rabbins juifs français s’ils s’avèrent manquer de respect envers ces valeurs, bien qu’en se basant sur le statut des Juifs sous Vichy, il semble que les rabbins ne seraient pas épargnés non plus.
Contrairement à la perception qu’ont la plupart des Catholiques français d’eux-mêmes, le problème avec la culture française contemporaine dominante catholique (« laïque ») est, avant tout, son manque de raffinement. Le racisme français s’exprime souvent de la manière la plus vulgaire, sans les moindres palliatifs ou euphémismes. En cela, les Français sont différents de leurs pairs des contextes Us-américain et britannique, où le racisme est souvent formulé dans un langage socialement plus acceptable, bien qu’il cache la même vulgarité raciste. La vulgarité du racisme catholique français, cependant, est plus similaire à celle du racisme juif israélien, qui n’a souvent que faire des périphrases et autres produits cosmétiques linguistiques.
La politique et les crimes actuels du gouvernement français au Mali, en Libye et en Afghanistan, pour ne citer que les trois principaux lieux d'interventions militaires françaises, se poursuivent. Lorsque les troupes françaises ont ouvert le feu sur une voiture civile en Afghanistan en 2011, tuant trois civils, dont une femme enceinte et un enfant, le ministre français de la Défense, Gérard Longuet, a exprimé sa « profonde tristesse » pour ces morts, mais a déclaré que les soldats avaient agi en légitime défense car la voiture avait « refusé de s’arrêter en dépit des sommations répétées. »
Le soutien français actuel apporté aux djihadistes syriens, y compris l’aide de la France et de l’Otan, sinon l’encouragement, prodigués aux Français musulmans désireux de prendre part aux combats en Syrie, démentent l’horreur officielle des Catholiques français face à la montée de l’État Islamique et à ses pratiques de décapitation. Peut-être que les membres Français de Daech ont trop bien assimilé la culture catholique française, surtout en ce qui concerne l’intolérance et la décapitation – car la pratique « laïque » de l’État français d’exécution des criminels par décapitation par la guillotine s’est poursuivie jusqu’en 1977, la dernière personne décapitée étant par coïncidence un criminel français musulman.
QUI DEVRAIT S’ASSIMILER ?
C’est cette France qui accuse sa population musulmane de refuser de s’assimiler à ses usages, mais ne se demande jamais pourquoi elle ne devrait pas s’assimiler à leurs manières – puisque les Musulmans français font tout autant partie de la France et de sa culture que les Catholiques français et puisque la France n’est plus la propriété exclusive des Catholiques français qui pourraient en disposer à leur guise. Peut-être que les Catholiques français (devrions-nous simplement les appeler Gaulois ?) pourraient apprendre des Musulmans français une certaine forme de tolérance.
Après tout, ce sont les Musulmans français qui ont subi et continuent du mieux qu’ils peuvent à supporter le racisme et l’intolérance des Catholiques français depuis des décennies. Les Catholiques français pourraient-ils à leur tour apprendre à supporter la tolérance des Musulmans français ? Aussi choquante que cette dernière idée puisse être aux yeux des Catholiques français et des racistes sectaires (qui sont bien sûr « laïques »), ces mêmes personnes n’ont jamais considéré leurs actions choquantes lorsque, en tant que minorité coloniale, ils ont cherché à forcer la majorité des colonisés à s’assimiler à leurs usages – quels que soient leurs usages, bien sûr.
On ne sait pas vraiment si on attend des Musulmans français qu’ils adoptent la torture et les méthodes meurtrières des Catholiques français et leur intolérance « laïque » dans le cadre de leur processus d’assimilation. Si cela était effectivement requis, alors les trois seuls Musulmans français assimilés avec succès ne seraient autres que Cherif et Saïd Kouachi, les frères qui ont attaqué Charlie Hebdo, et Amedy Coulibaly, qui a attaqué le supermarché juif.
De manière assez surprenante, le gouvernement français a refusé de reconnaître à quel point les frères Kouachi étaient des Français bien assimilés, et il a demandé au gouvernement algérien de les faire enterrer en Algérie, un pays où ils n’avaient jamais mis les pieds, plutôt qu’en France où ils s'étaient assimilés d’une manière exemplaire. Le gouvernement algérien a dûment refusé d’autoriser l’inhumation des deux Français sur son sol. La France a obtenu la même réponse du gouvernement du Mali, qui a rejeté une demande du gouvernement français de leur envoyer le corps du citoyen français Coulibaly pour qu’il y soit enterré.
Malgré l’ampleur horrible des actes de ces trois hommes, leurs crimes restent numériquement modestes et pâles comparés aux bien plus cruelles monstruosités des Français catholiques et « laïques » qui ont atteint des proportions génocidaires à travers le monde. Cependant, si les frères Kouachi et Coulibaly avaient survécu, ils auraient encore eu besoin de beaucoup de leçons de cruauté et d’intolérance violente avant de pouvoir devenir entièrement assimilés à l’authentique francité catholique et laïque.
Le reste des Musulmans français continuent à résister à l’assimilation à la francité catholique et « laïque » et à refuser de suivre l’exemple de l’intolérance des Français catholiques et « laïques » racistes et de leurs quelques émules musulmans. Pour la majorité des Musulmans français, la réponse à ces invitations catholiques françaises et laïques à l’assimilation est un « Non merci » explicite, ou plutôt, dans la langue raffinée des Français : « Merci, très peu pour nous ! »
NOTES
1] Andrée Viollis, SOS Indochine, p. 13. Également mentionnée, « Introduire un fil de fer en tire-bouchon dans le canal urinaire et le retirer brusquement. » Et, pour des femmes de 16 à 18 ans, « viols, pendaison par les orteils, flagellation sur les cuisses et la plante des pieds, introduction de nids de fourmis dans les parties intimes, leurs bras et leurs jambes attachés, jusqu’à ce qu’elles avouent faire partie d’un groupement communiste. »
2] Il s’agit de la culture et de l’histoire chrétienne originelles, indépendamment de l’attachement à la foi, toute idée ou référence religieuse ayant été éradiquées avec succès par les voltairiens, malgré la résistance de Rousseau, Robespierre et Jaurès, entre autres. Aujourd’hui, les « racines judéo-chrétiennes » de la France sont néanmoins brandies par les athées les plus forcenés pour dénoncer l’Islam et les musulmans. Selon nous, les musulmans permettraient bien plutôt à la « fille aînée de l’Église » de renouer avec une identité, des traditions et des valeurs longuement enterrées.
Il nous semble utile de préciser que l'auteur, né en Jordanie, est issu d'une famille palestinienne chrétienne.
http://www.pambazuka.org/fr/l'assimilation-à-la-hussarde-des-musulmans-français
Je dédie cet article à la mémoire de Youssef Darwish (en arabe : يوسف درويش) 1910 - 2006, militant égyptien qui a combattu inlassablement pour la justice et l’internationalisme. Plusieurs fois mis en prison et torturé pour son engagement communiste et pour son combat pour les droits humains (il était juriste), il a poursuivi la lutte jusque la fin de ses jours |1|. En 2005, un peu avant sa mort, il avait pris contact avec le CADTM international car il souhaitait créer un CADTM égyptien.
Succès puis abandon de la tentative de développement autonome de l’Égypte
L’Égypte, bien qu’encore sous tutelle ottomane, entame au cours de la première moitié du XIXe siècle un vaste effort d’industrialisation |2| et de modernisation. George Corm résume l’enjeu de la manière suivante : « C’est évidemment en Égypte que Mohammed Ali fera l’œuvre la plus marquante en créant des manufactures d’État, jetant ainsi les bases d’un capitalisme d’État qui ne manque pas de rappeler l’expérience japonaise du Meiji » |3|. Cet effort d’industrialisation de l’Égypte s’accomplit tout au long de la première moitié du XIXe siècle sans recours à l’endettement extérieur ; ce sont les ressources internes qui sont mobilisées. En 1839-1840, une intervention militaire conjointe de la Grande Bretagne et de la France, suivie un peu plus tard d’une seconde agression réalisée cette fois par la Grande-Bretagne et l’Autriche obligent Mohammed Ali à renoncer au contrôle de la Syrie et de la Palestine, que ces puissances considèrent comme des chasses gardées. (voir plus bas la carte de l’extension de l’Égypte sous Mohamed Ali)

Un tournant radical est pris à partir de la seconde moitié du siècle. Les successeurs de Mohammed Ali adoptent le libre-échange sous la pression du Royaume-Uni, démantèlent des monopoles d’État et recourent massivement aux emprunts extérieurs. C’est le début de la fin. L’ère des dettes égyptiennes commence : les infrastructures de l’Égypte seront abandonnées aux puissances occidentales, aux banquiers européens et aux entrepreneurs peu scrupuleux.
Les banquiers européens veulent prêter massivement hors de l’Europe occidentale
Entre les années 1850 et 1876, les banquiers de Londres, de Paris et d’autres places financières cherchaient activement à placer des sommes considérables d’argent tant en Égypte que dans l’Empire ottoman et dans d’autres continents (en Europe avec l’Empire russe, en Asie dont la Chine en particulier, en Amérique latine) |4|. Plusieurs banques sont créées en Europe afin de canaliser les mouvements financiers entre l’Égypte et les places financières européennes : l’Anglo-Egyptian Bank (fondée en 1864), la Banque franco-égyptienne (fondée en 1870 et dirigée par le frère de Jules Ferry, important membre du gouvernement français) et la Banque austro-égyptienne (créée en 1869). Cette dernière avait été fondée sous les auspices du Kredit Anstalt où les Rothschild de Vienne avaient leurs intérêts. Les grandes banques de Londres étaient aussi particulièrement actives. Les banquiers londoniens se spécialisèrent dans les prêts à long terme et les banquiers français dans les prêts à court terme, plus rémunérateurs, surtout à partir de 1873 quand une crise bancaire a affecté Londres et Vienne.
Réussite apparente et éphémère du développement économique de l’Égypte basé sur l’endettement et le libre-échange
Dans un premier temps, le nouveau modèle fondé sur l’endettement et le libre-échange semblait très bien fonctionner, mais, en réalité, cet apparent succès tenait à des événements extérieurs que ne maîtrisaient aucunement les autorités égyptiennes. En effet, l’Égypte a temporairement tiré profit du conflit entre les États sudistes et les nordistes en Amérique du Nord. La guerre de sécession (1861-1865) de l’autre côté de l’Atlantique provoqua une chute des exportations de coton que réalisaient les États sudistes. Cela fit monter très fortement le prix du coton sur le marché mondial. Les revenus d’exportation de l’Égypte, productrice de coton, explosèrent. Cela amena le gouvernement d’Ismaïl Pacha à accepter encore plus de prêts des banques (britanniques et françaises principalement). Lorsque la guerre de sécession prit fin, les exportations sudistes reprirent et le cours du coton s’effondra. L’Égypte dépendait des devises que lui procurait la vente du coton sur le marché mondial (principalement à l’industrie textile britannique) pour effectuer le remboursement de la dette aux banquiers européens. La diminution des recettes d’exportation créa les premières difficultés de remboursement de la dette égyptienne.
Cela n’empêcha pas les banquiers, en particulier les banquiers anglais, d’organiser l’émission d’emprunts égyptiens à long terme (20 à 30 ans) et les banquiers français d’octroyer de nouveaux crédits, à court terme principalement, car ils donnaient droit à des taux d’intérêts très élevés. L’historien Jean Bouvier décrit cet engouement : « Des organismes de crédit - Banque de Paris et des Pays-Bas, Crédit Lyonnais, Société Générale, Comptoir d’Escompte de Paris, Crédit Foncier – qui avaient jusque-là participé aux “avances” et “emprunts” d’Égypte un peu au hasard des affaires, se mirent à rechercher systématiquement de tels placements et à prospecter les opérations gouvernementales des pays sous-développés. Lorsqu’en avril 1872, le Crédit Lyonnais s’attend à participer, aux côtés des Oppenheim, à une “avance” égyptienne – bons à dix-huit mois, pour 5 millions de livres sterling, à 14 % l’an – son directeur Mazerat confie à un correspondant : “On espère, au moyen de cette grosse avance, mettre la main sur l’emprunt qui doit être émis l’année prochaine.” |5| »
La dette égyptienne atteint un niveau insoutenable
En 1876, la dette égyptienne atteignait 68,5 millions de livres sterling (contre 3 millions en 1863). En moins de 15 ans, les dettes extérieures avaient été multipliées par 23 alors que les revenus augmentaient de 5 fois seulement. Le service de la dette absorbait les deux tiers des revenus de l’État et la moitié des revenus d’exportation.
Les montants empruntés qui sont parvenus réellement à l’Égypte restent très faibles tandis que les montants que les banquiers exigeaient et recevaient en retour étaient très élevés.
Prenons l’emprunt de 1862 : les banquiers européens émettent des titres égyptiens pour une valeur nominale de 3,3 millions de livres sterling, mais ils les ont vendus à 83 % de leur valeur nominale, ce qui fait que l’Égypte ne reçoit que 2,5 millions de livres dont il faut encore déduire la commission prélevée par les banquiers. Le montant que doit rembourser l’Égypte en 30 ans s’élève à près de 8 millions de livres si on prend en compte l’amortissement du capital et le paiement des intérêts.
Autre exemple, l’emprunt de 1873 : les banquiers européens émettent des titres égyptiens pour une valeur nominale de 32 millions de livres et ils les vendent avec un rabais de 30 %. En conséquence, l’Égypte ne reçoit qu’un peu moins de 20 millions de livres. Le montant à rembourser en 30 ans s’élève à 77 millions de livres (intérêt réel de 11 % + amortissement du capital).
On comprend aisément que cet accroissement de la dette et les taux d’intérêts exigés sont intenables. Les conditions financières qui sont imposées par les banquiers rendent insoutenable le remboursement. L’Égypte doit constamment emprunter afin d’être en mesure de poursuivre les paiements dus sur les anciennes dettes.
Sous pression des créanciers, le souverain Ismail Pacha, khédive |6| d’Égypte se met à vendre à partir des années 1870 des infrastructures et à accorder diverses concessions afin d’obtenir des liquidités pour payer la dette. Il doit aussi régulièrement augmenter les impôts pour les mêmes raisons.
Après une petite quinzaine d’années d’endettement externe (1862-1875), la souveraineté égyptienne est aliénée.
En 1875, pris à la gorge par les créanciers, l’État égyptien cède au gouvernement du Royaume-Uni ses parts dans la Compagnie du Canal de Suez qui avait été inauguré en 1869 |7|. Le produit de la vente des 176 602 actions Suez que détenait l’Égypte – soit près de la moitié du capital de la Compagnie de Suez – au gouvernement britannique à la fin de novembre 1875 est largement destiné à respecter les échéances de paiement de la dette de décembre 1875 et de janvier 1876 qui étaient particulièrement lourdes. Le gouvernement de Londres devient du même coup créancier direct de l’Égypte : les titres achetés ne permettant pas de toucher de dividendes avant 1894, le gouvernement égyptien s’engageait à payer à l’acheteur pendant cette période un intérêt de 5 % l’an sur les quelque cent millions de francs du prix d’achat.
Selon l’historien Jean Bouvier : « Le khédive disposait encore des chemins de fer « évalués à 300 millions », selon un administrateur du Crédit Lyonnais, et de son droit aux 15 % des bénéfices nets annuels de la Compagnie de Suez. Ayant réglé les échéances de fin d’année grâce aux 100 millions de la vente de ses actions, le khédive fait reconduire en janvier 1876 et début février les « avances » en cours fournies par l’Anglo-Egyptian et le Crédit Foncier, à trois mois, au taux de 14 % l’an. Il offre en garantie sa part de 15 % dans les tantièmes de Suez, les produits de l’octroi de la ville d’Alexandrie et les droits du port. La Société Générale participe à l’affaire, qui porte sur 25 millions de francs. »
En 1876 l’Égypte comme d’autres pays suspend le paiement de la dette
Finalement, malgré les efforts désespérés pour rembourser la dette, l’Égypte est amenée à suspendre le paiement de la dette en 1876. Il est important de souligner qu’au cours de cette même année 1876, d’autres États se sont déclarés en cessation de paiement, il s’agit de l’Empire ottoman, du Pérou (à l’époque, une des principales économies d’Amérique du Sud) et de l’Uruguay. Il faut donc chercher les causes sur le plan international. Une crise bancaire avait éclaté à New-York, à Francfort, Berlin et à Vienne en 1873 et avait progressivement affecté les banquiers de Londres. En conséquence, la volonté de prêter à des pays périphériques s’était fortement réduite, or ces pays avaient constamment besoin d’emprunter pour rembourser les anciennes dettes. De plus, la situation économique s’étant dégradée dans les pays du Nord, les exportations du Sud baissèrent, de même que les revenus d’exportation qui servaient à effectuer les remboursements. Cette crise économique internationale dont l’origine se trouve au Nord a largement provoqué la vague de suspensions de paiements. |8| Dans chaque cas particulier, il faut en plus distinguer certaines spécificités.
Dans le cas de l’Égypte, les banquiers français, moins affectés que les autres par la crise, avaient poursuivi les prêts à l’Égypte en profitant de la situation pour augmenter fortement les taux d’intérêts et en ne prêtant le plus souvent qu’à court terme. En 1876, ils ont accentué la pression sur l’Égypte et en resserrant l’accès au crédit, ont provoqué la suspension de paiement afin de forcer l’Égypte à accepter la création d’une Caisse de la dette contrôlée par le Royaume-Uni et la France. Ils ont réalisé cela en bonne entente avec les banquiers de Londres,
La création de la Caisse de la dette publique sous tutelle britannique et française
Les gouvernements de Londres et de Paris, bien que concurrents, se sont entendus pour soumettre l’Égypte à leur tutelle via la Caisse de la dette. Ils avaient procédé de la même manière dans les années 1840-1850 et à partir de 1898 à l’égard de la Grèce |9|, en 1869 à l’égard de la Tunisie |10| et ils ont répété l’opération avec l’Empire ottoman à partir de 1881 |11|. En Grèce et en Tunisie, l’organisme qui a permis aux puissances créancières d’exercer leur tutelle a été nommé la Commission financière internationale ; dans l’Empire ottoman, il s’est agi de l’Administration de la Dette publique ottomane et, en Égypte, la Caisse de la Dette publique créée en 1876 a joué ce rôle |12|.
La Caisse de la Dette publique a la mainmise sur une série de revenus de l’État et ce sont les représentants du Royaume-Uni et de la France qui la dirigent. La mise en place de cet organisme a été suivie d’une restructuration de la dette égyptienne, qui a satisfait tous les banquiers concernés car aucune réduction du stock n’a été accordée ; le taux d’intérêt a été fixé à un niveau élevé, 7 %, et les remboursements devaient durer 65 ans. Cela assurait une rente confortable garantie à la fois par la France, le Royaume-Uni et par les revenus de l’État égyptien dans lesquels la Caisse de la Dette publique pouvait puiser.
La priorité donnée à la satisfaction des intérêts des banquiers dans la résolution de la crise de la dette égyptienne de 1876 apparaît très clairement dans une lettre envoyée par Alphonse Mallet, banquier privé et régent de la Banque de France, à William Henry Waddington, ministre français des Affaires étrangères et futur président du Conseil des Ministres. Ce banquier écrit au ministre à la veille du Congrès de Berlin de 1878 au cours duquel va se discuter le sort de l’Empire ottoman (en particulier de ses possessions dans les Balkans et dans la Méditerranée) : « Mon cher ami, ... Si le Congrès se réunit, comme on l’espère, il suffit de combiner un mécanisme international... qui puisse exercer un contrôle efficace sur les agents administratifs du gouvernement, les tribunaux, l’encaissement des recettes et les dépenses. Ce qui a été fait en Égypte sous la pression des intérêts privés, en dehors de toute considération d’ordre public européen tant pour les tribunaux que pour le service de la dette... peut servir de point de départ. » (Lettre du 31 mai 1878. Mémoires et documents, Turquie, n° 119. Archives du Ministère des Affaires étrangères.) |13|.
Les enjeux géostratégiques entre grandes puissances européennes
Si la mise en place de la Caisse de la Dette publique et la restructuration de la dette égyptienne qui a suivi satisfaisaient au premier chef les intérêts des banquiers, les intérêts des grandes puissances, dont provenaient les banquiers, étaient également directement en jeu. Le Royaume-Uni était de loin la première puissance européenne et mondiale. Elle considérait qu’elle devait contrôler et dominer entièrement la Méditerranée orientale qui gagnait en importance vu l’existence du Canal de Suez, qui donnait accès directement à la route maritime des Indes (qui faisait partie de son empire) et du reste de l’Asie. Le Royaume-Uni souhaitait marginaliser la France, qui exerçait une influence certaine en Égypte à cause des banques et du Canal de Suez dont la construction avait été financée via la bourse de Paris. Afin d’obtenir de la France qu’elle laisse entièrement la place au profit de l’Angleterre, il fallait primo satisfaire les intérêts des banquiers français (très liés aux autorités françaises, c’est le moins qu’on puisse dire) et secundo lui offrir une compensation dans une autre partie de la Méditerranée. C’est là qu’intervient un accord tacite entre Londres et Paris : l’Égypte reviendra au Royaume-Uni tandis que la Tunisie passera entièrement sous le contrôle de la France. En 1876-1878, le calendrier exact n’est pas encore fixé, mais la perspective est très claire. Il faut ajouter qu’en 1878 le Royaume-Uni a acheté l’île de Chypre à l’Empire ottoman. Chypre est un autre pion dans la domination britannique de la Méditerranée orientale.
L’avenir de la Tunisie et de l’Égypte ne se règle pas seulement entre la France et le Royaume-Uni. L’Allemagne, qui vient d’être unifiée et qui est la principale puissance européenne montante à côté du Royaume-Uni, a son mot à dire. Otto von Bismarck, le chancelier allemand, a été manifestement clair : il a déclaré à maintes reprises, lors de conversations diplomatiques secrètes, que l’Allemagne ne prendrait pas ombrage d’une prise de contrôle de l’Égypte par Londres et d’une prise de contrôle de la Tunisie par la France. En contrepartie, l’Allemagne voulait le champ libre dans d’autres parties du monde. Les dirigeants politiques français étaient d’ailleurs bien conscients des motivations de Bismarck. L’Allemagne avait imposé une défaite militaire humiliante à la France en 1870-1871 et lui avait ravi l’Alsace et la Lorraine. Bismarck, en « offrant » la Tunisie à la France, voulait détourner Paris de l’Alsace et de la Lorraine en lui offrant un prix de consolation. Une très large documentation est disponible à ce sujet.
En somme, le sort réservé à l’Égypte et à la Tunisie préfigure le grand partage de l’Afrique auquel les puissances européennes se livrèrent, quelques années plus tard, lors d’une autre conférence à Berlin tenue en 1885 |14|.
L’occupation militaire de l’Égypte à partir de 1882 et sa transformation en protectorat
Dans le cas de l’Égypte et de la Tunisie, la dette a constitué l’arme la plus puissante utilisée par des puissances européennes pour assurer leur domination, en les menant jusqu’à la soumission totale d’États jusque-là indépendants.
Suite à la mise en place de la Caisse de la Dette publique, les banques françaises font le maximum pour obtenir toujours plus de remboursements et de profits en prenant de moins en moins de nouveaux engagements. À partir de 1881, les banques françaises renoncent à octroyer de nouveaux prêts à l’Égypte, elles se contentent d’engranger les remboursements des anciennes dettes restructurées. Quand en janvier 1882 une crise boursière éclate à Paris, les banques françaises ont d’autres préoccupations que l’Égypte.
La Caisse de la Dette publique impose à l’Égypte des mesures d’austérité très impopulaires qui génèrent une rébellion, y compris militaire (le général Ahmed Urabi défend des positions nationalistes et résiste aux diktats des puissances européennes). Le Royaume-Uni et la France prennent prétexte de la rébellion pour envoyer un corps expéditionnaire à Alexandrie en 1882. Finalement, la Grande-Bretagne entre en guerre contre l’armée égyptienne, occupe militairement de manière permanente le pays et le transforme en un protectorat. Sous domination britannique, le développement de l’Égypte sera largement bloqué et soumis aux intérêts de Londres. Comme l’écrivait Rosa Luxemburg en 1913 : « L’économie égyptienne a été engloutie dans une très large mesure par le capital européen. D’immenses étendues de terres, des forces de travail considérables et une masse de produits transférés à l’État sous forme d’impôts ont été finalement transformés en capital européen et accumulés. » |15|
La Caisse de la Dette publique ne sera supprimée qu’en juillet 1940 |16| (voir illustration ci-dessous). L’accord imposé à l’Égypte par le Royaume-Uni en 1940 prolonge la domination financière et coloniale car le Royaume-Uni obtient la poursuite des remboursements d’une dette qui est devenue permanente.
Il faudra le renversement de la monarchie égyptienne en 1952 par de jeunes militaires progressistes dirigés par Gamel Abdel Nasser et la nationalisation du Canal de Suez le 26 juillet 1956 pour que, pendant une période d’une quinzaine d’années, l’Égypte tente à nouveau un développement partiellement autonome |17|.
20 mai par Eric Toussaint