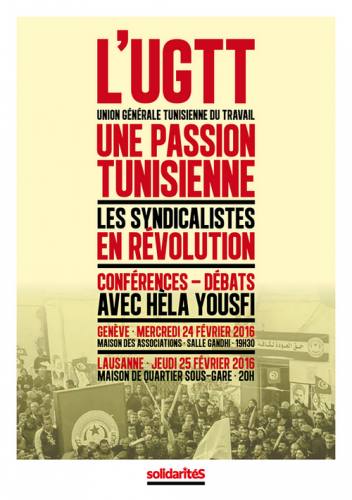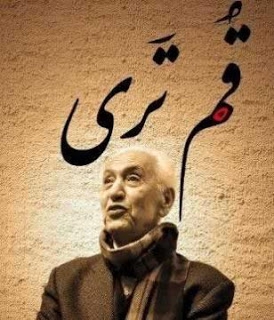La Vie des Idées : Pourquoi est-il nécessaire de revenir à l’histoire de la Syrie et de l’Irak de ces vingt dernières années pour comprendre l’État islamique (EI) ?
Loulouwa Al Rachid : Quand on parle de l’EI, on fait mine de croire à une naissance miraculeuse, comme si cet « État » auto-proclamé était né à l’été 2014 avec la prise de Mossoul, la deuxième plus grande ville d’Irak et qu’il suffisait de quelques centaines de combattants circulant dans des pick-up pour fonder une organisation terroriste puissante.
Or l’EI n’est pas le fruit d’une naissance miraculeuse mais résulte plutôt d’un déni de grossesse : les symptômes étaient là depuis longtemps sur le terrain irakien. L’année 2003 a constitué à cet égard un tournant décisif : elle a installé la matrice jihadiste de type Al-Qaida au cœur du Levant. C’est l’invasion de l’Irak par les États-Unis en 2003, suivie d’une occupation militaire qui a donné au phénomène jihadiste un nouvel essor dans notre voisinage méditerranéen.
Parmi les groupes ayant tout de suite pris les armes contre l’armée américaine et ses auxiliaires irakiens, il y avait une composante « étrangère » rapatriée d’Afghanistan et d’autres terrains du jihad, le Caucase notamment. Et sur cette matrice là se sont greffés des groupuscules armés irakiens, qui s’inscrivaient d’abord dans une posture « nationaliste » de lutte contre l’occupation étrangère. Ces groupuscules formés par des anciens du régime de Saddam Hussein se sont par la suite dissous dans la nébuleuse jihadiste, contribuant ainsi à la professionnaliser et à lui insuffler un moteur supplémentaire, celui de haine des chiites ; l’armée américaine a cru avoir éradiqué ces jihadistes en 2007-2009 en s’appuyant sur les tribus locales qu’elle a armées et financées pour pacifier les régions sunnites d’Irak.
Or ces groupuscules jihadistes n’ont jamais véritablement disparu depuis 2003 : ils se sont tantôt fondus dans une population sunnite qui supportait mal les pratiques, souvent discriminatoires, du nouveau pouvoir central chiite, tantôt repliés dans les zones désertiques ou montagneuses de l’ouest et du nord de l’Irak. Ils ont surtout trouvé refuge en Syrie, profitant d’un espace frontalier entre les deux pays devenu largement ouvert et poreux depuis le début des années 1990. En effet, le régime de Saddam Hussein, très affaibli par les sanctions internationales imposées par les Nations unies, avait partiellement perdu le contrôle de son territoire et de ses frontières, laissant se développer avec la Syrie une importante contrebande et des trafics en tous genres pour contourner l’embargo. Après 2003, les jihadistes ont fait de cet espace frontalier un territoire « intégré » avec des circulations incessantes d’hommes, d’idées et bien entendu, d’armes. Ils ont été aidés en cela par l’attitude bienveillante à leur égard du régime de Bachar al-Assad soucieux de participer à l’échec de la transformation « démocratique » de l’Irak décidée par George Bush.
Matthieu Rey : L’importance de la question syrienne et de l’EI tient au présent immédiat et à la façon dont la question syrienne s’est imposée dans l’actualité française.
Dans un premier temps, la question syrienne n’a pas fait sens pour la majorité des Français. Alors que la majorité de sa population se mobilise contre le régime de Bachar al-Assad au prix d’une implacable répression, elle ne parvient pas à faire écho dans le débat public. Là où les actualités titrent avec enthousiasme sur les expériences révolutionnaires et démocratiques, tunisiennes et égyptiennes, elles lisent la Syrie comme un processus « complexe ».
Dans un deuxième temps, la question syrienne entre en scène à l’automne 2013 autour du problème du départ d’individus d’Europe vers la Syrie, devenue la nouvelle terre du jihad, mais d’un jihad différent de celui mené en Afghanistan. Il est beaucoup plus massif et plus « démocratique » : c’est un jihad « low cost », tant sur le plan de l’investissement matériel (aller en Syrie n’est pas cher) que de l’engagement spirituel (il n’est pas besoin d’être un musulman érudit pour s’enrôler). Dans les médias et au sein des instances officielles, on assiste à la construction d’un discours de peur autour du départ de ces Européens qui apprendraient à se battre et qui pourraient revenir en Europe pour y organiser des attentats. A cela, s’ajoute la première vague migratoire de réfugiés, au sein de laquelle on suspecte la présence de jihadistes. La question du jihad se greffe ainsi à celle des réfugiés.
Le troisième temps démarre en janvier 2015 avec les attentats contre Charlie Hebdo et surtout la prise d’otages de l’Hyper Cacher. Au cours de la prise d’otage, les paroles de Coulibaly font explicitement référence à la Syrie. Enfin, en novembre 2015, avec la revendication des attaques dans le 11e arrondissement par l’EI, le lien entre la question syrienne et les événements français est établi, selon une lecture qui se focalise sur les agissements de l’État islamique.
On retrouve ce phénomène en novembre 2015 : cette fois-ci, les attentats sont immédiatement revendiqués par l’EI. On assiste là à une projection de la question syrienne, sans qu’elle soit comprise, sur le territoire français.
La Vie des Idées : Quels sont les traits caractéristiques des régimes syrien et irakien depuis les années 1990, notamment dans leur rapport à la religion et à la violence ?
Loulouwa Al Rachid : Avant 2003, les liens entre le régime de Saddam Hussein et la nébuleuse jihadiste sont insignifiants, pour ne pas dire inexistants, contrairement aux allégations avancées par les États-Unis pour justifier leur invasion de l’Irak. Le référent jihadiste était certes utilisé par Saddam Hussein dans les années 1990, mais il s’agissait davantage d’un jihad patriotique et nationaliste que d’un jihad religieux.
La propagande du régime va au cours de cette période user et abuser du mot « jihad » qui devient synonyme de résistance et de combat contre l’impérialisme. Il ne s’agit toutefois pas d’un combat dirigé vers l’extérieur : c’est un combat mené sur le sol irakien. Prenons un exemple apparemment anodin : celui de la reconstruction du secteur de l’électricité détruit par les bombardements aériens de la coalition internationale formée pour libérer le Koweït. Il a été présenté par le régime comme un « jihad électrique » pour prouver aux États-Unis et à leurs alliés que les Irakiens pouvaient, seuls et avec leurs propres moyens, reconstruire leurs infrastructures. Même chose pour la reconstruction des aéroports : c’est un jihad contre l’embargo aérien.
Dans ce contexte de lutte contre les effets dévastateurs des sanctions internationales, le jihad n’est donc pas une catégorie religieuse. Son utilisation dans la phraséologie baasiste n’en trahit pas moins la faillite idéologique et matérielle d’un État qui se targuait auparavant d’être séculier et progressiste. En effet, les sanctions internationales qui dépossèdent l’Irak de sa rente pétrolière (98% des revenus proviennent de l’exportation de brut) entraînent à la fois la déliquescence des institutions publiques et la paupérisation massive de la population ; elles mettent le pouvoir littéralement à nu. Par une sorte de glissement, la religion apparaît alors aux yeux de ce dernier comme la seule ressource symbolique restante pour se (re)légitimer auprès d’une population brutalisée par une répression sans relâche et des guerres à répétition depuis le début des années 1980.
C’est pourquoi Saddam Hussein décrète en 1994 une Campagne nationale pour la foi. Cela commence par l’ajout, sur le drapeau irakien, de la formule « Dieu est grand » (Allahu Akbar). Puis, petit à petit, le régime « islamise » son discours et ses pratiques. De nouvelles mosquées sont érigées partout dans le pays ; on oblige les cadres du parti Baas à suivre des cours d’instruction religieuse ; on accorde des remises de peine aux détenus qui apprennent par cœur le Coran, ce qui permet aussi de soulager un système carcéral à bout de souffle, etc.
Mais surtout, une plus grande marge de manœuvre est donnée aux hommes de religion, ce qui permet à une multitude d’activistes islamistes, sunnites comme chiites, de faire de la prédication et d’élargir leurs réseaux au sein de la société irakienne. Cette « islamisation par le haut » de la société est perçue comme une nécessité par un régime qui n’a plus les moyens de son autoritarisme, autrement dit comme une simple soupape de sécurité pour canaliser la colère sociale. Mais le recours à la religion va s’avérer contre-productif : il alimente la contestation et surtout politise dangereusement les appartenances confessionnelles dans une société de plus en plus polarisée entre une minorité sunnite et une majorité chiite. À tel point qu’à la fin des années 1990 le régime lui-même se retourne contre les secteurs qui se sont islamisés, aussi bien du côté sunnite que du côté chiite.
Cela étant, je dirais que bien plus qu’une islamisation impulsée par le haut, les Irakiens ont dû, dans les années 1990, développer des stratégies de survie (trafics, économie informelle, etc.) et se « débrouiller » par eux-mêmes, passant outre les frontières et les réglementations d’un État autoritaire calcifié. Le territoire national devient un espace de violence et de prédation et qui n’assure plus ses fonctions habituelles de sécurité et de régulation socio-économique. Les Irakiens n’ont pas d’autre choix que l’exode hors d’Irak ou le repli sur les plus petits dénominateurs communs, tels que le quartier, la région, la tribu, l’appartenance ethnique ou confessionnelle. Ce terreau sera favorable à l’autonomisation de groupes qui mobilisent à la fois la ressource religieuse et la ressource tribale comme stratégies de survie et de pouvoir et dont l’EI est aujourd’hui l’une des multiples facettes.
Matthieu Rey : La Syrie des années 1990 est, au contraire de l’Irak, un système dans lequel l’autoritarisme apparaît stabilisé, rigidifié : le président Hafez al-Assad a achevé de liquider toute forme d’opposition au cours des années 1980 et semble selon son titre « le président éternel » (al-rais al-khalid). L’édifice repose sur un chef arbitrant entre des polices politiques, mises en concurrence, ce qui les empêche de préparer un coup d’État. Comme en Irak lors de l’intifada de 1990-1991, ce sont davantage les services de renseignement (moukhabarat), et notamment les services dépendant de l’armée et de la police, c’est-à-dire des organismes de répression et de coercition, plutôt que le parti qui sont garants de la stabilité en Syrie. On a affaire à des régimes qui développent des formes de « paranoïa institutionnelle », qui considèrent leurs sociétés comme menaçantes et qui sont prêts pour les contrôler à atteindre des niveaux de violence très forts.
Concernant les rapports entre les autorités en place et les groupes terroristes, les gouvernements irakien et syrien en ont une grande pratique. Ils les traitent de manière assez simple : ils encadrent les activités de ceux qu’ils peuvent contrôler, les utilisant dans une logique de nuisance à l’égard de pays voisins ou occidentaux auxquels ils s’opposent.
Les populations intègrent l’idée de la « mémoire du régime » et d’une répression diffuse dans le temps : lorsque le régime réprime la révolte de Hama en 1982, les représailles perdureront dans les faits tout au long des années 1980-1990 dans des formes très variés : répression politique mais aussi mise au ban de l’économie. Il faut donc comprendre qu’aujourd’hui, tout jeune ou citoyen syrien sait que le pouvoir détient l’avenir, c’est-à-dire que les autorités poursuivront la répression tant qu’ils n’auront pas arrêté ceux qui, à un moment, ont participé aux mouvements. La société syrienne anticipe une répression qui s’étendra sur dix, vingt, trente ans.
Par ailleurs, de même qu’on a exagéré le poids de la confession en Irak et de l’appartenance chiite/sunnite, le caractère alaouite du régime syrien a été exacerbé parce que les milices policières du régime ont été recrutées dans l’entourage immédiat du président Assad ou des principales figures du régime. Mais cela répond davantage à une logique d’attraction et un effet d’aubaine qu’à une logique confessionnelle. Comme en Irak avec les Sunnites, on a l’impression de l’extérieur que les Alaouites gouvernent alors que ce sont seulement certains segments de cette communauté qui ont réussi leur ascension sociale. On ne peut donc pas parler d’État confessionnel en Syrie.
L’autre caractéristique de ce régime est l’absence de système fiscal efficient et l’usage de la prédation, comme en Irak, comme mode de rémunération. Mais à la différence de l’Irak, la Syrie peut déployer sa stratégie de prédation à travers toute une série de trafics sur le Liban, dans lequel elle s’est « invitée » au cours de la guerre civile à partir de 1976. Chaque syrien peut se rémunérer, suivant son niveau hiérarchique, sur le pays et sur les myriades de contrebandes qui se développent à ce moment-là. C’est notamment sur la frontière syro-libanaise qu’on voit se développer un groupe, les Shabiha, en charge de l’encadrement du trafic de haschich. Ils seront les hommes de main du régime pour écraser la contestation en 2011.
L’autre élément qui participe de la pérennisation du régime dans les années 1990 est d’ordre international. La Syrie revient au premier plan par le biais de la guerre contre l’Irak en 1990. Elle entre dans la coalition internationale dénonçant le régime de Saddam Hussein comme celui qui a violé l’unité arabe en envahissant le Koweït. Elle fournit une caution aux États-Unis (sans toutefois mobiliser ses troupes) qui lui reconnaissent en retour un rôle important. La Syrie devient l’acteur susceptible de régler trois problèmes en même temps : la guerre civile au Liban, la légitimité de l’intervention des Occidentaux contre l’Irak qui voit dans la Syrie, régime baasiste, un allié de taille, et la paix arabo-israélienne [1].
Loulouwa Al Rachid : Après 2003, se met en place un nouveau régime politique façonné de l’extérieur, par les États-Unis et leurs alliés irakiens, les opposants à Saddam Hussein rentrés de leur exil. Puissance occupante, investie de toutes les prérogatives et responsabilités, notamment le rétablissement de l’ordre et la mise en place d’une transition démocratique, les États-Unis multiplient les erreurs. La débaasification, qui consiste à éradiquer les membres du parti Baas dans le champ administratif, politique et militaire, est une politique extrêmement brutale d’exclusion de l’ancien personnel du régime de Saddam Hussein des nouvelles institutions. On se prive, largement pour des raisons idéologiques, de toute la technostructure sur laquelle s’était appuyé le régime pour gouverner le pays. Entendons-nous bien : même si le régime était déjà en voie de déliquescence, la débaasification aggrave ce processus en privant le pays de ses cadres les plus compétents.
L’autre erreur commise par l’administration Bush à l’époque, c’est la dissolution de l’armée irakienne : entre 400 000 et 500 000 soldats sont renvoyés chez eux. Or, une des caractéristiques des armées dans les régimes autoritaires, c’est l’inflation des grades supérieurs qu’on distribue pour coopter les militaires et garantir leur loyauté. En 2003, l’armée irakienne compte quelque 10 000 généraux, là où l’armée américaine n’en compte qu’un millier. Or ces généraux renvoyés chez eux se voient, du jour au lendemain, destitués et privés de toute ressource (salaire, retraite, prestige social) basculent dans l’insurrection armée. Pour les remplacer, l’administration américaine va faire appel à une autre « catégorie » en surnombre de ces régimes autoritaires : les exilés. Les exilés sont ceux qui, après chaque coup d’État ou changement de régime, ont fui le pays en profitant de l’accueil que leurs réservent les régimes hostiles au pouvoir en place. Dans le cas de l’Irak, c’est notamment en Syrie qu’iront se réfugier un certain nombre d’opposants.
Dans les années 1980, l’Iran est également une terre d’accueil de ces exilés, notamment des islamistes chiites victimes de la répression baasiste et qui ont été « réinjectés » dans l’Irak post-2003. Certains de ces anciens exilés, à l’instar de Hadi Al-Amiri, dirigent aujourd’hui une grande partie des combats contre l’EI.
Dans des sociétés déjà fragilisées et marquées par de fortes clôtures communautaires, la politique américaine, en confiant les rênes du pouvoir aux anciens exilés chiites, sème ainsi les germes d’une insurrection armée jihadiste dont est aujourd’hui issue l’EI.
Ce que les années 1990-2000 vont mettre au jour, de manière très explicite en Irak, ce sont les fondations extrêmement fragiles du pouvoir. La conquête éclair de Mossoul par l’EI en 2014 est de ce point de vue très révélatrice. L’armée irakienne n’est pas vraiment vaincue par l’irruption de quelques centaines de combattants jihadistes : elle refuse tout simplement de se battre pour défendre un gouvernement central discrédité et corrompu, de même qu’elle ne l’avait pas fait en 2003 lors de l’invasion américaine.
Ce n’est pas qu’une question de rapport de force : l’État, son armée, ses institutions, son territoire ne vont plus de soi et souffrent d’un déficit de légitimité. À défaut, ce qu’il reste de cet État est obligé de recourir à des potentats locaux et à des milices dûment stipendiées pour tenter de reprendre le contrôle de la situation.
Matthieu Rey : Le changement en Syrie au cours des années 2000 se déroule en trois temps. Le premier temps, c’est l’arrivée de Bachar al-Assad : le régime syrien est le seul régime arabe à réussir la succession père-fils, non sans tension toutefois. L’arrivée de Bachar al-Assad va modifier la donne établie par Hafez al-Assad de deux manières.
D’abord, à la différence de son père, il arrive tout de suite au sommet de l’État, sans lutte pour le pouvoir. Cette situation crée une autre mutation. Hafez al-Assad a gouverné en partenariat avec des grandes figures, des personnes qui sont montées avec lui, au cours des luttes pour le pouvoir dans les années 1970-1980. Ces derniers formaient un collège de conseils. Avec Bachar al-Assad, ils deviennent une menace et sont mis de côté. Son pouvoir se rétracte sur son clan : son frère et surtout son beau-frère, Rami Makhlouf qui va contrôler l’économie syrienne en la mettant au service du clan Assad au détriment d’une répartition plus équitable des richesses.
Ensuite, avant même son intronisation et à des fins de construction de son pouvoir par rapport à la vieille garde, Bachar al-Assad entre dans une logique de troc de la souveraineté syrienne en échange d’un soutien politique et économique de la part des puissances extérieures. En 1998, il reconnaît ainsi les frontières turques, entérinées par l’accord de 2005. Jusque-là, la Syrie refusait à la Turquie toute souveraineté sur le Sandjak d’Alexandrette, territoire donné par la France à la Turquie en 1939. Là où Hafez al-Assad s’inscrivait davantage dans une logique de sanctuarisation du territoire syrien, retournant la lutte d’acteurs extérieurs vers les autres pays du Moyen Orient, Bachar al-Assad réintègre les acteurs étrangers dans le jeu syrien. Il est donc prêt, pour accroître son pouvoir, à donner des segments de souveraineté.
Cet usage stratégique du territoire et de la souveraineté, à des fins de renforcement de son autorité, est décisif pour comprendre la période post-2011, avec un arrimage de plus en plus important aux partenaires iraniens et russes et l’implantation de l’EI dans l’Est de la Syrie.
Les modifications des années 2000 enfin sont provoquées par des secousses régionales : le renversement du régime irakien menace la Syrie – Bachar al-Assad pense être le prochain sur la liste – qui va s’évertuer à faire perdre la paix aux Américains pour les dissuader d’intervenir en Syrie. Le régime de Bachar al-Assad envoie donc des hommes en soutien à l’insurrection irakienne contre les Américains, en même temps qu’il participe à l’effort de coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme. C’est une stratégie habile du régime puisqu’il connaît ces individus qu’il a souvent lui-même contribué à former et à envoyer en Irak. Cette stratégie syrienne vise à entretenir le chaos irakien et non à le créer : c’est une fenêtre d’opportunité qu’elle investit pleinement à des fins de maintien du régime.
Loulouwa Al Rachid : Il y a un savoir-faire de ces régimes autoritaires en matière sécuritaire qui devient, après le 11 septembre 2001, une ressource extrêmement précieuse et « monnayable » à l’échelle internationale. C’est ce qui explique que les démocraties occidentales continuent de coopérer avec eux. Mais on a affaire, avec ces régimes, à des spécialistes de la sécurité… mais aussi de l’insécurité selon la demande.
Bachar al-Assad, en s’appuyant sur ses services de renseignement et sa police politique, va donc nouer des liens avec les jihadistes. Il laisse se développer à la marge un espace de circulation d’hommes, d’armes, d’argent, de trafics en tous genres, qui était déjà en germe dans les années 1990, mais qui va à ce moment-là prendre une tout autre ampleur.
C’est sur cet espace à cheval entre la Syrie et l’Irak (qui se dessine dans les années 2000) où la frontière étatique perd de sa pertinence qu’est aujourd’hui assis l’EI. Le phénomène auquel on assiste aujourd’hui est largement dû à une prolifération d’acteurs locaux, d’intermédiaires et d’entrepreneurs en mal de pouvoir et de richesses qui contrôlent désormais la population et qui s’inscrivent dans des logiques d’allégeance à la fois multiples et instables : certains roulent pour les Américains, d’autres pour les Saoudiens, les Syriens, les Iraniens.
Matthieu Rey : Les acteurs locaux ont besoin, pour se consolider sur le plan intérieur, du soutien de partenaires extérieurs – des puissances occidentales, de la communauté internationale – à qui ils vendent ce dont ils ont besoin. Dans le cas syrien, c’est la lutte contre le terrorisme qui leur a permis d’y parvenir. En Syrie, on ne peut toutefois pas parler, à la différence de l’Irak, de système milicien dans les années 2000 dans la mesure où le régime détient encore le monopole de la violence et autorise des trafics pourvu qu’il les contrôle.
Mais cette stratégie est risquée pour le régime qui envoie des hommes qu’il ne contrôle pas tout à fait se former au combat, qui reviennent en Syrie tout à fait aguerris et qui essaiment autour d’eux dans des lieux de socialisation plus ou moins formels, comme les prisons notamment mais aussi les réseaux de contrebande etc. Il sait tout de même enfermer ceux qui le menacent. Ainsi la prison de Saidnaya se remplit d’hommes revenus d’Irak, gage de la bonne volonté du régime à lutter contre le terrorisme. En 2011, devant la contestation, Bachar al-Assad décider de « céder aux pressions » de sa population et surtout de la communauté internationale : il libère des prisonniers politiques choisis judicieusement parmi ces hommes aguerris aux combats en Irak. Ce sont les futurs chefs des brigades jihadistes qui émergent en 2012 sur le territoire syrien. Au nom des réformes, le régime assure le déploiement d’activistes formés en Irak sur le territoire syrien.
L’autre bouleversement des années 2000 tient au retrait syrien du Liban. Sous la pression de l’ONU, les troupes syriennes partent et mettent fin à la prédation à grande échelle de ce territoire, les pratiques de prédation sont alors déployées en Syrie. Par l’intermédiaire de Rami Makhlouf, le régime ouvre le territoire syrien à de telles entreprises : des terres principalement agricoles sont ainsi transformées en complexes touristiques, ce qui dans un contexte de pénurie alimentaire fragilise encore plus la société syrienne. Parmi les zones, le Hawran, dont la capitale Deraa devient le lieu moteur de la révolution, est particulièrement affecté. Cette stratégie s’avère extrêmement profitable aux jeunes élites urbaines de l’entourage de Rami Makhlouf qui, du même coup, trouvent de nouveaux modes d’enrichissement en dehors du secteur des renseignements et de la police. Le régime se voit donc dans l’obligation de recruter son personnel policier ailleurs que dans les segments élitaires alaouites. Il puise notamment dans le vivier des tribus vivant aux alentours de villes comme Deir ez-Zor, c’est-à-dire à la frontière irakienne, et qui sont parties prenantes de tous les trafics dont on a parlé précédemment.
On assiste donc à une modification de la structure sociale concomitante à la montée d’un ressentiment extrêmement fort à l’égard de la famille Assad et une exacerbation des stratégies d’accaparement des ressources (pétrole notamment) sur le territoire syrien.
En 2011, le peuple syrien se soulève en remettant en cause les deux piliers du régime : la coercition, c’est-à-dire la torture systématique, et la prédation. Les périphéries géographiques qui en ont le plus fait les frais sont les premières à se soulever. Rapidement la contestation se militarise par la désertion des appelés. Devant cette nouvelle menace, le régime se replie, reprenant une technique très proche de la configuration irakienne. Il détermine un espace comme nécessaire et vital : Damas, Homs et la route vers la côte. Il se retire des autres espaces, notamment la frontière syro-irakienne, ouverte à partir de l’été 2012 à toute migration d’hommes en armes. Ce faisant, le régime délaisse une zone stratégique. Crée-t-il l’ État islamique ou s’entend-il avec lui ? Certainement pas. Mais il ne fait rien pour contrer son expansion.
La Vie des Idées : L’EI fonctionne de manière transnationale mais il est fortement ancré en Irak et en Syrie. Que doit plus spécifiquement l’EI à l’Irak d’une part, et à la Syrie d’autre part ? Et comment expliquer que ce soit cet « imaginaire syrien » qui se soit imposé dans le discours de l’EI ?
Loulouwa Al Rachid : C’est là qu’entre en jeu un autre élément clé dans la genèse de l’EI, à savoir le problème toujours non résolu depuis 2003, de l’exclusion des Arabes sunnites du pouvoir en Irak. Les sunnites étaient collectivement assimilés au régime de Saddam Hussein et devaient après 2003 en payer le prix. Depuis, ils expérimentent différentes postures : insurrection armée, boycott des élections, ralliement aux nouvelles institutions post-baasistes, protestations pacifiques, etc. Mais, au fond, ils n’acceptent pas le statut de minorité politique qui leur est dévolu dans le nouvel Irak en raison de leur infériorité démographique. Ils s’estiment lésés, humiliés, et déchus. La stratégie américaine consistant à armer les tribus sunnites pour se débarrasser d’Al Qaida en Irak a affaibli et divisé le monde sunnite en empêchant l’émergence d’un leadership fort ; elle a nourri le ressentiment des laissés-pour-compte de cette cooptation et provoqué des combats tribaux fratricides.
De ce point de vue, le gouvernement de Nouri Al Maliki (2006-2014) – qui fait partie de ces anciens exilés réfugiés en Syrie dont il a été question plus haut – pourtant placé sous le signe de la réconciliation entre chiites et sunnites, s’est montré particulièrement intransigeant à l’égard des Arabes sunnites, contribuant ainsi à leur radicalisation et au retour en force des groupes armés.
À partir de 2012-2013, à la faveur de la confusion et de la militarisation de l’arène syrienne et du printemps arabe, les éléments jihadistes reprennent, en effet, du service pour « venger » le monde sunnite. C’est donc sur ce terreau de l’exclusion et son corollaire, la radicalisation, que les militants historiques d’Al Qaida ont repris leurs activités et ont commencé à reformer leurs réseaux. Sauf qu’ici il n’est plus question de jihad contre les Américains mais contre l’autre communautaire : le chiite. Mais la matrice irakienne du jihad n’aurait pas suffi à développer cette force de projection de l’EI, et c’est là qu’entre en scène la Syrie.
Matthieu Rey : Du côté syrien, on a la fois un processus révolutionnaire à partir de 2011 (la population se soulève et est massivement réprimée) puis à partir du printemps 2012, une guerre entre les forces du régime qui bombardent les villes, et des groupes disparates se revendiquant de la révolution. Cette situation constitue la toile de fond de l’ingérence de l’EI. Ce dernier entre en Syrie en 2013. Il bénéficie de cet affrontement qui lui sert à teinter son discours d’universalité et en faire une lutte du Bien contre le Mal. Les destructions systématiques à l’encontre d’une population dont une partie importante est sunnite, sont captées par l’EI pour en faire un combat pour la défense de l’Islam écrasé dans l’indifférence de la communauté internationale. L’EI peut mobiliser un discours de l’humanité meurtrie dans son combat.
Sur le terrain, à partir de 2012-2013, profitant du champ libre laissé à la frontière entre la Syrie et l’Irak, les segments irakiens et syriens se rapprochent : c’est d’abord la naissance d’Al Nosra puis de l’EI. La différence entre les deux repose sur une question d’allégeance et sur le cadre du combat. Al Nosra prête allégeance à Al Qaida, parrain lointain qui permet à Al Nosra de rester dans un combat syro-syrien. Contrairement à des analyses en termes exclusivement de groupes terroristes, cette affiliation doit être perçue comme une manière de capter des ressources - celles des filières du jihad international - sans pour cela que le parrain étranger ne puisse réellement agir, n’étant pas sur place. Au contraire, l’EI revendique la naissance du combat en Irak et sa continuité en Syrie. L’EI met sur le même plan la lutte des sunnites contre l’oppresseur minoritaire chiite en Irak et celle des Syriens contre la minorité alaouite : en bref, dans le discours de l’EI, Nouri Al Maliki c’est Bachar Al Assad. Surtout, l’EI sort de la lutte révolutionnaire. Pour lui, le combat tient à l’établissement immédiat d’un califat, indépendamment du sort de la révolution. Que la révolution soit écrasée ou non, n’importe pas. Il peut régner sur l’Est syrien, et mettre en application ses idées. Les forces révolutionnaires deviennent vite sa principale cible.
Mais ce que fournit la Syrie à l’EI que ne fournit pas l’Irak, c’est un potentiel d’universalisation. Si l’EI était resté en Irak, il aurait été coincé dans un combat irako-irakien qui ne porte pas au-delà. La question irakienne ne fait pas vraiment sens pour la majorité des populations extérieures. En outre, la myriade des groupes armés empêche de voir qui affronte qui. L’EI aurait été une milice parmi les milices. La Syrie permet à l’EI de profiter de l’élan révolutionnaire. Il peut instrumentaliser ce discours de l’humanité meurtrie : des images de torturés, la reproduction d’un imaginaire de sens pour toutes les populations arabes du tout-puissant contre le faible, de celui qui a tous les droits contre celui qui n’a rien, celui qui peut utiliser toute la violence contre celui qui ne peut s’en défendre. Cet imaginaire fait référence pour les populations arabes à deux situations : celle du colonisateur dont la mémoire reste présente, et surtout celle de la lutte israélo-palestinienne.
Grâce à la Syrie, l’EI capitalise sur le sentiment d’injustice, alors que sur le terrain, l’EI écrase la révolution syrienne dont le projet n’a rien à voir avec lui. Il élimine les cadres de la révolution de 2011, qu’il considère comme ses ennemis puisqu’il s’agit là d’acteurs capables de mener un combat armé et de construire une autre société que celle voulu par l’EI. L’EI est en concurrence direct avec les révolutionnaires de 2011, sauf qu’il sait pratiquer des campagnes de répression à leur encontre.
À la différence du régime de Bachar al-Assad, et c’est ce qui fait la force de l’EI, les hommes recrutés par l’EI, qui appartiennent pour une partie aux familles mises de côté par la révolution (le cousin de l’ancien représentant du parti, etc.), connaissent très bien le terrain et la clandestinité. Ils connaissent très bien leur société. Ils savent donc qui ils doivent arrêter ou tuer. L’EI représente donc une menace bien plus importante que le régime pour cette ‘autre Syrie’ revendiquée depuis 2011.
La Vie des Idées : Comment caractériser le rapport de l’EI à la violence ? Est-il inédit ?
Matthieu Rey : L’EI n’entretient pas avec les populations une relation de contrôle similaire à celle d’un Etat ordinaire. Il requiert de leur part une allégeance de tous et de chacun, divisant la société en autant de groupes. Il s’agit d’un dialogue, d’un partenariat stratégique avec les intéressés, en envoyant une série de signaux qui peuvent aller de l’extrême violence (massacres d’une tribu pour l’exemple) à une simple mise en garde et une invitation au dialogue, selon une logique pragmatique très similaire à celle des régimes baasistes. Ici le cas de la ville de Tal Abyad à la frontière syro-turque est tout à fait parlant : cette ville (reprise depuis par les Kurdes) est « tombée » dans les mains de l’EI sans un seul combat mais par une série de tractations. En outre, de par leur très bonne connaissance de la société, ils savent également jusqu’où ils peuvent aller dans leur stratégie de conquête, ils s’abstiennent d’entrer dans les territoires qu’ils ne s’estiment pas en mesure de pouvoir les contrôler. Ils étendent leur influence de manière graduée.
Sur la violence, un point sur lequel on n’insiste pas assez, est que certes l’EI a des comportements sanguinaires et brutaux extraordinairement spectaculaires. Mais dans un contexte où le niveau violence est déjà extrêmement élevé et incommensurable. Quantitativement, il ne pratique que faiblement la violence. Entre la Syrie et l’Irak, ces sociétés sont les témoins depuis des décennies, de centaines de milliers de morts, de torturés, de réfugiés…Aujourd’hui en Syrie on compte cinq millions d’assiégés qui sont en train de mourir de faim. La force de l’EI c’est d’être parvenu à légitimer cette violence extrême au nom d’un combat pour le juste et le bien, d’où leur besoin de la Syrie, beaucoup plus que de l’Irak aujourd’hui.
Loulouwa Al Rachid : L’EI opère dans des sociétés où la violence est banalisée voire esthétisée, notamment parmi la jeunesse des marges économiques et géographiques. L’EI est clairement une entité violente, révolutionnaire en ce sens qu’il cherche à fonder un ordre nouveau, moral, sacré, territorial, administratif, militaire. Mais la violence dont il fait preuve sur le terrain irako-syrien n’a rien à voir avec celle qu’on a connue en France en 2015 ; elle s’insère dans une logique d’imposition d’un ordre nouveau qui, à cet égard, représente de nombreuses similarités avec la violence pratiquée par les régimes baasistes. La violence signale, par le massacre d’une tribu par exemple ou par l’exécution des traîtres et des espions, les lignes rouges à ne pas franchir, l’impératif de l’obéissance absolue. Il y a un dosage judicieux de la cruauté allié à une très bonne connaissance de la société.
Même s’ils comptent dans leurs rangs de nombreux jihadistes venus de l’étranger, notamment d’Europe, les hommes de l’EI ne sont pas des exilés qui ont coupé les liens avec leur société pendant des décennies et qui, quand ils la voient en face, sont pris d’horreur. Ce sont des gens fortement enracinés dans le tissu social local : ils en connaissent parfaitement les fractures et les maillons faibles. C’est cet enracinement local qui fait leur force.
C’est pour cela que si on peut les qualifier de terroristes ici en France, ce terme n’est pas pertinent là-bas. La dynamique de l’EI en Irak n’est pas, comme en Syrie, une dynamique révolutionnaire, mais s’inscrit davantage dans un processus de sécession territoriale, administrative et politique du monde sunnite vis-à-vis du centre. Et c’est parce que c’est davantage une guerre de sécession que l’issue en Irak sera sans doute plus aisée qu’en Syrie. Selon moi, le phénomène EI est moins difficile à déconstruire du côté irakien que du côté syrien, en raison de son enracinement très local. Si on arrive à découpler la matrice syro-irakienne, à réinscrire l’EI dans un jeu irako-irakien, alors le gouvernement de Bagdad et la coalition internationale anti-EI pourront peut-être commencer à résoudre la situation. Dans tous les cas, le phénomène État islamique n’est pas réductible à un phénomène terroriste au Levant. Marieke Louis 15 février 2016