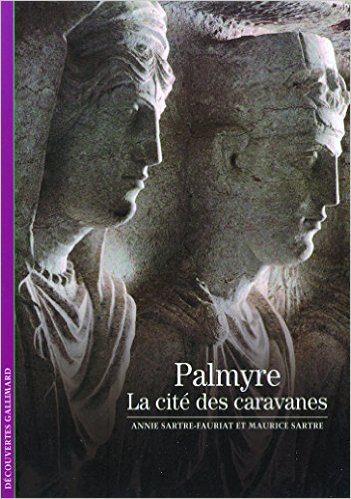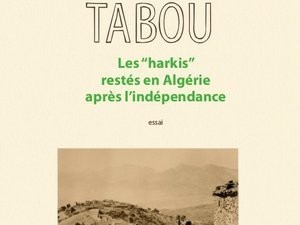Nous semblons loin du temps des colonies. Non parce que les puissances occidentales justifient par les droits de l’homme leurs expéditions militaires (déjà la colonisation…). Mais les rapports de force à travers le monde semblent chamboulés avec le déclin de la France et autres pays d’Europe, la montée des « émergents », la « mondialisation ».
Et une guerre entre pays développés, ce spectre qui hantait le début du 19ème siècle, semble aujourd’hui inconcevable. Le concept marxiste d’« impérialisme » forgé alors est-il donc obsolète ? Nous empêche-t-il de penser le monde tel qu’il est ? Nous tentons dans ce dossier, d’un côté, de retrouver le fond des analyses de l’impérialisme au début du 20ème siècle et, d’un autre, d’ausculter quelques grandes lignes d’évolution structurantes de notre époque : l’hégémonie américaine, la puissance nouvelle de la Chine, la mort prétendue de la Françafrique... Car pour agir, il faut comprendre dans quel ordre (et désordre) mondial nous vivons.
« L’impérialisme, stade suprême du capitalisme »
Quel drôle de titre que celui de l’ouvrage de Lénine en 1916 ! Un accent prophétique, voire apocalyptique. Mais nous étions alors justement en pleine apocalypse : en pleine guerre mondiale. Or ce titre se veut une synthèse de toutes les analyses non seulement de Lénine, mais de tout le courant marxiste révolutionnaire d’avant 1914, dont Rosa Luxemburg, dont le « pape du marxisme » d’alors, Karl Kautsky, sur lequel pourtant Lénine tape dur.
Ces marxistes, dès 1900, avaient tenté de saisir la nouveauté de leur époque (exemple à suivre). Pour eux, le partage du monde en colonies et la marche à la guerre n’étaient pas le résultat d’une politique fortuite, ou de l’aventurisme de quelques secteurs des classes dominantes, mais une forme inévitable du capitalisme moderne. « Stade suprême » du capitalisme, l’impérialisme était même la « phase terminale » d’un système « en putréfaction », désormais profondément parasitaire. Non qu’il allait s’effondrer tout seul. Mais ce nouvel impérialisme, qui entraînait le monde vers une guerre terrifiante, ne faisait décidément plus progresser la société. Il était donc « mûr pour être remplacé par un système qui ferait bien mieux : le socialisme ». Dixit Karl Kautsky, dans sa brochure de 1907 « Socialisme et politique coloniale ».
A partir de la fin du 19ème siècle, la libre concurrence capitaliste accouche via l’élimination des entreprises les plus faibles d’oligopoles, des trusts industriels d’un côté et des trusts bancaires de l’autre, qui tendent à fusionner sous la domination du capital financier. S’enchaîne alors l’étape suivante : une interpénétration inédite entre ce capital financier et l’État. Au fond, chacun a profondément besoin de l’autre. Les trusts ont besoin du soutien de l’État et l’État moderne doit s’appuyer sur les forces du capital. Et ça tombe bien : celui-ci est désormais assez riche et puissant pour dominer le personnel politique.
Ce capitalisme peut avoir un certain dynamisme, mais il souffre de « disproportions » permanentes (Kautsky toujours…) : le retard, par rapport à l’industrie, de l’agriculture (ce qui provoque une crise de pénurie des matières premières et des biens alimentaires) et de la consommation (qui provoque une crise de surproduction et de sous-consommation, car le capital, exploitant ses travailleurs, ne peut les payer assez pour développer ses marchés de consommation, sauf à menacer le taux de profit). Ces limites internes au développement du capitalisme conduisent les capitalistes à repousser leurs limites géographiques en cherchant dans les pays agraires matières premières et débouchés commerciaux.
Les exportations britanniques passent de 13 milliards de francs en 1870 à 35 en 1913, les allemandes de 5 à 25 (les françaises sont alors à 15 milliards). Selon Daniel Cohen[1], les exportations de marchandises sont passées de 5,1 % du PIB mondial en 1850 à 9,8 % en 1888, 11,9 % en 1913. Elles s’effondreront avec la guerre et ne retrouveront leur niveau de 1913... qu’en 1973.
L’exportation des capitaux, tendance majeure du nouvel impérialisme
Mais le capitalisme des pays développés cherche surtout à exporter des capitaux, car il a une difficulté croissante à trouver des placements rentables dans ses bastions déjà industrialisés. Ainsi selon Suzanne Berger[2], à la veille de 1914, « entre le tiers et le quart de la richesse nationale globale [française], en dehors de la terre et de l’argent destiné à la consommation, était placé à l’étranger (…) Les investissements à l’étranger représentaient en 1907 près de 40 % de la richesse nationale des Britanniques. » Des chiffres considérables ! Avec une nuance importante : Grande-Bretagne et France exportent davantage leurs capitaux que l’Allemagne et les États-Unis, parce qu’elles disposent de grands empires, peut-être, mais surtout parce qu’elles sont moins dynamiques sur leur propre sol.
Or Luxemburg et Kautsky insistent sur les conséquences profondément réactionnaires, dramatiques autant économiquement que politiquement, de cette expansion capitaliste d’alors. Elle accélère la course aux colonies (déjà en elle-même une insulte à la dignité des peuples) car le capital, quand il exporte non seulement ses produits, mais lui-même, par des investissements fixes, des infrastructures ou des prêts à des États étrangers, a d’autant plus besoin de la protection de son État national. Les capitalistes ont peur que leurs investissements n’aient pas une rentabilité garantie, soient récupérés par les classes dominantes des pays d’accueil (qui pourraient même imiter les Japonais, à leur tour s’industrialiser et devenir de nouveaux concurrents), ou pire encore par des puissances capitalistes rivales. D’où leur aspiration à la mise sous tutelle directe ou indirecte par leur État. Sont ainsi découpés en tranches des continents entiers, non seulement l’Afrique directement colonisée, mais aussi de grands empires en déclin, la Turquie, la Chine.
Mais l’exportation des capitaux (à la force des armes) ne pouvait-elle permettre aux « peuples arriérés » de moderniser leurs économies et s’arracher à leur soi-disant « sauvagerie » ? Luxemburg dans L’Accumulation du capital (1912), Kautsky dans de multiples textes, exterminent impitoyablement ces préjugés et espoirs (hypocrites) qui courent jusque dans le mouvement ouvrier, dans des pages terribles sur ce qu’on appellerait aujourd’hui le « développement du sous-développement » sous l’impulsion du capital étranger.
La « dette du tiers-monde », déjà…
C’est que ces exportations de capitaux ont des caractéristiques assez particulières. Ainsi la France envoyait finalement peu de ses capitaux dans ses colonies : en 1914, 4 milliards de francs sur 45 investis à l’étranger, contre 25 % en Russie ! Et pour faire quoi ? Des investissements « directs » finançaient des capacités de production mais, en l’occurrence, surtout l’extraction de matières premières et des infrastructures de transport. Ces investissements sont fort utiles pour piller les richesses d’un peuple, mais n’élèvent pas la productivité générale du travail local et n’enclenchent pas une dynamique d’industrialisation et de modernisation (même pas des relations sociales, au contraire, vu l’usage d’une main-d’œuvre indigène quasi servile).
Plus importants étaient les investissements « de portefeuille », comme des prêts de consortiums bancaires occidentaux à des gouvernements de pays pauvres. Des Etats empruntaient pour moderniser leurs infrastructures et s’armer. Ils exploitaient durement leur population pour rembourser, et le chemin de fer servait moins à donner accès au marché mondial à la paysannerie qu’à la faire exproprier, à développer des cultures d’exportation, ruiner les producteurs locaux submergés par les marchandises des pays industrialisés (et les prêteurs). Le défaut de paiement d’un État faible ouvrait la voie à la colonisation. C’est ainsi qu’en 1881, le défaut du bey de Tunis servit de prétexte à une démonstration de force française et au Traité du Bardo qui transforma le pays en protectorat français.
Si l’État endetté était trop puissant pour se laisser dévorer, la dette publique lui servait de toute façon à renforcer l’oppression de son peuple et en même temps garantissait une poule aux œufs d’or pour les créanciers étrangers. C’est ainsi que le tsar se gava d’emprunts contractés à la Bourse de Paris. Les grandes banques françaises placèrent ces emprunts auprès de centaines de milliers de bourgeois et de petit-bourgeois. Chaque mois, le rentier français « tondait les coupons » en allant percevoir à la banque ses dividendes, sueur et sang des moujiks. En favorisant cette perfusion financière, les dirigeants politiques français s’acoquinaient avec les banquiers français et achetaient l’alliance militaire russe.
Pour les marxistes, la compréhension de ces phénomènes leur permit de saisir clairement qu’il ne pouvait pas y avoir de « colonisation progressiste », alors même que le mouvement socialiste était très divisé sur cette question, entre une aile droite carrément « social-impérialiste » et une mouvance platement humaniste (comme Jaurès, qui dénonçait les crimes coloniaux mais en appelait parfois à une colonisation juste). Ces déchirures se traduisirent par les ruptures que l’on sait quand éclata la Première Guerre mondiale.
1914 : une guerre impérialiste
En 1914, selon Lénine, « le partage du monde est terminé ». C’était une exagération : de gros gâteaux aiguisaient encore les rivalités. Mais les disparités technologiques et militaires étaient telles que les colonisateurs n’avaient eu guère de mal à se tailler des empires en quelques décennies... tant qu’ils ne se heurtaient pas les uns aux autres. Le partage en colonies et en « sphères d’influence » s’était fait sur des rapports de forces politiques et économiques. Or ces forces avaient changé : la France et la Grande-Bretagne, désormais en relatif déclin économique, s’étaient taillées la part du lion par rapport à des challengers devenus plus puissants (les États-Unis) ou plus dynamiques (l’Allemagne, le Japon).

Comment envisager alors un nouveau repartage, sinon par la force armée ? Le spectre de la guerre généralisée hantait donc tous les peuples d’Europe. Quand elle éclata, le mouvement socialiste aussi. Une aile révolutionnaire déclara la guerre à la guerre impérialiste, la plupart des directions socialistes se rallièrent à l’union sacrée au nom de la « défense nationale ».
La guerre était-elle « absolument » impérialiste ? Il est de bon ton depuis quelques années de nuancer la nuance de la nuance et de déplorer comme véritable « raison » de la guerre un enchaînement malheureux de malentendus et d’aveuglements[3].
Mais les dirigeants marxistes de l’époque ne prétendirent jamais que la guerre avait été simplement commanditée par les financiers et les marchands de canons, ni perpétrée pour le seul repartage des colonies africaines. Pour faire une théorie utile de leur époque, il fallait bien saisir les évolutions essentielles, radicalement nouvelles et terriblement dangereuses, de leur époque, sans se jouer de mots ni garder des habitudes de pensée héritées de l’époque précédente. En analysant la guerre comme « impérialiste » (de pillage, de partage du monde au profit des capitalistes), ils pensaient ce qu’avait proclamé la résolution de Bâle de 1912, qui avait fait l’unanimité du congrès de l’Internationale socialiste : « la guerre à venir sera faite pour les profits des capitalistes et l’orgueil des dynasties ».
Les cliques aristocratiques en Allemagne, en Autriche-Hongrie, en Russie, avaient leurs propres motivations (précipiter leur peuple dans la guerre pour consolider le trône). Ce qui n’empêcha pas la République française de pousser à la roue elle aussi ! Or, la symbiose grandissante de l’État et du capital financier joua à plein : des secteurs importants du capitalisme exigeaient le soutien militaire de leurs États pour étendre leurs sphères d’intérêt, réciproquement les sommets des États exigeaient le soutien des milieux financiers pour mener leur diplomatie agressive. Ils s’étaient liés les uns aux autres pour le pire et le pire. Les enjeux dépassaient les colonies, africaines par exemple, pas si rentables d’ailleurs : aux portes des grandes puissances, toute l’Europe centrale et l’empire ottoman étaient en décomposition. Qui allait s’y tailler des sphères d’influence telles qu’il prendrait un ascendant décisif sur ses rivaux ?
Surtout, la guerre devint mondiale et totale. Plus elle durait et coûtait, plus les enjeux grimpaient pour les gouvernements. Ruinés financièrement, l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne comptaient bien, pour se relever, se payer sur la bête, dévorer les restes de l’empire turc, extorquer des réparations aux vaincus, et payer les sacrifices de leurs populations par du poison nationaliste plutôt que par des réformes sociales. L’impérialisme fit la guerre, la guerre le lui a bien rendu. Ses conséquences (et les buts de guerre des puissances) seraient fatalement bien plus impérialistes encore que ses causes.
La querelle de l’« ultra-impérialisme »
Il était donc impensable qu’il puisse y avoir une « bonne issue » à la guerre, une paix « sans vainqueurs ni vaincus », une paix durable entre les puissances. C’est pourtant l’idée que caressait avec de plus en plus d’insistance Karl Kautsky et bien d’autres au sein des courants de la social-démocratie qui se redécouvraient pacifistes et se désolidarisaient de leurs camarades, partisans de la « guerre jusqu’à la victoire ». Kautsky formula ainsi son idée dans L’impérialisme et la Guerre, en septembre 1914 : « L’impérialisme est-il la forme finale de la politique capitaliste mondiale ? (…) La classe capitaliste ne se suicidera pas. L’effort pour conquérir des régions agraires et réduire en esclavage leur population est trop vital pour le capitalisme pour rendre possible une opposition sérieuse de quelque groupe capitaliste que ce soit. » Mais : « Il y a un autre aspect dans l’impérialisme. L’effort de la colonisation a amené des conflits profonds entre les groupes capitalistes et a amené la guerre mondiale depuis longtemps prophétisée. Cette phase de l’impérialisme est-elle nécessaire pour la continuation du capitalisme ? (…) D’un point de vue purement économique, il n’est pas impossible que le capitalisme soit sur le point d’entrer dans une nouvelle phase, marquée par le transfert des méthodes de cartels à la politique internationale, une sorte d’ultra-impérialisme. »
Kautsky ne parlait pas (pour l’instant en tout cas) d’une nouvelle phase de l’histoire du capitalisme qui eût été « non impérialiste », mais d’une nouvelle phase (pacifique, mais tout de même exploiteuse du reste du monde) de l’impérialisme lui-même. Sur la base de cette hypothèse, il rejeta toute politique révolutionnaire contre la guerre, pour lui aventuriste, pour proposer un programme de paix « démocratique » qui puisse rallier des secteurs de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie. D’où la colère de Lénine contre le « renégat » : « cet ultra-impérialisme est une ultra niaiserie » et une « mystification petite bourgeoise » !
L’ultra-impérialisme américain
Les traités « de paix » (allemand de Brest-Litovsk puis allié de Versailles) lui donnèrent raison. Il y avait pourtant une exception, apparente mais de taille : à la Maison Blanche. Le président Wilson présenta un programme de paix en « quatorze points » : ni annexions ni réparations, droit des nations à disposer d’elles-mêmes, Société des Nations, liberté des mers et du commerce... Le plus grand impérialisme ne proposait-il pas ainsi un ordre mondial « ultra-impérialiste » ? Une entente entre les puissances, non pour cesser de piller les pays pauvres, mais pour renoncer aux empires économiques exclusifs et à la guerre ?
Cet « idéalisme wilsonien » était en fait un réalisme politique propre à l’impérialisme américain, tellement fort économiquement, et inexpugnable dans son île-continent, qu’il avait intérêt à promouvoir l’idée d’un autre type « d’empire », sans colonies et libre-échangiste (mais pas sans respect des dettes, car il ne renonça pas aux milliards de dollars de créances sur ses « alliés »). Comme le notera plus tard avec humour Léon Trotski, « l’impérialisme américain a toujours un peuple à libérer. C’est sa profession. »[4] Les gouvernements américains échouèrent cependant à imposer ce nouvel ordre mondial. Il arriva au contraire ce qu’on sait : la Dépression de 1929, la dislocation des relations économiques internationales, puis la Deuxième Guerre mondiale.
Après 1945 : un monde nouveau
Pourtant, un certain trouble s’éveille en nous : l’« ultra niaiserie » ne se serait-elle pas finalement réalisée après 1945 ? Ne serait-ce pas l’ordre impérialiste dans lequel nous vivons encore aujourd’hui ? Les rivalités économiques entre les divers pays capitalistes n’ont certes pas disparu, et suscitent souvent tensions et coups tordus. Mais la guerre, ce n’est plus entre les pays développés, c’est pour les pauvres depuis longtemps et, semble-t-il, pour longtemps.
Mais alors, pourquoi une hypothèse absurde en 1918 avait-elle pris corps en 1945 ? L’argumentation de Lénine contre Kautsky pourrait paradoxalement nous mettre sur la piste. Ainsi, dans la préface à la brochure de Boukharine L’Economie mondiale et l’impérialisme, en décembre 1915, il écrit :
« Il n’y a pas trace de marxisme dans ce désir de tourner le dos à la réalité de l’impérialisme et de s’évader en rêve vers un «ultra-impérialisme» dont on ignore s’il est réalisable ou non (…) Peut-on cependant contester qu’il soit possible de «concevoir» abstraitement une phase nouvelle du capitalisme après l’impérialisme, à savoir l’ultra impérialisme ? Non (…) Seulement dans la pratique, cela signifie devenir un opportuniste, qui nie les tâches aiguës de l’actualité au nom de rêveries sur des tâches futures sans acuité (…) Il ne fait pas de doute que le développement va dans le sens d’un seul et unique trust mondial (…) Mais ce développement s’opère dans des circonstances, sur un rythme, avec des contradictions, des conflits et des bouleversements tels (et non seulement économiques, tant s’en faut, mais aussi politiques, nationaux, etc.) que, sans aucun doute, avant qu’on n’en arrive à un tel trust mondial (…), l’impérialisme devra inévitablement sauter et le capitalisme se transformera en son contraire. »
L’hypothèse de Kautsky supposait des « bouleversements » extraordinaires. Qui eurent lieu. Car pour le coup il y eut bien une « époque de guerres et de révolutions », qui nulle part ne déboucha sur le socialisme (sinon des grimaces de socialisme, staliniennes ou social-démocrates). En 1945, les impérialismes japonais et allemand étaient écrasés, la France et la Grande-Bretagne plus ruinées qu’en 1918. Face aux révolutions coloniales, au « péril rouge » et au bloc soviétique, les puissances impérialistes n’avaient pas d’autre choix que de serrer les rangs et d’accepter l’hégémonie américaine, qui instaura ce que le trotskyste argentin Claudio Katz appelle un « ordre impérialiste collectif »[5], conflictuel mais coopératif, par les accords financiers et monétaires de Bretton Woods, le plan Marshall, son parapluie militaire, la protection des flux financiers par leurs marchés et le dollar, énergétiques par leur force armée.
Ensuite s’engagea ou se confirma une mutation économique profonde. Pour les marxistes, ce sont les limites internes du capitalisme dans ses bases nationales développées qui avaient engendré les conflits inter-impérialistes. Marx n’en avait pas moins noté à propos du développement du capitalisme : « potentiellement illimité ». Mais à travers tant de crises et de souffrances...
L’essor de la mécanisation et de la taylorisation, l’industrialisation de l’agriculture, le développement d’une consommation de masse, le nouveau rôle de l’État au sein de l’économie capitaliste, toutes ces mutations qui ont émergé à travers la crise de 1929 puis la « guerre totale » ont donné un nouveau souffle au capitalisme pendant quelques décennies. Le capitalisme des Trente Glorieuses a été beaucoup moins internationalisé que dans la période précédente, plus centré sur les pays déjà développés.
Le pillage des richesses du « tiers-monde » n’avait pas cessé pour autant. Il fallait garantir des rentes néocoloniales, payer à bas prix les matières premières (ce n’est d’ailleurs qu’après la Deuxième Guerre mondiale que les pays développés commencèrent à importer vraiment leur énergie !). Toute cette période, faite de paix inter-impérialiste, de guerre froide et de guerres chaudes contre des pays pauvres, fut marquée par la fine pensée que l’on prête au secrétaire d’État américain Kissinger, dans les années 1970 : « les Américains ont compris qu’il est plus funny de botter le cul des Arabes de temps en temps que de faire des économies d’essence. » Après 1945, l’impérialisme américain eut toujours un peuple à bombarder… Ce fut en quelque sorte sa profession.
« Ultra » pour les Vietnamiens, les Algériens, les Africains, les Irakiens, les Chiliens... les impérialismes le furent dans le sens le plus banal du terme après 1945.
Yann Cézard
dans la revue L'Anticapitaliste n° 273 (février 2016)
------
[1] La Mondialisation et ses ennemis, Grasset, 2004.
[2] Notre première mondialisation. Leçons d’un échec oublié, Seuil/La République des idées, 2003.
[3] Les Somnambules (2014) de Christopher Clark sont un modèle (par ailleurs passionnant) du genre.
[4] Europe et Amérique, 1924.
[5] Dans un livre très intéressant, Sous l’Empire du capital (l’impérialisme aujourd’hui), M Editeur, Québec, 2014.