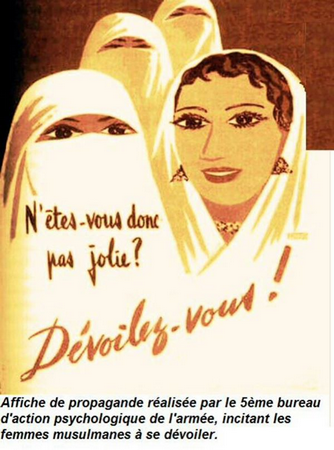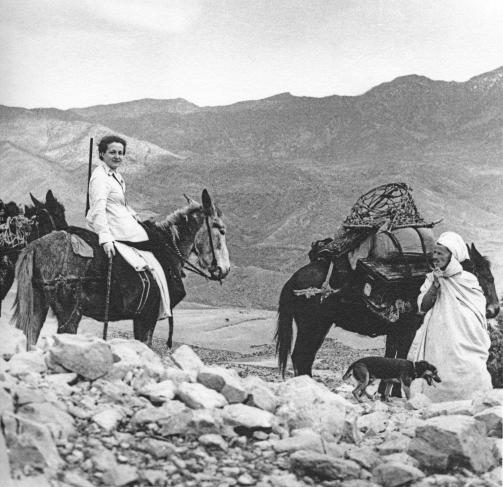Par Samy Joshua
Par Samy Joshua
Gilbert Achcar a fait ses classes politiques au Liban. Il est professeur à la School of Oriental and African Studies à Londres. Il est un des meilleurs spécialistes des questions qu’il traite (un «expert» pourrait-on dire, si ce terme ne s’attirait le dédain de l’auteur tout au long du livre, à juste titre, tant il en est d’autoproclamés sur la scène médiatique). Or éclairer ces questions dans l’état de confusion où la gauche française est plongée, en particulier depuis les attentats de janvier 2015 et leur suite, est une ardente nécessité. Ce court ouvrage y contribue grandement. Il comporte quatre contributions écrites à des dates différentes, dont l’une sur les rapports de Marx et l’orientalisme spécialement pour cette occasion. La première parution du livre s’est faite en anglais en 2013.
«Religion et politique aujourd’hui: une approche marxiste»
Le premier article concerne la conception marxienne de la religion, et l’analyse de la relation entre religion et politique en général, et plus spécialement l’analyse comparée de la théologie de la libération et de l’intégrisme islamique. L’auteur avance que «le fait que la religion survive encore à l’aube du Ve siècle après la «révolution scientifique» est une énigme pour quiconque adhère à une vision positiviste du monde, mais pas pour un entendement marxiste authentique… non seulement la religion a survécu jusqu’à notre époque en tant que partie de «l’idéologie dominante», mais elle a produit encore également des idéologies combatives de contestation des conditions sociales et/ou politiques en vigueur.».
Les marxistes sont familiers de la fameuse Introduction à la Critique du Droit de Hegel, dans laquelle Marx donne ses formules tant citées: la religion est une expression de la «misère»; «l’expression sublimée» de la «misère réelle». Et aussi une protestation contre cette situation. Mais malheureusement, selon Achcar, «Marx n’a pas poursuivi sa réflexion sur la dimension «protestation» de la religion». De même que «Engels tenta maladroitement d’expliquer Münzer comme une «anticipation en imagination du communisme», et la dimension chrétienne comme un simple déguisement». Autrement dit, Achcar critique une vision trop peu dialectique entre la forme (religieuse) et le fond (social), comme si les deux n’interféraient pas. Or, ils le font, et il convient d’analyser ces liens dans chaque cas: quelle période historique, mais aussi quels thèmes religieux. C’est au nom même du matérialisme historique que l’auteur plaide «pour une sociologie comparative marxienne des religions». Où le concept d’origine Wébérienne «d’affinités électives» tiendrait une place importante (là entre certains aspects du «christianisme dans sa phase charismatique et un programme social communistique» repéré chez Thomas Münzer).
Analyse que Achcar applique à la théologie de la libération d’un côté, à l’islamisme radical de l’autre. D’où il ressort que: «Tous les courants de l’intégrisme islamique se dédient pareillement à ce qui peut être décrit comme étant essentiellement une «utopie médiévale réactionnaire». L’affirmation que «L’idée orientaliste superficielle…selon laquelle l’intégrisme islamique est le penchant «naturel» anhistorique des peuples musulmans est totalement aberrante». Alors que: «Le parti le plus grand parmi les partis communistes qui n’étaient pas au pouvoir dans le monde (était), un parti qui s’appuyait officiellement, donc, sur une doctrine athée, se trouvait dans le pays comptant la plus grande population musulmane: l’Indonésie». Et que, d’un autre côté, «Nasser fut, sans aucun doute, un croyant sincère…quand bien même il devait devenir le pire ennemi des intégristes. » Gilbert Achcar résume alors ce qu’il a développé depuis longtemps quant aux racines qui ont permis le développement de l’islamisme. Défaite du nationalisme et carences de la gauche radicale; intégrisme promu contre la gauche par le royaume saoudien et son parrain américain; l’exacerbation de la crise…dans le Moyen Orient élargi; effets de l’offensive néolibérale et effondrement du « communisme soviétique».
Un commentaire sur ce sujet complexe de la religion aujourd’hui. Si on peut approuver aisément l’auteur sur tous les points développés, il faudrait parvenir à élargir le tableau aussi à l’indéniable tendance mondiale à la sécularisation. Car si, incontestablement, la religion «survit», cela va de pair avec la progression d’un autre phénomène. Les enquêtes montrent que jamais les agnostiques déclarés (et même les athées explicites) n’ont été aussi nombreux dans le monde, et ceci y compris en pourcentage de la population. Phénomène qui touche désormais un pays aussi ancré dans les religions que les Etats-Unis. Et qui, à l’évidence, est une «marque de fabrique» de l’Europe (et, loin devant encore, de la Chine). Et ce malgré le quasi-écroulement de la perspective de tradition marxiste. Comment rendre compte de ceci est une question en soi. Et plus encore, dans la sociologie marxiste des religions que Achcar appelle de ses vœux, se pose celle de la manière dont peuvent cohabiter les religions (dans leur diversité) et cette tendance de fond, au moins dans les endroits où elle est avérée, et ailleurs peut-être si elle se confirme dans les décennies à venir.
«L’orientalisme à rebours: sur certaines tendances de l’orientalisme français après 1979»
Le second article concerne la manière dont certains critiques de l’orientalisme classique ont évolué vers un «orientalisme à rebours», inversant les présupposés essentialistes du premier, tout en les conservant comme cadre méthodologique. Gilbert Achcar s’appuie sur le livre de Sadik Jala Al-Azm, Orientalism and Orientalism in Reverse, paru en 1981 (Khamsin, N° 8, Londres, Ithaca, 1981) avec ses deux catégories : « la première, déjà identifiée par Edward Saïd, consiste en une reproduction de la dichotomie essentialiste…mais avec des valeurs inversées…». La seconde est synthétisée par l’auteur en 6 points.
1° L’Orient islamique et l’Occident sont antithétiques, y compris en ce qui concerne le marxisme; 2° le degré d’émancipation de l’Orient ne peut être mesuré à l’aune de critères occidentaux, comme la démocratie, la laïcité et la libération des femmes (on peut y ajouter je suppose la considération des orientations sexuelles); 3° les instruments épistémologiques des sciences sociales occidentales sont entièrement non pertinents dès qu’ils sont «exportés»; 4° la force motrice fondamentale qui meut les masses musulmanes est d’ordre religieux; 5° la seule voie des contrées musulmanes vers leur renaissance passe par l’Islam; 6° les mouvements de «retour à l’Islam» ne sont jamais réactionnaires mais des mouvements progressistes.
L’auteur s’attache alors à décrire l’évolution de ce positionnement chez les orientalistes français après 1979 (révolution islamique iranienne), même si, bien entendu, la question ne se limite pas à eux. Si on laisse de côté Michel Foucault, qui, certes sans retour critique, mis fin assez rapidement à son soutien aux processus iraniens, cela concerne les penseurs phares dans le domaine: Olivier Roy, Olivier Carré, Gilles Kepel, François Burgat, entre autres. Dont les évolutions furent diverses, parfois contraires sur le plan politique (avec par exemple pour certains la mise au service des officines impérialistes de cette «compréhension» jugée imparable). Avec désormais sur la scène française « …deux écoles. L’une a été appelée «néo-orientalisme» par Farhad Khosrokhavar, bien qu’il s’agisse plutôt d’une tendance inhérente à «l’orientalisme» traditionnel; en deux mots, c’est l’idée que l’islam est incompatible avec la modernité. J’ai appelé l’autre école «nouvel orientalisme», car elle est véritablement nouvelle, et l’ai définie comme soutenant l’idée que l’islam… est en fait la seule et incontournable voie du monde musulman vers la modernité». Les deux partageant «un noyau commun…la vision essentialiste».
L’auteur pourtant ne néglige pas de faire soigneusement la part entre ceux qui se rangent derrière les dominants occidentaux, et ceux qui, comme Burgat, se sont engagés « …courageusement…contre la vague d’islamophobie» touchant la France, même si c’est « …avec d’énormes illusions». Car on ne peut sans précautions étendre la condamnation de régressions historiques de grande envergure à la discrimination portée envers des populations minoritaires d’Occident. Complexité des positionnements politiques indispensable sur ces questions cruciales, excluant le simplisme, et condition incontournable d’un débat de fond.
«Marxisme et Cosmopolitisme»
L’auteur décrit quatre conceptions du cosmopolitisme à travers l’histoire. Ethique (remontant à Diogène se déclarant «citoyen du monde»); institutionnelle, en faveur d’un gouvernement mondial ; conception fondée en droit, comme dans le « Projet de paix perpétuelle» de Kant; ou économique (sources variées, mais souvent sous l’influence d’Adam Smith et sa «Richesse des Nations», où alors elle se ramène au libre-échange généralisé).
Achcar nous fait parcourir les chemins du concept, en particulier au sein du mouvement socialiste et ouvrier, où, pendant longtemps, il n’eut pas le caractère péjoratif qu’on lui a connu par la suite (souvent synonyme «d’internationalisme» en fait à cette époque). Il décrit sa funeste transformation par Staline (une autre manière de dire «juifs», pétrie donc d’antisémitisme), mais refuse que cette riche idée, propre aux combats pour l’émancipation humaine, soit jetée aux orties. La notion de cosmopolitisme est au contraire au carrefour de son ancrage historique, et de ses relations avec les données contemporaines de la mondialisation et de l’altermondialisme. Bien entendu rien n’est simple en la matière et l’auteur fait sa place à la crainte de Hannah Arendt, convaincue qu’un «gouvernement mondial» serait synonyme de tyrannie et qui affirme : « Nul ne peut être citoyen du monde comme il est citoyen de son pays…Peu importe la forme que pourrait prendre un gouvernement du monde doté d’un pouvoir centralisé s’exerçant sur tout le globe, la notion même d’une force souveraine dirigeant la terre entière…ce serait là la fin de toute vie politique…Ce ne serait pas l’apogée de la politique mondiale mais très exactement sa fin». Mais le débat doit se ré-ouvrir dit Achcar : «Si la défense de la souveraineté nationale est certainement justifiée et nécessaire face à la coercition impérialiste, elle apparaît inévitablement anachronique…à une époque où la «mondialisation» est certainement une réalité et non une phrase creuse». Il s’inscrit dans ce que De Sousa Santos appelle: «le cosmopolitisme insurgé », et défend que « le combat socialiste doit aspirer à dépasser les réalisations cosmopolites du capitalisme en s’appuyant sur l’idée de justice mondiale».
«Marx, Engels et «l’Orientalisme»: sur l’évolution épistémologique de Marx»
Ce dernier article débute, inévitablement, sur l’approche critique de Edward Saïd, et de son œuvre majeure, L’Orientalisme (publié en anglais en 1978) en particulier à propos de ses caractérisations, infondées aux yeux d’Achcar, du marxisme comme seulement enraciné dans l’ethnocentrisme européen. Certes, comme le dit l’auteur à propos de l’ouvrage phare de Said,
«L’orientalisme a bien été un jalon éminent sur cette longue voie menant à la liberté», par «le dévoilement, à une échelle de masse, d’un état d’esprit «occidental» eurocentrique et colonial omniprésent et profondément enraciné».
Mais l’ouvrage, s’il fut durement attaqué par ceux qui niaient qu’il puisse exister un tel état d’esprit le fut aussi, et à juste titre nous dit Gilbert Achcar, par nombre de spécialistes de la question, au premier rang desquels Maxime Rodinson, pourtant abondamment cité par Saïd, mais sans, manifestement, qu’il ait saisi la totalité de sa pensée. Rodinson, tout en saluant «l’effet de choc de son livre (qui) se révélera très utile» craignait que ceci ne conduise dit l’auteur: ‘à une doctrine «dogmatique qui rejetterait apriori tout apport étiqueté «orientaliste» au nom d’une conception «antiorientaliste»…c’est l’appellation «postcolonial» qui allait plus tard être utilisée à cet égard jusqu’à l’abus».
L’article de Gilbert Achcar est plus spécialement consacré non à une étude détaillée des apports et des critiques (nombreuses dès l’origine, avec un fort renouvellement de nos jours, voir Kevin Anderson, Vasant Kaiwar, Vivek Chiber, David Harvey et autres) de l’ouvrage de Saïd, mais plus spécialement au rejet de l’affirmation (passablement peu informée et gratuite) de Saïd considérant Marx comme un spécimen du même «orientalisme général». Ce faisant il prend la suite d’auteurs critiques présents dès l’époque, Sadik Jalal Al-Azm, Mahdi ‘Amil, Samir Amin ou Aijaz Ahmad. Ainsi «‘Amil accusa la critique par Saïd de la pensée occidentale de tomber elle-même dans le piège de l’essentialisme en rangeant Marx dans le même sac que d’autres penseurs «occidentaux» sur la base d’une définition géographique de leur positionnement culturel». En fait dit l’auteur : «Omettant le lien entre essentialisme et idéalisme philosophique, Saïd ne mentionne pas une seule fois dans L’Orientalisme ce qui est certainement l’exposé le plus caractéristique de la perspective «orientaliste» occidentale – qui se trouve, sans surprise, dans le sommet de la philosophie idéaliste qu’incarnait Hegel».
Avec son article Gilbert Achcar se livre alors à une analyse précise de cette question. Au-delà de la constatation, banale mais importante, que le point de vue de Marx et Engels fut scientifiquement et concrètement limité par leurs connaissances «eurocentrées», en ceci qu’elles furent pendant tout un temps indirectes, la vraie question est donc celle de la survivance de racines idéalistes chez Marx.
On connaît la thèse de Althusser, très critiquée mais pourtant hautement roborative, de l’existence d’une «coupure épistémologique» entre le Marx encore partiellement idéaliste et le Marx marxiste, développant seulement ensuite vraiment la méthode du matérialisme historique. A l’appui de ceci, Achcar rappelle à quel point les premières approches de Marx en plusieurs domaines en sont témoin. Par exemple. l’ode unilatérale au rôle révolutionnaire de la bourgeoisie que l’on lit dans certaines pages du Manifeste, ou dans les premiers articles sur l’Inde et la conquête de l’Algérie. Et encore la «théorie» de la succession inévitable des modes de production développant à l’évidence la même vision que Hegel sur la progression unilatérale de «l’Idée» (la Raison) et de la «Civilisation». On en trouve aussi des éléments dans les premiers écrits concernant la religion. Même en prenant ses distances par rapport à l’approche purement idéelle de la question, on voit Marx utiliser des termes révélateurs quant à «l’essence du Juif» (dans un ouvrage, par ailleurs important par les bases qu’il jette quant à la distinction entre ce qui ensuite s’appellera droit formel et droit réel, mais avec des formules sur l’essence du Juif qu’on ne peut lire aujourd’hui sans frémir, rappelle Achcar) ou l’incomplétude des premières approches, encore bien essentialistes, du christianisme (voir le premier article du livre).
Achcar suit Althusser sur ce point, mais tout en soulignant, avec raison, que les choses sont plus compliquées. D’un côté, le matérialisme historique est déjà à l’œuvre avant «la coupure», et de l’autre, des traces idéalistes subsistent tout du long, tout en se raréfiant. Et là Achar apporte à Saïd la critique la plus importante. En réalité le matérialisme historique de Marx et Engels (et au-delà de leurs productions à telle ou telle période) est justement l’antidote (et en fait le seul) à tous les essentialismes. On en voit d’ailleurs le développement quand l’un ou l’autre précisent, modifient voire bouleversent leurs conceptions sur le colonialisme par exemple. Certes ceci beaucoup à partir de l’exemple de l’Irlande qu’ils avaient sous les yeux, mais en saisissant aisément, à partir de là, la portée générale de la question. A ce titre, effectivement, le fantastique travail que représente L’Idéologie Allemande et les Thèses sur Feuerbach (non publiées de leur vivant pourtant) viennent poser les bases, à ce jour indépassables, à la fois de la compréhension de l’essentialisme comme de son ancrage dans l’idéalisme, et la possibilité d’en sortir.
Oui, décidément, un ouvrage ramassé offrant une lecture indispensable à qui refuse de céder aux facilités intellectuelles du temps, facilités dont le simplisme et le «campisme» conceptuel nous habituent malheureusement aux temps de guerre en cours et à venir. Or, comme on le sait depuis longtemps, la première victime de la guerre c’est la vérité. (29 mai 2015)
Gilbert Achcar, Marxisme, orientalisme, cosmopolitisme, Sindbad, Actes Sud, 2015, 248 p.
Publié par Alencontre le 30 - mai - 2015