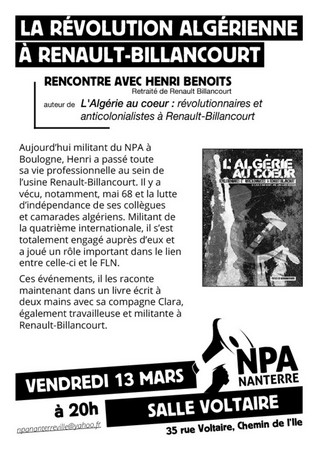Révolte en temps de guerre contre l’empire ottoman
Le Pain (Al-Raghîf) de Toufic Youssef Aouad, que les éditions Sindbad/Actes Sud viennent de rééditer, est paru pour la première fois en 1939.
Considéré comme le premier roman moderne de la littérature libanaise, il est aussi devenu un classique littéraire de la première guerre mondiale, un témoignage rare de la grande famine qui a ravagé le Mont-Liban entre 1915 et 1918. Aouad fait de ces années noires le terreau d’une révolte qui entraînera ses personnages à combattre aux côtés des troupes de Fayçal, pour reconquérir Damas.
— Dans le désert, loin, très loin d’ici, là où est né le Prophète béni, dans la plaine qui s’étend à perte de vue et où le soleil brûle comme un fer rougi sur les sables infinis… Là-bas a commencé une révolution contre les Turcs.
— Et qui a gagné ?
— La victoire est entre les mains de Dieu. S’Il le veut, les Arabes l’emporteront, Tom.
— Et la faim disparaîtra, n’est-ce-pas ? Nous mangerons de nouveau du pain blanc.
C’est à Tom, enfant famélique d’un village du Mont-Liban, qu’un résistant apprend qu’il est temps d’espérer un avenir meilleur.
Meilleur, c’est-à-dire débarrassé en tout premier lieu du conquérant ottoman qui, en 1914, « s’abattit sur le pays avec la brutalité de l’oppresseur » et « se permit tous les abus, toutes les injustices, toutes les exactions », dit Toufic Youssef Aouad dans l’introduction à son roman historique, Le Pain (Al-Raghîf), paru pour la première fois en 1939.
Nous sommes à la veille de la révolte arabe de 1916 contre la domination turque. La famine et la misère déciment des dizaines de milliers de Libanais. Un militant nationaliste, Sami Assem, se cache dans une grotte en haute montagne où son amoureuse, Zeina, lui apporte régulièrement de quoi se nourrir et les dernières nouvelles du pays. Lassé de son isolement, Sami quitte sa cachette, tue par erreur un soldat déserteur et finit par être arrêté. La rumeur de sa mort incite Zeina à fomenter l’assassinat du gouverneur turc de sa province. Mais Sami a en réalité échappé à l’exécution capitale et à la prison et poursuit son combat contre les convois ottomans dans le désert, avant la reconquête de Damas sous le commandement de l’émir Fayçal. Son sacrifice héroïque assombrira la belle Zeina, au cœur de la liesse populaire qui suit la libération de la capitale des Omeyyades.
Le roman, social autant qu’historique, a pour théâtre la terrible famine qui a ravagé le Mont-Liban entre 1915 et 1918. Selon les chiffres, entre 120 000 et 200 000 Libanais, soit un tiers de la population, sont morts de faim au cours de cette période. Les causes en sont connues, explique l’historien libanais Youssef Mouawad1 : d’abord une invasion de sauterelles en 1915 qui a ravagé les récoltes.
Puis — et surtout —, pas moins de deux blocus : d’abord le blocus maritime des Alliés, qui avait pour but d’empêcher toute importation d’armes ou de munitions dont auraient pu profiter les Ottomans ; ensuite, celui des voies de communication terrestres imposé par Jamal Pacha, gouverneur ottoman de Syrie et de Palestine. Selon les propos rapportés par le professeur Antoine Boustany, le chef des forces ottomanes, Enver Pacha, aurait déclaré : « L’Empire ottoman ne recouvrera liberté et honneur que lorsqu’il aura été débarrassé des Arméniens et des Libanais. Nous avons supprimé les Arméniens par le fer, nous supprimerons les Libanais par la faim »2.
Cette « arme de la famine » — dont les Alliés espéraient également, pour leur part, qu’elle précipiterait la révolte arabe —, est à l’origine de la violence sociale dépeinte dans le roman de Aouad : trahisons, abandons, cruautés, corruption, prostitution, vols... La faim, ressort dramatique, hante les personnages, les rend fous, idiots et prêts à tout. Elle transforme la population en « hordes affamées » : « des vieillards, des femmes, des enfants, certains pouvant encore marcher, la plupart étendus avec leurs gémissements pour seul bien. » Les gens se ruent sur le crottin des chevaux de l’armée ottomane pour y récupérer quelques grains d’avoine. Ils grattent la terre, mangent des carcasses décomposées d’animaux. Et meurent, comme dans cette scène de référence souvent citée :
Il y avait là une femme étendue sur le dos, envahie de poux. Un nourrisson aux yeux énormes pendait à son sein nu (…) La tête de la femme était renversée et ses cheveux épars. De sa poitrine émergeait un sein griffé et meurtri que l’enfant pétrissait de ses petites mains et pressait de ses lèvres puis abandonnait en pleurant.
L’autre ferment de la révolte qui anime les héros est la répression aveugle et arbitraire qui s’abat sur une population misérable :
« Quant à la gare d’Aley, il y régnait une atmosphère terrifiante. Les soldats allaient et venaient avec leurs baïonnettes étincelantes. Ils bousculaient les prisonniers et tançaient les gens, et ceux-ci ressemblaient à des spectres dressés. Enfants et vieillards tendaient la main pour mendier. Les femmes et les jeunes filles en haillons, le regard désespéré, les yeux exorbités, proposaient leurs beauté pour une ration de pain. » Dans la prison d’Aley, siège de la Cour martiale turque et antichambre de la mort par pendaison commandée par Jamal Pacha, un prisonnier raconte à Sami le genre de « raisons » pour lesquelles tant d’hommes sont incarcérés : « Hanna Dahan (…) avait été trahie par un portrait de Napoléon trouvé dans sa maison ; un autre par une lettre reçue d’un ami d’Amérique évoquant l’État turc en des termes qui n’étaient pas pour plaire aux autorités ; un troisième était accusé d’avoir offensé le sultan… ».
L’héroïsme des résistants vient en contrepoint de la lutte pour la survie de ces années noires.
La résistance prend les traits d’un nationalisme naissant, qu’une conversation entre Sami et son juge ottoman révèle aussi simplement que clairement :
— « Nous cherchions à faire valoir nos droits.
— Vos droits ! Attention à ne pas me mettre en colère ! Depuis quand avez-vous des droits en dehors des grâces du sultan, dont jouissent équitablement tous les Ottomans ?
— Nous sommes des Arabes qui demandent leur liberté et leur indépendance.
Et c’est dans une autre conversation, cette fois entre le maronite Sami et Kamel, un camarade de combat musulman, que va s’énoncer une fraternité baptisée dans le sang et dont le sens est d’emblée questionné :
— Nous avons déclaré le djihad contre les Turcs.
— Les Turcs aussi ont déclaré le djihad contre nous. Lequel des djihad te semble donc le plus juste ?
— (…) Le califat doit revenir aux Arabes. Les Arabes vaincront et renoueront avec leur gloire passée. Ils verront la renaissance de l’ère des califes (…). Nous y désignerons le roi Husayn commandeur des croyants, et il y élira demeure. Nous l’entourerons de nos poètes, de nos savants et de nos intellectuels.
Mais Sami le nationaliste n’adhère pas au djihad.
Pas plus qu’il ne considère que son combat s’inscrit dans une « guerre de religion ». Pour lui, « il s’agit d’Arabes qui se battent contre les Turcs pour recouvrer leur liberté et de Turcs qui combattent les Arabes pour continuer à les soumettre. Aujourd’hui, nous assistons à la naissance du véritable nationalisme arabe, dont la mère est la révolution. »
La modernité de ce roman réside essentiellement dans sa composition où prédominent les parties dialoguées.
Elles permettent une approche des personnages dans leur diversité et leurs contradictions, en évitant tout à la fois une « psychologisation » individualisante — que l’histoire d’amour entre Zeina et Sami pourrait induire — et la pesanteur du récit historique à message pédagogique. Et c’est de la même manière avec Dans les meules de Beyrouth, publié en 1973, que Toufic Youssef Aouad restituera plus tard, comme en écho, l’atmosphère de la fin des années 1960 et la radicalisation des luttes politiques et idéologiques, celles qui plongeront deux ans plus tard le Liban dans la guerre civile.
Pour l’heure, nous sommes, à la fin du livre, en 1918. Damas libérée jubile ; la faim et la souffrance sont oubliées, « les fantômes de l’injustice et de l’ignorance » ont disparu comme par enchantement et tous les espoirs de liberté sont permis. Le rêve d’unité arabe du roi Fayçal n’est pas encore brisé et les révolutionnaires survivants comme Zeina peuvent croire que leurs morts n’ont pas été sacrifiés en vain.