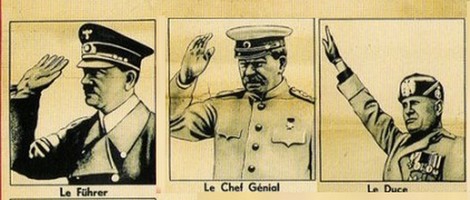La monarchie s’est historiquement appuyée sur un appareil politique et administratif particulier, conservé et renforcé par la colonisation, que l’on nomme le makhzen.
Mais la consécration d’un pouvoir absolu, au lendemain de l’indépendance, a nécessite des luttes et conflits qui ont permis de marginaliser le mouvement national et de défaire les résistances populaires.
Le Makhzen précolonial reposait sur une corrélation étroite entre la violence organisée, la collecte des impôts et l’administration de territoires. Le terme « Makhzen » désigne à la fois le « magasin/lieu de dépôt » (des richesses prélevées) et l’autorité qui l’institue. Ce « système stable de violence continue » impose un prélèvement fiscal qui, souvent, n’est possible que sous la pression militaire.
Le sultan et l'Etat
Dès les premiers temps, il n’y pas à proprement parler de distinction entre le Trésor et la fortune du prince. S’installe un fonctionnement spécifique de ce mode de commandement. Les « harkas » sont à la fois des expéditions punitives et le moyen d’un racket imposé : le sultan arrive avec sa suite et son armée dans une région ; le caïd et les cheikhs des tribus de la région se portent à sa rencontre. Ces derniers doivent présenter au sultan la collecte de l’impôt. Souvent, des razzias ont lieu. Les richesses collectées servent à financer les expéditions armées. Elles visent à (r)établir l’autorité du sultan, mais aussi à soumettre et appauvrir. Faddul Ghirmit, un « vizir » du 19e siècle, répétait qu'« on doit plumer le contribuable comme le poulet, si on le laisse s’enrichir, il se rebelle ».
Le Maroc précolonial était structuré par plusieurs centres de domination (tribus, confréries religieuses, corporations urbaines, pouvoir du sultanat...) relativement autonomes. Les historiens parlent de « bled siba » pour désigner les régions rétives ou hostiles à l’autorité politique et administrative du sultanat, et du « bled makhzen » pour les zones où cette autorité s’exerce, par le biais d’allégeances complexes et par la force. Cette distinction était elle-même mouvante. Il y a une dissociation entre l’autorité religieuse du sultan, globalement acceptée, et l’autorité profane qui est circonscrite à des territoires et souvent contestée. La domination instaurée cherche à éviter le développement de pouvoirs locaux autonomes qui pourraient menacer le pouvoir central en consolidation.
L’administration sert avant tout à gérer les revenus du trésor et le domaine acquis par le sultan et sa cour. Le terme « Dawla »( « Etat ») est, au sens étymologique, l’appropriation exclusive du trésor par l’utilisation de la force. Les impôts sont des amendes extorquées aux commerçants, artisans, paysans. La fiscalité, différentes corvées, le contrôle des zones de pâturage et de l’eau, l’appropriation des terres témoignent d’une forme de prédation économique dont la finalité est aussi politique : assurer le contrôle social sur la base de rapports de forces négociés et renouvelés.
L’opposition droit makhzenien/droit coutumier était souvent tranchée par la force. De même, le monopole du commerce établi, les prélèvements opérés sur certaines filières (notamment le sucre et l’artisanat) imposent un rapprochement avec la caste des marchands, selon une logique qui allait perdurer : le droit à des privilèges en échange de la soumission ; en particulier, le droit concédé et réversible à un monopole de commercialisation de certains produits : les peaux, le sucre, le kif déjà à cette époque, le coton, le blé. Ces mêmes commerçants, ainsi que les collaborateurs et serviteurs du sultan (chorfas, oulamas, militaires, grands fonctionnaires ou leurs représentants locaux), pouvaient bénéficier de terres notamment dans les régions fertiles. Bien avant le Maroc moderne, la pratique de concessions de ressources matérielles s'est répandue comme moyen d’allégeance.
La colonisation
Le processus colonial entamé au 19e siècle s’est officiellement établi en 1912, en s’appuyant sur des forces locales. L’accaparement des terres s’accompagne aussi de l’extension de la propriété foncière des caïds et des relais locaux de l’ordre colonial. Ali Benhaddou note que « la qualité de grande famille bourgeoise s’associe nécessairement à la propriété terrienne. Près de 40 000 hectares que détenaient les familles chérifiennes, lettrées et commerçantes, en 1968 leur étaient déjà acquise au début du 20e siècle. En 1973, 500 000 terres de colonisation privée ou officielle sont passées entre les mains des représentants de l’élite politique. S’ajoutent 7500 pachas, caïds et cheikhs qui, dés les années 1930, avaient pris possession du quart des terres marocaines, soit 1 800 000 hectares de cultures. »
Les dynasties dominantes qui se sont formées ou renforcées au 19e siècle traversent la période coloniale comme alliées subordonnées de la prédation internationale ou comme auxiliaires du makhzen qui assurait, malgré les fluctuations politiques, le maintien de leurs positions dominantes.
L’ordre colonial s’est appuyé sur les familles dominantes et le corps des caïds pour consolider sa présence. Il a également donné au Makhzen une armature nationale et une infrastructure matérielle et administrative. La colonisation a dû pour cela pacifier le pays pendant vingt ans.
La République du Rif1 et toute une série de soulèvements dans différentes régions contestaient le pouvoir colonial et le makhzen qui lui était associé. Après leurs défaites, le pays a connu la montée d’un mouvement national plus urbain, dans un premier temps modéré, avant de connaître un processus de radicalisation sous une triple impulsion : la construction d’un syndicalisme ouvrier et nationaliste de masse, incarné par l’Union marocaine du travail (UMT) dans les années 1950 ; la réactivation de la lutte armée dans les villes ; l’avènement des armées de libération du Nord et du Sud.
Confronté en Algérie à la résistance du FLN, l'Etat français ne voulait pas d’une dynamique comparable au Maroc, ni d’une base arrière pour la rébellion algérienne. Le sultan Mohamed V a alors commencé à cultiver l’image d’un roi opposé aux décrets coloniaux et sympathisant de la « cause nationale ». Son exil et le soutien apporté par le « Parti de l’indépendance » (Istiqlal ) qui entendait démontrer l’unité de la nation l’ont aidé à se construire une image symbolique forte. En 1956, les accords d’Aix-les-Bains ont permis une transition vers une indépendance formelle et négociée, mais la monarchie en tant que pouvoir absolu est le fruit d’un processus parsemé de luttes et de conflits dans la première décennie post-indépendance (1956-1965).
Vers la monarchie absolue
Dès le lendemain de l’indépendance, le roi a cherché à temporiser sur l’avenir institutionnel du pays, tout en se donnant les moyens de bâtir un nouveau rapport de force, contre ses adversaires réels ou potentiels. Plusieurs éléments y ont contribué :
-
La construction des Forces armées royales (sous la direction du prince héritier Hassan II) avec des officiers autrefois intégrés aux armées coloniales.
-
L’écrasement des différentes résistances qui ont refusé de déposer les armes au nom de l’inachèvement de la lutte anticoloniale (l’Espagne était toujours présente au nord et au sud, comme restaient sur place des colons et militaires français), y compris à une échelle maghrébine. L’opération Ecouvillon, menée en 1958 avec l’appui tacite de la monarchie, par les armées coloniales françaises (à partir de la Mauritanie) et espagnoles, a abouti à la destruction de l’armée de libération du sud. Celle du nord a été démantelée suite aux pressions de L’Istiqlal et à la répression menée par le pouvoir dans la région du Rif ;
-
La lutte contre l’Istiqlal par la création de partis s’appuyant sur les réseaux de notables et caïds dans les campagnes, un relais social et politique efficace contre les tentatives d’enracinement du mouvement national dans les campagnes réactivant l’allégeance traditionnelle au makhzen.
-
La mise en œuvre d’une politique visant à faire éclater les contradictions internes du mouvement national et à l’affaiblir. L’Istiqlal était un parti interclassiste traversé par une idéologie nationaliste bourgeoise salafiste ( Allal el Fassi est le représentant de ce courant associé à la bourgeoisie commerçante et à l’aristocratie religieuse et lettrée citadine ) ainsi que par des courants nationaux populaires attirés par la dynamique du FLN ou de l’Egypte de Nasser.
Le pouvoir a su attiser les oppositions entre la « droite « et la « gauche ». La nomination en 1958 d’un gouvernement dirigé partiellement par la gauche a permis à la droite, inquiète des projets de réforme agraire et de plans de modernisation qui pouvaient saper à terme les bases matérielles des couches privilégiées, de se rassembler à l’intérieur et à l'extérieur de l’Istiqlal. Mais cela a aussi entraîné des frictions à gauche, notamment de la part du mouvement syndical qui affirmait la nécessite d’un gouvernement plus offensif et homogène, ainsi que de ses alliés dans l’Istiqlal.
C’est également durant ces années que les fractions plus radicales de la résistance ont été désarmées (opération Ecouvillon, insurrection dans le Rif matée dans le sang par l’armée royale, dissolution du Parti communiste marocain…). Après avoir accepté des responsabilités gouvernementales sans maîtrise du pouvoir réel, sans rapport de forces à l’extérieur et sans lutte pour un processus constituant, confrontée aussi aux difficultés économiques, la « gauche » a été congédiée deux ans plus tard, alors que l’Istiqlal connaissait une scission majeure en 1959, aboutissant à la création de l’Union nationale des forces populaires ( UNFP) dont un des dirigeants a été Mehdi Ben Barka.
A cet affaiblissement et cette division du mouvement national s'est ajouté un processus de bureaucratisation très rapide de l’Union marocaine du travail, dont la direction s'est noyée dans les privilèges matériels. En 1962/63, elle théorise la « politique du pain », centrée exclusivement sur les revendications professionnelles sans prise en compte des conflits politiques.
Les conditions d'un affrontement étaient pourtant réunies. Hassan II s'est installé au pouvoir en mars 1961, après le décès de son père. Il a mené une chasse aux sorcières, en particulier contre l’UNFP en réaction à un prétendu complot, et contre ceux qui avaient critiqué la militarisation du conflit à la frontière avec l’Algérie (la « guerre des sables » de 1963) . Des milliers de personnes ont été arrêtées, les administrations purgées des membres actifs de l’UNFP, Ben Barka contraint à l’exil.
En 1965 s'est produit à Casablanca un soulèvement populaire qui a marqué, moins de dix ans après l’indépendance, la désillusion des classes populaires quant à la possibilité d'un changement. Les partis nationalistes et l’UMT en ont été surpris et se sont trouvés dans l’incapacité de mener la moindre action. La répression, terrible, a été suivie de l’instauration d’un régime d’exception. Quelques mois plus tard, Ben Barka était assassiné à Paris. Les années de plomb commençaient. La monarchie avait gagné le pouvoir absolu.
Chawqui Lotfi
Samedi 28 janvier 2017
- 1. La république du Rif (1919-1927) a eu une portée internationale. Abdelkrim-al-Khattabi a inspiré les théories de la guérilla chez Mao et Hô Chi Minh. La défaite d’une armée espagnole de 60 000 hommes lors de la bataille d’Anoual a menacé tout l’édifice colonial. Il a fallu l’intervention massive et conjointe des armées espagnoles et française, l’usage alors nouveau de l’aviation et l’utilisation du gaz moutarde pour contraindre les révoltés à l’arrêt de combats. L’intervention française visait explicitement à « rassembler les tribus sous l’autorité du sultan ». Abdelkrim avait lancé un appel à la liberté pour tous les peuples. Exilé au moment des accords de l’indépendance, il affirma que « l’Istiqlal et son sultan ont trompé les Marocains et pactisé avec la France ».