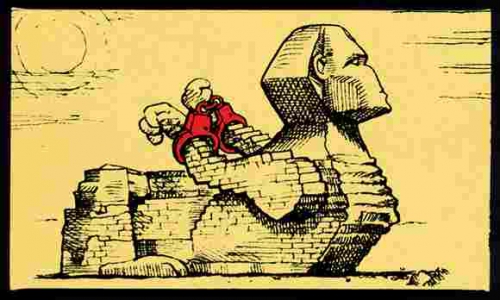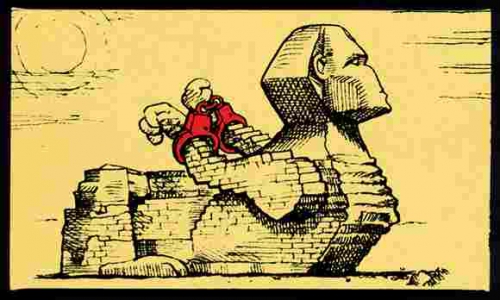
Je dédie cet article à la mémoire de Youssef Darwish (en arabe : يوسف درويش) 1910 - 2006, militant égyptien qui a combattu inlassablement pour la justice et l’internationalisme. Plusieurs fois mis en prison et torturé pour son engagement communiste et pour son combat pour les droits humains (il était juriste), il a poursuivi la lutte jusque la fin de ses jours [1]. En 2005, un peu avant sa mort, il avait pris contact avec le CADTM international car il souhaitait créer un CADTM égyptien.
Succès puis abandon de la tentative de développement autonome de l’Égypte
L’Égypte, bien qu’encore sous tutelle ottomane, entame au cours de la première moitié du XIXe siècle un vaste effort d’industrialisation [2] et de modernisation. George Corm résume l’enjeu de la manière suivante : « C’est évidemment en Égypte que Mohammed Ali fera l’œuvre la plus marquante en créant des manufactures d’État, jetant ainsi les bases d’un capitalisme d’État qui ne manque pas de rappeler l’expérience japonaise du Meiji » [3]. Cet effort d’industrialisation de l’Égypte s’accomplit tout au long de la première moitié du XIXe siècle sans recours à l’endettement extérieur ; ce sont les ressources internes qui sont mobilisées. En 1839-1840, une intervention militaire conjointe de la Grande Bretagne et de la France, suivie un peu plus tard d’une seconde agression réalisée cette fois par la Grande-Bretagne et l’Autriche obligent Mohammed Ali à renoncer au contrôle de la Syrie et de la Palestine, que ces puissances considèrent comme des chasses gardées. (voir plus bas la carte de l’extension de l’Égypte sous Mohamed Ali)

Un tournant radical est pris à partir de la seconde moitié du siècle. Les successeurs de Mohammed Ali adoptent le libre-échange sous la pression du Royaume-Uni, démantèlent des monopoles d’État et recourent massivement aux emprunts extérieurs. C’est le début de la fin. L’ère des dettes égyptiennes commence : les infrastructures de l’Égypte seront abandonnées aux puissances occidentales, aux banquiers européens et aux entrepreneurs peu scrupuleux.
Les banquiers européens veulent prêter massivement hors de l’Europe occidentale
Entre les années 1850 et 1876, les banquiers de Londres, de Paris et d’autres places financières cherchaient activement à placer des sommes considérables d’argent tant en Égypte que dans l’Empire ottoman et dans d’autres continents (en Europe avec l’Empire russe, en Asie dont la Chine en particulier, en Amérique latine) [4]. Plusieurs banques sont créées en Europe afin de canaliser les mouvements financiers entre l’Égypte et les places financières européennes : l’Anglo-Egyptian Bank (fondée en 1864), la Banque franco-égyptienne (fondée en 1870 et dirigée par le frère de Jules Ferry, important membre du gouvernement français) et la Banque austro-égyptienne (créée en 1869). Cette dernière avait été fondée sous les auspices du Kredit Anstalt où les Rothschild de Vienne avaient leurs intérêts. Les grandes banques de Londres étaient aussi particulièrement actives. Les banquiers londoniens se spécialisèrent dans les prêts à long terme et les banquiers français dans les prêts à court terme, plus rémunérateurs, surtout à partir de 1873 quand une crise bancaire a affecté Londres et Vienne.

Réussite apparente et éphémère du développement économique de l’Égypte basé sur l’endettement et le libre-échange
Dans un premier temps, le nouveau modèle fondé sur l’endettement et le libre-échange semblait très bien fonctionner, mais, en réalité, cet apparent succès tenait à des événements extérieurs que ne maîtrisaient aucunement les autorités égyptiennes. En effet, l’Égypte a temporairement tiré profit du conflit entre les États sudistes et les nordistes en Amérique du Nord. La guerre de sécession (1861-1865) de l’autre côté de l’Atlantique provoqua une chute des exportations de coton que réalisaient les États sudistes. Cela fit monter très fortement le prix du coton sur le marché mondial. Les revenus d’exportation de l’Égypte, productrice de coton, explosèrent. Cela amena le gouvernement d’Ismaïl Pacha à accepter encore plus de prêts des banques (britanniques et françaises principalement). Lorsque la guerre de sécession prit fin, les exportations sudistes reprirent et le cours du coton s’effondra. L’Égypte dépendait des devises que lui procurait la vente du coton sur le marché mondial (principalement à l’industrie textile britannique) pour effectuer le remboursement de la dette aux banquiers européens. La diminution des recettes d’exportation créa les premières difficultés de remboursement de la dette égyptienne.
Cela n’empêcha pas les banquiers, en particulier les banquiers anglais, d’organiser l’émission d’emprunts égyptiens à long terme (20 à 30 ans) et les banquiers français d’octroyer de nouveaux crédits, à court terme principalement, car ils donnaient droit à des taux d’intérêts très élevés. L’historien Jean Bouvier décrit cet engouement : « Des organismes de crédit - Banque de Paris et des Pays-Bas, Crédit Lyonnais, Société Générale, Comptoir d’Escompte de Paris, Crédit Foncier – qui avaient jusque-là participé aux “avances” et “emprunts” d’Égypte un peu au hasard des affaires, se mirent à rechercher systématiquement de tels placements et à prospecter les opérations gouvernementales des pays sous-développés. Lorsqu’en avril 1872, le Crédit Lyonnais s’attend à participer, aux côtés des Oppenheim, à une “avance” égyptienne – bons à dix-huit mois, pour 5 millions de livres sterling, à 14 % l’an – son directeur Mazerat confie à un correspondant : “On espère, au moyen de cette grosse avance, mettre la main sur l’emprunt qui doit être émis l’année prochaine.” [5] »
La dette égyptienne atteint un niveau insoutenable
En 1876, la dette égyptienne atteignait 68,5 millions de livres sterling (contre 3 millions en 1863). En moins de 15 ans, les dettes extérieures avaient été multipliées par 23 alors que les revenus augmentaient de 5 fois seulement. Le service de la dette absorbait les deux tiers des revenus de l’État et la moitié des revenus d’exportation.
Les montants empruntés qui sont parvenus réellement à l’Égypte restent très faibles tandis que les montants que les banquiers exigeaient et recevaient en retour étaient très élevés.
Prenons l’emprunt de 1862 : les banquiers européens émettent des titres égyptiens pour une valeur nominale de 3,3 millions de livres sterling, mais ils les ont vendus à 83 % de leur valeur nominale, ce qui fait que l’Égypte ne reçoit que 2,5 millions de livres dont il faut encore déduire la commission prélevée par les banquiers. Le montant que doit rembourser l’Égypte en 30 ans s’élève à près de 8 millions de livres si on prend en compte l’amortissement du capital et le paiement des intérêts.
Autre exemple, l’emprunt de 1873 : les banquiers européens émettent des titres égyptiens pour une valeur nominale de 32 millions de livres et ils les vendent avec un rabais de 30 %. En conséquence, l’Égypte ne reçoit qu’un peu moins de 20 millions de livres. Le montant à rembourser en 30 ans s’élève à 77 millions de livres (intérêt réel de 11 % + amortissement du capital).
On comprend aisément que cet accroissement de la dette et les taux d’intérêts exigés sont intenables. Les conditions financières qui sont imposées par les banquiers rendent insoutenable le remboursement. L’Égypte doit constamment emprunter afin d’être en mesure de poursuivre les paiements dus sur les anciennes dettes.
Sous pression des créanciers, le souverain Ismail Pacha, khédive [6] d’Égypte se met à vendre à partir des années 1870 des infrastructures et à accorder diverses concessions afin d’obtenir des liquidités pour payer la dette. Il doit aussi régulièrement augmenter les impôts pour les mêmes raisons.
Après une petite quinzaine d’années d’endettement externe (1862-1875), la souveraineté égyptienne est aliénée.
En 1875, pris à la gorge par les créanciers, l’État égyptien cède au gouvernement du Royaume-Uni ses parts dans la Compagnie du Canal de Suez qui avait été inauguré en 1869 [7]. Le produit de la vente des 176 602 actions Suez que détenait l’Égypte – soit près de la moitié du capital de la Compagnie de Suez – au gouvernement britannique à la fin de novembre 1875 est largement destiné à respecter les échéances de paiement de la dette de décembre 1875 et de janvier 1876 qui étaient particulièrement lourdes. Le gouvernement de Londres devient du même coup créancier direct de l’Égypte : les titres achetés ne permettant pas de toucher de dividendes avant 1894, le gouvernement égyptien s’engageait à payer à l’acheteur pendant cette période un intérêt de 5 % l’an sur les quelque cent millions de francs du prix d’achat.
Selon l’historien Jean Bouvier : « Le khédive disposait encore des chemins de fer « évalués à 300 millions », selon un administrateur du Crédit Lyonnais, et de son droit aux 15 % des bénéfices nets annuels de la Compagnie de Suez. Ayant réglé les échéances de fin d’année grâce aux 100 millions de la vente de ses actions, le khédive fait reconduire en janvier 1876 et début février les « avances » en cours fournies par l’Anglo-Egyptian et le Crédit Foncier, à trois mois, au taux de 14 % l’an. Il offre en garantie sa part de 15 % dans les tantièmes de Suez, les produits de l’octroi de la ville d’Alexandrie et les droits du port. La Société Générale participe à l’affaire, qui porte sur 25 millions de francs. »
En 1876 l’Égypte comme d’autres pays suspend le paiement de la dette
Finalement, malgré les efforts désespérés pour rembourser la dette, l’Égypte est amenée à suspendre le paiement de la dette en 1876. Il est important de souligner qu’au cours de cette même année 1876, d’autres États se sont déclarés en cessation de paiement, il s’agit de l’Empire ottoman, du Pérou (à l’époque, une des principales économies d’Amérique du Sud) et de l’Uruguay. Il faut donc chercher les causes sur le plan international. Une crise bancaire avait éclaté à New-York, à Francfort, Berlin et à Vienne en 1873 et avait progressivement affecté les banquiers de Londres. En conséquence, la volonté de prêter à des pays périphériques s’était fortement réduite, or ces pays avaient constamment besoin d’emprunter pour rembourser les anciennes dettes. De plus, la situation économique s’étant dégradée dans les pays du Nord, les exportations du Sud baissèrent, de même que les revenus d’exportation qui servaient à effectuer les remboursements. Cette crise économique internationale dont l’origine se trouve au Nord a largement provoqué la vague de suspensions de paiements. [8] Dans chaque cas particulier, il faut en plus distinguer certaines spécificités.
Dans le cas de l’Égypte, les banquiers français, moins affectés que les autres par la crise, avaient poursuivi les prêts à l’Égypte en profitant de la situation pour augmenter fortement les taux d’intérêts et en ne prêtant le plus souvent qu’à court terme. En 1876, ils ont accentué la pression sur l’Égypte et en resserrant l’accès au crédit, ont provoqué la suspension de paiement afin de forcer l’Égypte à accepter la création d’une Caisse de la dette contrôlée par le Royaume-Uni et la France. Ils ont réalisé cela en bonne entente avec les banquiers de Londres,
La création de la Caisse de la dette publique sous tutelle britannique et française
Les gouvernements de Londres et de Paris, bien que concurrents, se sont entendus pour soumettre l’Égypte à leur tutelle via la Caisse de la dette. Ils avaient procédé de la même manière dans les années 1840-1850 et à partir de 1898 à l’égard de la Grèce [9], en 1869 à l’égard de la Tunisie [10] et ils ont répété l’opération avec l’Empire ottoman à partir de 1881 [11]. En Grèce et en Tunisie, l’organisme qui a permis aux puissances créancières d’exercer leur tutelle a été nommé la Commission financière internationale ; dans l’Empire ottoman, il s’est agi de l’Administration de la Dette publique ottomane et, en Égypte, la Caisse de la Dette publique créée en 1876 a joué ce rôle [12].
La Caisse de la Dette publique a la mainmise sur une série de revenus de l’État et ce sont les représentants du Royaume-Uni et de la France qui la dirigent. La mise en place de cet organisme a été suivie d’une restructuration de la dette égyptienne, qui a satisfait tous les banquiers concernés car aucune réduction du stock n’a été accordée ; le taux d’intérêt a été fixé à un niveau élevé, 7 %, et les remboursements devaient durer 65 ans. Cela assurait une rente confortable garantie à la fois par la France, le Royaume-Uni et par les revenus de l’État égyptien dans lesquels la Caisse de la Dette publique pouvait puiser.
La priorité donnée à la satisfaction des intérêts des banquiers dans la résolution de la crise de la dette égyptienne de 1876 apparaît très clairement dans une lettre envoyée par Alphonse Mallet, banquier privé et régent de la Banque de France, à William Henry Waddington, ministre français des Affaires étrangères et futur président du Conseil des Ministres. Ce banquier écrit au ministre à la veille du Congrès de Berlin de 1878 au cours duquel va se discuter le sort de l’Empire ottoman (en particulier de ses possessions dans les Balkans et dans la Méditerranée) : « Mon cher ami, ... Si le Congrès se réunit, comme on l’espère, il suffit de combiner un mécanisme international... qui puisse exercer un contrôle efficace sur les agents administratifs du gouvernement, les tribunaux, l’encaissement des recettes et les dépenses. Ce qui a été fait en Égypte sous la pression des intérêts privés, en dehors de toute considération d’ordre public européen tant pour les tribunaux que pour le service de la dette... peut servir de point de départ. » (Lettre du 31 mai 1878. Mémoires et documents, Turquie, n° 119. Archives du Ministère des Affaires étrangères.) [13].
Les enjeux géostratégiques entre grandes puissances européennes
Si la mise en place de la Caisse de la Dette publique et la restructuration de la dette égyptienne qui a suivi satisfaisaient au premier chef les intérêts des banquiers, les intérêts des grandes puissances, dont provenaient les banquiers, étaient également directement en jeu. Le Royaume-Uni était de loin la première puissance européenne et mondiale. Elle considérait qu’elle devait contrôler et dominer entièrement la Méditerranée orientale qui gagnait en importance vu l’existence du Canal de Suez, qui donnait accès directement à la route maritime des Indes (qui faisait partie de son empire) et du reste de l’Asie. Le Royaume-Uni souhaitait marginaliser la France, qui exerçait une influence certaine en Égypte à cause des banques et du Canal de Suez dont la construction avait été financée via la bourse de Paris. Afin d’obtenir de la France qu’elle laisse entièrement la place au profit de l’Angleterre, il fallait primo satisfaire les intérêts des banquiers français (très liés aux autorités françaises, c’est le moins qu’on puisse dire) et secundo lui offrir une compensation dans une autre partie de la Méditerranée. C’est là qu’intervient un accord tacite entre Londres et Paris : l’Égypte reviendra au Royaume-Uni tandis que la Tunisie passera entièrement sous le contrôle de la France. En 1876-1878, le calendrier exact n’est pas encore fixé, mais la perspective est très claire. Il faut ajouter qu’en 1878 le Royaume-Uni a acheté l’île de Chypre à l’Empire ottoman. Chypre est un autre pion dans la domination britannique de la Méditerranée orientale.
L’avenir de la Tunisie et de l’Égypte ne se règle pas seulement entre la France et le Royaume-Uni. L’Allemagne, qui vient d’être unifiée et qui est la principale puissance européenne montante à côté du Royaume-Uni, a son mot à dire. Otto von Bismarck, le chancelier allemand, a été manifestement clair : il a déclaré à maintes reprises, lors de conversations diplomatiques secrètes, que l’Allemagne ne prendrait pas ombrage d’une prise de contrôle de l’Égypte par Londres et d’une prise de contrôle de la Tunisie par la France. En contrepartie, l’Allemagne voulait le champ libre dans d’autres parties du monde. Les dirigeants politiques français étaient d’ailleurs bien conscients des motivations de Bismarck. L’Allemagne avait imposé une défaite militaire humiliante à la France en 1870-1871 et lui avait ravi l’Alsace et la Lorraine. Bismarck, en « offrant » la Tunisie à la France, voulait détourner Paris de l’Alsace et de la Lorraine en lui offrant un prix de consolation. Une très large documentation est disponible à ce sujet.
En somme, le sort réservé à l’Égypte et à la Tunisie préfigure le grand partage de l’Afrique auquel les puissances européennes se livrèrent, quelques années plus tard, lors d’une autre conférence à Berlin tenue en 1885 [14].
L’occupation militaire de l’Égypte à partir de 1882 et sa transformation en protectorat
Dans le cas de l’Égypte et de la Tunisie, la dette a constitué l’arme la plus puissante utilisée par des puissances européennes pour assurer leur domination, en les menant jusqu’à la soumission totale d’États jusque-là indépendants.
Suite à la mise en place de la Caisse de la Dette publique, les banques françaises font le maximum pour obtenir toujours plus de remboursements et de profits en prenant de moins en moins de nouveaux engagements. À partir de 1881, les banques françaises renoncent à octroyer de nouveaux prêts à l’Égypte, elles se contentent d’engranger les remboursements des anciennes dettes restructurées. Quand en janvier 1882 une crise boursière éclate à Paris, les banques françaises ont d’autres préoccupations que l’Égypte.
La Caisse de la Dette publique impose à l’Égypte des mesures d’austérité très impopulaires qui génèrent une rébellion, y compris militaire (le général Ahmed Urabi défend des positions nationalistes et résiste aux diktats des puissances européennes). Le Royaume-Uni et la France prennent prétexte de la rébellion pour envoyer un corps expéditionnaire à Alexandrie en 1882. Finalement, la Grande-Bretagne entre en guerre contre l’armée égyptienne, occupe militairement de manière permanente le pays et le transforme en un protectorat. Sous domination britannique, le développement de l’Égypte sera largement bloqué et soumis aux intérêts de Londres. Comme l’écrivait Rosa Luxemburg en 1913 : « L’économie égyptienne a été engloutie dans une très large mesure par le capital européen. D’immenses étendues de terres, des forces de travail considérables et une masse de produits transférés à l’État sous forme d’impôts ont été finalement transformés en capital européen et accumulés. » [15]
La Caisse de la Dette publique ne sera supprimée qu’en juillet 1940 [16] (voir illustration ci-dessous). L’accord imposé à l’Égypte par le Royaume-Uni en 1940 prolonge la domination financière et coloniale car le Royaume-Uni obtient la poursuite des remboursements d’une dette qui est devenue permanente.
Il faudra le renversement de la monarchie égyptienne en 1952 par de jeunes militaires progressistes dirigés par Gamel Abdel Nasser et la nationalisation du Canal de Suez le 26 juillet 1956 pour que, pendant une période d’une quinzaine d’années, l’Égypte tente à nouveau un développement partiellement autonome [17].
Eric Toussaint
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article37998
Bibliographie
- Anderson, Perry. 1976. L’État absolutiste. Ses origines et ses voies, traduction française 1978, Paris : Maspero, 2 volumes, 203 p. et 409 p.
- BATOU, Jean. L’Égypte de Muhammad Ali. Pouvoir politique et développement économique, 1805-1848. Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 1991, 46ᵉ année, N°2. pp. 401-428, en ligne
- BOUVIER, Jean. 1960. Les intérêts financiers et la question d’Égypte (1875-1876), Revue Historique, 1960, T. 224, Fasc. 1, pp. 75-104.
- CORM, Georges. 1982. L’endettement des pays en voie de développement : origine et mécanisme in Sanchez Arnau, J.-C. coord. 1982. Dette et développement (mécanismes et conséquences de l’endettement du Tiers-monde), Editions Publisud, Paris
- DRIAULT, Edouard et LHÉRITIER, Michel. 1926. Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours, Paris : Presses universitaires de France (PUF), 5 tomes.
- Foreign Affairs, United Kingdom, Treaties. 1940. CONVENTION RELATIVE A L’ABOLITION DE LA CAISSE DE LA DETTE PUBLIQUE EGYPTIENNE. 17 July 1940. London.
- LUXEMBURG, Rosa, 1913, L’Accumulation du capital, Paris : Maspero, Vol. II, 1969.
- MANDEL, Ernest, 1972, Le Troisième âge du capitalisme, Paris : La Passion, 1997, 500 p.
- MARICHAL, Carlos, 1989, A Century of Debt Crises in Latin America, Princeton : Princeton University Press, 283 p.
- Ministère des affaires étrangères de la France. 1876. Décret d’institution de la caisse de la dette publique d’Égypte... et 6 autres décrets relatifs au Trésor et à la dette, Paris, 1876. 30 pages. consulté le 14 mai 2016
- Ministère des affaires étrangères de la France. 1898. Arrangement financier avec la Grèce : travaux de la Commission internationale chargée de la préparation du projet, Paris, 1898, 223 pages.
- REINHARDT, Carmen et ROGOFF, Kenneth, Cette fois, c’est différent. Huit siècles de folie financière, Paris, Pearson, 2010.
- REINHARDT, Carmen M., and SBRANCIA, M. Belen. 2015. The Liquidation of Government Debt. Economic Policy 30, no. 82 : p 291-333
- SACK, Alexander Nahum, 1927, Les effets des transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières, Recueil Sirey, Paris.
- THIVEAUD, Jean-Marie. Un marché en éruption : Alexandrie (1850-1880). Revue d’économie financière, 1994, n°30. Les marchés financiers émergents (II) sous la direction de Olivier Pastré. pp. 273-298.
- Toussaint, Éric. 2004. La Finance contre les peuples. La bourse ou la vie, CADTM-Bruxelles/CETIM-Genève/Syllepse-Paris, 640 p.
- TOUSSAINT, Éric. 2016. « La Grèce indépendante est née avec une dette odieuse »
- TOUSSAINT, Éric. 2016. « Grèce : La poursuite de l’esclavage pour dette de la fin du 19e siècle à la Seconde Guerre mondiale »
- Toussaint, Éric. 2006. Banque mondiale : le coup d’État permanent, Liège-Paris-Genève, CADTM-Syllepse-Cetim, 2006.
- WESSELING, Henri. 1996. Le partage de l’Afrique - 1880-1914, Paris, Denoël (Folio Histoire, 2002 ; 1re édition en néerlandais en 1991), 840 p.
Remerciements
L’auteur remercie pour leur relecture et leurs suggestions : Gilbert Achcar, Mokhtar Ben Afsa, Omar Aziki, Fathi Chamkhi, Alain Gresh, Gus Massiah, Claude Quémar, Patrick Saurin, Dominique Vidal.
L’auteur est entièrement responsable des éventuelles erreurs contenues dans ce travail.
http://cadtm.org/La-dette-comme-instrument-de-la