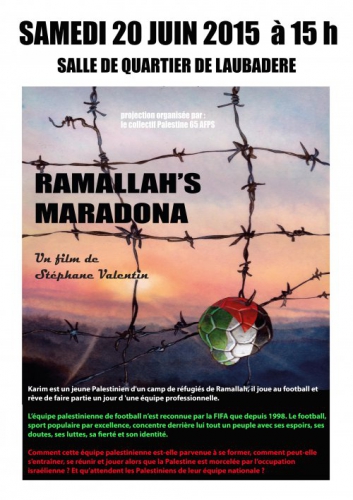Rassemblement,
jeudi 18 juin, 18 heures,
rue de Lausanne 45-47, devant la Mission d’Egypte, Genève
Le collectif Egypt Solidarity – créé en février 2014 – a lancé un appel international de solidarité avec les prisonniers et les prisonnières politiques réprimé·e·s par le régime de l’ex-maréchal Abdel Fattah al-Sissi
Les 20 et 21 juin 2015, le plus grand nombre d’initiatives – telles qu’indiquées par Egypt Solidarity – se doivent d’être entreprises à l’échelle internationale. Les revendications suivantes structurent cette campagne:
• Arrêt de la répression des manifestations.
• Libération des prisonniers politiques.
• Procès équitable pour tous, contre les tribunaux militaires.
• Arrêt de la torture et de tous les mauvais traitements.
• Interdiction des condamnations à mort et des exécutions.
Cette manifestation du 18 juin 2015, à Genève – 18h, devant la Mission permanente de l’Eypte, 45-47 rue de Lausanne – s’inscrit dans le contexte de l’appel lancé par Egypt Solidarity.
Azouli. L’emblème d’une dictature de militaires
Le caractère effectif du régime militaire dictatorial égyptien est révélé par une «prison militaire»: celle d’Azouli. Elle échappe à toutes les instances baptisées légales en Egypte. Elle est analogue à ces «prisons pour disparus» de la dictature des généraux argentins entre 1976 et 1983. Amnesty International l’a dénoncé. Une enquête approfondie du quotidien anglais The Guardian en a révélé divers aspects.
Ce haut lieu des pires tortures et mises à mort se trouve dans un vaste camp militaire à quelque 100 kilomètres au nord-est du Caire.
Le fonctionnement d’un tel lieu de détention repose sur les mécanismes criminels suivants:
• toute personne emprisonnée «n’existe pas», car aucun document ne prouve son incarcération;
• si le prisonnier meurt sous la torture, personne n’est censé le savoir;
• les militaires et autres tortionnaires disposent d’une double impunité: celle de l’anonymat (les prisonniers sont encapuchonnés) et celle assurée par le pouvoir en place;
• les interrogatoires et la torture s’effectuent dans un bâtiment spécial (le S-1), haut lieu de la terreur;
• les «confessions» obtenues doivent correspondre aux scriptes des services dits d’intelligence;
• les survivants, sur la base de ces «aveux», peuvent être transférés dans une prison «normale» et accusés, dès lors, de «terrorisme» et autres crimes;
• les juges n’ont aucun accès à Azouli où règnent les services (et les sévices) de l’intelligence militaire.
Azouli concentre, en quelque sorte, les attributs acquis par Al-Sissi.
Sous le régime de Moubarak, il exerçait ses fonctions dans les services de «l’intelligence militaire», autrement dit dans ce centre obscur qui contrôlait des leviers décisifs d’une armée dont le pouvoir économique et politique constituait un pilier de l’Etat profond, selon la formule courante. Sa carrière militaire l’a conduit à être attaché militaire en Arabie saoudite – ce régime ultra-réactionnaire qui apporte aujourd’hui un soutien financier massif à l’Eygpte, aux côtés d’autres Etats du Golfe – puis aux Etats-Unis (en 2005 et 2006). Dès août 2012, il prend la tête du ministère de la Défense. Son «élection» – 96,9% des suffrages en juin 2014 – ne fait qu’entériner un pouvoir capturé 11 mois auparavant, le 3 juillet 2013. D’ailleurs, du 14 au 16 août 2013, les «forces de sécurité» attaquèrent les deux camps organisés par les Frères musulmans soutenant Morsi – place al-Nahda et place Rabia-El-Adaouïa – et massacrèrent plus de 2500 personnes. Cela marque le début d’une «guerre contre le terrorisme» et des procès durant lesquels des centaines d’accusés sont condamnés à mort.
Assassiner la mémoire de janvier 2011
Ce pouvoir de Sissi et des siens déploie tous les instruments de la contre-révolution, après l’essor des forces démocratiques et révolutionnaires de janvier 2011 à juin 2013. Ainsi, à l’occasion des manifestations pacifiques pour célébrer le quatrième anniversaire de la révolution de janvier 2011, au moins 27 manifestant·e·s ont été tués. Les témoins de ces homicides sont menacés d’arrestations par le ministère public. Et 500 manifestant·e·s sont incarcérés dans des «centres de détention non officiels».
Une avocate réputée pour la défense des droits humains et militante socialiste-révolutionnaire, Mahienour el-Masry, a été condamnée en appel à 15 mois de prison pour avoir participé à une manifestation d’avocats dénonçant la brutalité de la police et cela trois mois avant la chute de Mohamed Morsi. Lors du verdict, ce 31 mai 2015, Mahienour el-Masry s’est écriée: «A bas, à bas le régime militaire!» Un régime qui restaure la mort de prisonniers durant leur détention, comme à la pire époque de Moubarak.
Au Caire, le 24 janvier 2015, la militante Shaima al-Sabbagh, qui voulait déposer une couronne de fleurs en mémoire de victimes de la révolution du 25 janvier, a été tuée par un tir de chevrotine. Suite à une plainte déposée par l’Alliance populaire socialiste, le parti de son compagnon, les enquêteurs ont cherché à charger ses amis. Puis, en ce mois de juin, sur injonction du pouvoir, la «justice» a condamné un policier. Une minuscule opération cosmétique.
Le 6 juin 2015, trois membres du Mouvement du 6 avril, interdit en août 2014, ont été arrêtés pour détenir des tracts appelant à la «désobéissance civile» pour le 11 juin. Un type d’initiative qui, pour éviter les représailles policières, devait se traduire par: ne pas se rendre à son travail, à l’école ou à l’université. Le Mouvement du 6 avril – créé en 2008 – a joué un rôle significatif dans le soulèvement conduisant au renversement de Moubarak. Il s’était aussi opposé à Morsi. Il est aujourd’hui une cible, parmi d’autres, du régime.
Un appareil répressif «légalisé» à coups de décrets
L’appareil répressif égyptien ne peut être réduit à l’armée, à la police, aux services de renseignement. En fait, l’Etat profond – représenté par le Président – contrôle la justice, les nominations dans l’appareil d’Etat, les médias, le corps diplomatique, les recteurs d’université, etc. La Constitution de 2014 permet au Président de promulguer des lois, sans parlement. Ces multiples lois-décrets ont contribué à redonner toute sa force à cet appareil répressif, en utilisant le danger du terrorisme et de la sécurité nationale. Ce qui sert aussi à étrangler la population de Gaza.
De multiples «lois» spécifiques attribuent des pouvoirs aux instances répressives afin de frapper un vaste spectre d’opposants. Quelques exemples. La loi du 26 novembre 2013 viole les droits d’expression, d’association et de réunion. Celle d’octobre 2014 donne aux tribunaux militaires le droit de statuer sur les menaces contre «l’intégrité de la nation». En septembre 2014, les ONG censées être financées «par l’étranger» sont ciblées. En janvier 2015 sont visés les enseignants qui participent à une «activité partisane». En février 2015, tout groupe menaçant la «sécurité, l’unité ou les intérêts de la nation» est défini comme une «entité terroriste». L’ensemble des droits conquis par les salarié·e·s sont remis en cause, alors que le chômage en hausse suscite la misère. Le projet de nouveau Code du travail s’attaque au droit de grève, au droit syndical. L’OIT, dont le siège est à Genève, a été contrainte de mettre l’Egypte sur sa liste noire.
Les femmes et les jeunes filles sont victimes de sinistres violences. Le dernier rapport de la FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l’homme) a documenté «des cas de viols, de viols anaux et vaginaux, de chantages sexuels perpétrés par la police ou le personnel de l’armée. Ces violences sont utilisées afin d’éliminer toute protestation publique en légitimant les autorités comme garante de l’ordre moral.» Les bourreaux étant les autorités, les victimes ne peuvent porter plainte, car de nouvelles représailles s’abattront sur elles.
Les gouvernements allemand, suisse… complices actifs
Simultanément, le régime de Sissi est soutenu non seulement par l’Arabie saoudite, les Etats du Golfe, mais est considéré comme un facteur de «stabilité» dans la région par les pays occidentaux. En novembre 2014, le «socialiste» François Hollande reçoit Abdel Fattah al-Sissi à l’Elysée. La vente de Rafale est à l’ordre du jour. Pour ce qui a trait aux «droits» humains, Sissi affirme: «Je suis 100% pour les droits de l’homme, mais pas pour l’instant.»
La visite d’Al-Sissi en Allemagne fut un succès: nouvelles livraisons d’armes (après la suspension datant de 2002), contrats milliardaires pour Siemens (turbines, éoliennes). Comme le souligne Al-Ahram (10 juin 2015): «Selon les observateurs, la visite du président en Allemagne a réalisé tous ses objectifs, sur tous les volets.»
Pour ce qui est du gouvernement helvétique, il s’agit de trouver une solution élégante en ce qui concerne les «fonds» de Moubarak qui sera blanchi par ses pairs. Quant au secrétaire d’Etat au Département des affaires étrangères, Yves Rossier, le 13 juin 2015, le quotidien en ligne Egypt Independent écrivait: «Il a exprimé sa satisfaction face à la manière dont les militaires ont géré les différents problèmes apparus depuis la révolution du 25 janvier. Il a aussi manifesté sa compréhension face aux défis sécuritaires auxquels l’Egypte fait face, ajoutant qu’il serait difficile pour toute personne d’être Président de l’Egypte en ces temps.» Plus impérialisto-helvétique, impossible
C’est en maintenant les liens de solidarité avec ceux et celles qui se battent pour la démocratie et la justice sociale en Eygpte et en éclairant la complicité du gouvernement suisse qu’une campagne de solidarité, sur la durée, peut et doit se développer, en sachant faire appel aux institutions internationales ayant leur siège en Suisse, comme l’OIT.
Mouvement pour le socialisme