
- Page 9
-
-
PST (Algérie)
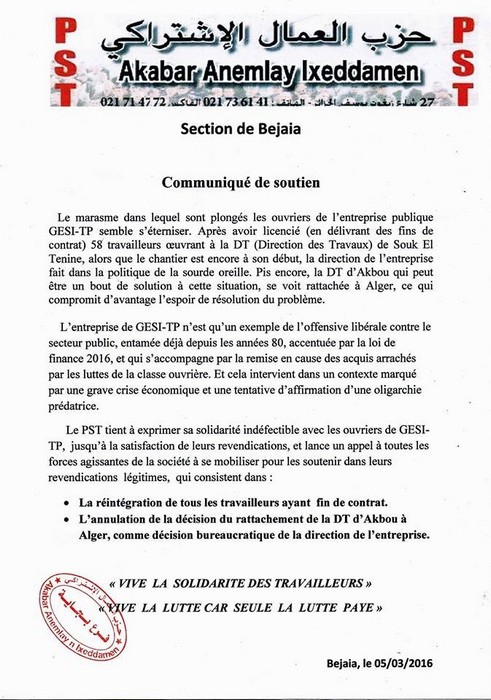
-
Journal suisse (Solidarités)

-
Syrie Manif à Alep hier
-
Nouveautés sur Association France Palestine Solidarité

-
Les Palestiniens accusent le Conseil de Paris de favoriser la colonisation israélienne
L’Orient le Jour avec AFP, vendredi 4 mars 2016 -
La Croix-Rouge offre des milliers d’arbres à l’agriculture gazaouie ravagée
L’Orient le Jour avec AFP, jeudi 3 mars 2016 -
Netanyahu veut pouvoir expulser vers Gaza les proches d’auteurs d’attentats
La Croix avec AFP, jeudi 3 mars 2016 -
Israël refuse à une délégation parlementaire belge l’entrée à Gaza
RTBF avec Belga, mercredi 2 mars 2016
-
Deux historiens israéliens : Le boycott, une route pour mettre fin à l’occupation
Wadih Awawda-Haifa, Al Jazeera, mercredi 2 mars 2016 -
Les projets douteux de la Jordanie pour ses « invités » palestiniens
David Hearst, Middle East Eye, mercredi 2 mars 2016 -
Israël accusé de recourir à la ruse pour arracher des terres de réfugiés
Jonathan Cook, Middle East Eye, mardi 1er mars 2016
-
-
Quatrième coalition guerrière pour Hollande (A l'Encontre.ch)

Avec ses interventions au Sahel, en Irak, en Syrie et, depuis deux mois, en Libye, le Président va pouvoir jouer les chefs de guerre jusqu’à la fin de son mandat.
Le 14 février, le site «Libya Observer» révélait la présence de conseillers militaires français au sein de l’état-major du général Khalifa Haftar, le patron de l’Armée nationale libyenne, dont la valeur est encore à prouver. Créé en juillet 2015, avec la bénédiction des personnalités qui, à Tripoli, avaient le soutien des Américains et envisageaient de former un gouvernement, «Libya Observer» évaluait à 180 hommes les effectifs d’un contingent français basé à l’est de Benghazi. Une semaine plus tard, le 23 février, le site en langue arabe du «Huffington Post» puis «le Monde», le 25, évoquaient eux aussi cette nouvelle «exportation en Libye du savoir-faire français», si on en croit un officier. Lequel ne songeait pas, on l’espère, aux bombardements de 2011, qui ont permis le pillage des arsenaux de feu Kadhafi.
En réalité, ces militaires français du Commandement des opérations spéciales côtoient actuellement leurs homologues américains et britanniques, notamment à Tobrouk, tous venus former les hommes du général Wanis Boukhamada, patron des futures forces spéciales libyennes. Dans l’espoir de les voir bientôt pratiquer la chasse à Daech comme le voudrait la coalition constituée, à la fin de l’année dernière, par les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie. À défaut de pouvoir préparer une intervention au sol avec plusieurs dizaines de milliers d’hommes – mais quel chef d’Etat s’y risquerait? –, les coalisés se limitent, comme en Irak ou en Syrie, à mener une guerre «antiterroriste par voir aérienne», affirme un expert militaire.
Califat en vue
Ce que l’on peut résumer ainsi: survol permanent du territoire libyen, surveillance des incursions de Daech, repérage des cibles à bombarder, recensement des chefs djihadistes à exécuter vite fait, etc. Le tout assorti d’un sacré retard à l’allumage. Une preuve? En 2013, déjà, les dirigeants de Daech parlaient ouvertement de créer une base terroriste en Libye.
Au fil des ans, la Maison-Blanche et l’Elysée ont été régulièrement informés, par leurs services respectifs, du risque de voir ce pays pétrolier devenir un califat d’Afrique du Nord. En 2014, Daech ne disposait encore que de 200 combattants sur place. Inquiets, des membres des forces spéciales américaines et algériennes ont aussitôt engagé une chasse aux djihadistes, puis sont rentrés au pays. Un an plus tard, au printemps 2015, Daech s’empare de Syrte, la ville de Kadhafi, d’un aéroport et de quelque 200 km de côtes. A Paris, la Direction du renseignement militaire mentionne l’«appétit insatiable» des dirigeants de l’Etat islamique. Lesquels, après des parades militaires de 4×4 japonais équipés de mitrailleuses lourdes, organisées pour les télévisions occidentales, s’apprêtent à envoyer des renforts en Libye. Une partie de ce corps expéditionnaire a d’ailleurs débarqué tranquillement sur les côtes libyennes («Le Canard» 27/1). Aujourd’hui, les effectifs sur place de Daech, tel que les évaluent les services alliés, s’élèveraient à 6500 (combattants et aide logistique compris). En attendant mieux, peut-être, car 100 000 hommes armés, membres de milices pro-Kadhafi ou anti-Occident, peuvent être tentés par le djihad selon les experts en renseignement pessimistes…
Des Tchadiens, des Sénégalais et des Soudanais sont récemment venus rejoindre les rangs de Daech. Bernard Bajolet, le patron de la DGSE, reçu, le 23 février, au Sénat par la Délégation parlementaire du renseignement, a mentionné ce recrutement incessant de «combattants étrangers, maghrébins, syriens ou irakiens, transférés depuis leur pays d’origine». Confirmant la participation «des forces armées françaises» aux opérations en Libye, Bernard Bajolet a parlé d’«un nombre encore limité» de Français présents sur le terrain. Mais Daech peut mieux faire, le recrutement se poursuit.
De retour du Proche-Orient, le «Charles-de-Gaulle» participera bientôt, avec son escorte, à des exercices en compagnie de la marine égyptienne. François Hollande va pouvoir autoriser des Rafale à quitter, pendant quelques heures, le porte-avions pour aller, comme on dit chez Le Drian, «se payer méchamment Daech». (Article publié dans Le Canard enchaîné Claude Angeli 1er mars 2016)
-
Nouveautés sur Sourya Houria

PARIS : Conférence « De l’antiquité au début du XXIème siècle »
Conférence d’Annick Leclerc* de l’antiquité au début du XXIème siècle un pays, un peuple, un patrimoine dans la tourmente samedi 19 mars à 18h30 34 rue des Citeaux Paris 75012 (au profit de Yalla ! Enfants) avec le soutien…
Syrie. La gauche au risque du déshonneur ? par Clémentine Autain
Cette tribune collective de membres d’Ensemble vise à interpeller la gauche sur la situation dramatique en Syrie. Soutenir le peuple syrien, aujourd’hui massacré par le régime de Bachar Al-Assad et les bombardements russes, est une impérieuse…
Syrie : pourquoi Jean-Luc Mélenchon se trompe – interview de Dominique Vidal – propos recueillis par Catherine Tricot
Dominique Vidal, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient, a regardé Jean-Luc Mélenchon lors de l’émission On n’est pas couché du samedi 23 février. Il décrypte les analyses de Jean-Luc Mélenchon sur la Syrie, qui ont fait polémique. Il…
PARIS : Soirée syrienne « Paris Ville Refuge pour la liberté de création »
Maram al-Masri & Samar Yazbek accueillent Najati Tayara, Mohammad Habeeb, Mohamad Abdul Moula & Mamon Ali Jabari Soirée syrienne « Paris Ville Refuge pour la liberté de création » vendredi 1 avril à 21h Maison de la Poésie…
PARIS : Marche « 5 Années de lutte »
Rassemblement en solidarité avec le peuple syrien Programme : 17H00 Marche de la place Joachim du Bellay jusqu’a l’Hotel de Ville 18H30 interventions, musique, projection films…. Evénement Facebook Signataires de l’appel : Attac, Amnesty International (section…
Crise migratoire en Turquie: «Pour les réfugiés, c’est fuir ou mourir» – par Propos recueillis par Anissa Boumediene
Portes closes. Alors que des milliers de réfugiés syriens continuent de fuir leur pays et les combats sanglants qui font rage à Alep, Ankara a décidé de fermer ses frontières. La Turquie d’Erdogan, qui compte 3 millions de réfugiés sur son…
NANCY : Exposition « Liberté d’illusion #2 » DINO Ahmad ALI
Une installation d’illusion d’optique de DINO Ahmad ALI de 7 au 12 mars MJC Lillebonne, 14 rue du cheval blanc à Nancy – France Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et…
LAUSANNE : Conférence « le témoignage de deux réfugiées syriennes »
A l’occasion de la Journée internationale de la femme et cinq ans après le début du conflit en Syrie, Amnesty International donne la parole à deux femmes syriennes qui ont dû fuir les atrocités de la…
5 choses à savoir pour comprendre l’ascension de Daech – par Alice Dulczewski
Comment combattre Daech de manière efficace ? La première étape : accepter que ce groupe djihadiste n’a pas surgi de nulle part. Dans son livre Le piège Daech, l’historien Pierre-Jean Luizard revie
-
Tunisie : quand l’environnementalisme de mode domine et réduit les débats (Essf)

Entre environnementalisme de mode postrévolutionnaire et urgences environnementales et sociales
Depuis plusieurs mois le problème des poubelles qui s’accumulent un peu partout dans le pays s’est imposé parmi les premières « urgences » politiques. Il occupe ainsi une place de choix aussi bien dans les espaces publiques que dans les médias et les réseaux sociaux. Même au sein des gouvernements, la question est récurrente à tel point que l’ex-secrétaire d’État en charge de l’environnement n’a pas hésité à se mettre en scène, pelle à la main, en présence des journalistes et face aux caméras, pour en souligner l’urgence.
Pourtant, d’autres problèmes environnementaux plus graves mais moins visibles, comme les pollutions industrielles et agricoles, etc., n’ont malheureusement pas bénéficié de tels traitements. Ceci est loin d’être un simple hasard. On est en réalité face à une manipulation médiatique coordonnée pour détourner l’attention des citoyens des vrais problèmes environnementaux : la poubelle est ainsi devenu l’arbre qui cache la forêt.
Ainsi, la sur-médiatisation de ce problème ponctuel lié aux luttes sociales des employés municipaux en charge du ramassage des ordures (les éboueurs) a conforté l’idée, évidemment fausse, que les questions environnementales et écologiques se limitent à l’immédiatement « visible » dans l’environnement quotidien.
S’il est parfaitement normal et légitime que chaque personne soit d’abord sensible à ce qui la touche directement dans sa vie quotidienne (la saleté de l’espace publique, la pollution urbaine, le bruit,...), il ne faut ni oublier ni minoriser les nuisances invisibles et dont les conséquences à moyens et à longs termes, parfois catastrophiques, ne se révèlent généralement qu’à l’occasion d’une catastrophe. Tout le monde se rappelle, sans doute, l’explosion de l’usine de pesticides de Bhopal en Inde (survenue dans la nuit du 2 au 3 Décembre 1984) qui a couté la vie à plusieurs milliers de personnes en l’espace de quelques heures (3.500 immédiatement et au total 25.000 au total).
Où en sommes nous du nécessaire débat sur les questions environnementales et écologiques ?
Depuis la chute du régime de Ben Ali qui empêchait tout débat sur les questions fondamentales, on assiste à une explosion de la parole et nous ne pouvons que nous en réjouir. Toutefois, si certains sujets importants comme les libertés individuelles, l’identité « nationale » (collective), le statut de la femme, les libertés politiques..., ont été abordés avec toutes leurs dimensions essentielles, il n’en a pas été de même pour d’autres sujets, dont l’environnement, la justice sociale et les modèles de développement.
Ainsi, l’emballement des médias et des réseaux sociaux à propos des ordures et des déchets urbains n’est qu’un exemple de ces débats tronqués. Il relève en réalité du développement d’une forme d’environnementalisme urbain produit et développé par les classes moyennes et supérieures qui se sentent quotidiennement agressées par les nuisances immédiates et visibles.
« Ca sent mauvais », « ça fait trop de bruit », « c’est sale », « c’est un risque pour la santé », « ce n’est pas beau » et « ça nuit à l’image de ’notre belle Tunisie’ » : Ce ne sont là que certaines des formules clés des discours de ce que j’appelle un environnementalisme de mode postrévolutionnaire. Un environnementalisme qui rassure ces animateurs et leur donne une bonne conscience, mais qui participe très fortement à la marginalisation des véritables questions et enjeux environnementaux et des populations exposées aux risques invisibles.
Peut être faudrait-il donner ici quelques exemples qui sont trop peu ou pas du tout évoqués dans les débats actuels sur l’environnement :
Le premier exemple est celui des quartiers populaires périphériques, comme celui de Saida Mannoubia, celui de Mellassine et celui de Sidi Hassine, qui sont à moins d’une heure de marche de l’avenue Bourguiba à Tunis. Dans ces quartiers, les habitants sont depuis des années quotidiennement exposés à de multiples problèmes environnementaux : habitats mal adaptés, un réseau d’assainissement insuffisant et délabré, accumulation des poubelles, bruits et pollutions urbaines..., L’état extrêmement pollué du lac Sijoumi, qui borde ces quartiers par l’ouest et en reçoit la quasi-totalité des eaux usées, est un véritable foyer de risques sanitaires divers. Qui s’en émeut réellement ? Qui en parle ? [1]
Deuxième exemple : Djerba qui a déjà souffert du sur-pompage de ses nappes et de la destruction de son agriculture de type oasien, qui avait résisté jusqu’au milieu des années 1970, et qui est désormais alimentée en eau potable par des sondages profonds situés à plusieurs dizaines de kilomètres dans la Djeffara voisine, connaît un nouveau problème environnemental qui la défigure et la détruit à une vitesse effrayante. En effet, depuis plusieurs années des centaines de quads la sillonnent dans tous les sens pour promener des touristes en mal de « paysages » exotiques mais toujours pressés et inconscients des nuisances et des dégâts que ce véritable phénomène provoque sur ces paysages, sur les chemins de sable empruntés et évidemment sur la population locale exposée à la fois aux bruits incessants de ces puissants engins et à la pollution engendrée. Les centaines de kilomètres de chemins de sable, qui étaient autrefois des chemins agricoles, ne sont plus qu’un réseau de diffusion de la pollution. Qui en parle ? Qui s’en émeut ?
Le troisième exemple est bien sûr celui du complexe chimique de Gabes qui est entrain de tuer la seule oasis littorale du monde et un véritable patrimoine environnemental exceptionnel en la privant de la plus grande partie de ses eaux, qui servaient à l’irrigation et en en polluant l’air, l’eau, les sols et la mer. Les populations locales y sont exposées aux pires conséquences sur leur santé (nombreuses maladies dangereuses) et sur leurs sources de vie (Voir mon film documentaire « Gabes Labels » [2]). Qui en parle ? Qui s’en émeut ?
Ces trois exemples rapidement exposés, ne sont malheureusement pas des exceptions et encore moins accidentels. Des milliers d’autres exemples pourraient être donnés. Ils montrent les vrais problèmes environnementaux et écologiques de la Tunisie d’aujourd’hui. Ils sont d’autant plus sérieux et inquiétants qu’ils sont devenus structurels et permanents et non pas ponctuels et conjoncturels comme le récent problème des ordures et poubelles de toutes sortes.
Mais ces problèmes environnementaux structurels ne semblent pas provoquer les environnementalistes de mode (petit bourgeois). Certains arrivent même à les justifier, voire les encourager par cette formule magique mais profondément anti-écologique : « C’est le prix à payer du développement », disent plusieurs parmi ceux et celles-là mêmes qui animent le « mouvement » anti-poubelles. Mais le vrai prix certains le payent déjà par les maladies auxquelles ils sont exposés et l’appauvrissement et nous le payerons tous/toutes immanquablement tôt ou tard.
Il n’en reste pas moins vrai que les questions écologiques sont bien trop complexes et multiples pour les réduire à un tas d’ordures, aussi nuisible soit-il.
Plus de cinquante ans de politiques anti-environnementales
Les nombreux problèmes environnementaux que la Tunisie connaît, comme la majorité des pays du Sud et au-delà, ne datent pas d’hier et ne relèvent pas de l’incident et encore moins de la situation politique actuelle du pays. Elaborées autour des deux dogmes de la croissance économique et de l’exportation, les politiques de développement en Tunisie n’ont jamais intégré les conditions et les conséquences environnementales et sociologiques. Elles sont la cause des problèmes écologiques que nous connaissons aujourd’hui et qui ne cessent de s’aggraver.
Depuis l’indépendance, le développement agricole a été orienté vers l’intensification excessive de l’agriculture grâce à la mécanisation, souvent inadaptée aux conditions géographiques et sociales locales, à l’usage dramatique des pesticides, insecticides et engrais chimiques divers et à l’exploitation minière des ressources hydrauliques relativement limitées.
En conséquences, nous avons une détérioration des qualités des sols, une pollution chimique de l’eau et de la terre, un épuisement vertigineux des ressources, doublé par la salinisation des nappes (Djerba, Cap Bon, les Oasis...), une multiplication des maladies provoquées par la pollution chimique et une dépossession progressive des petits paysans de leurs moyens de production, de leurs sources de revenues et de leur sécurité alimentaire familiale.
Le cas du développement agricole techniquement spectaculaire de Sidi Bouzid est probablement l’un des meilleurs exemples de ces choix et de leurs conséquences. En moins de trente années, cette région aride est devenue la principale région de production agricole du pays, grâce à l’exploitation massive des ressources hydrauliques souterraines et à la dépossession des paysans locaux au profit de grands investisseurs venus des villes côtières. Mais ce développement n’a pas empêché Sidi Bouzid d’être la première région en termes de taux de pauvreté. La mort de Mohamed Bouazizi est la conséquence directe de cette mauvaise politique agricole [3].
Quand un pays à ressources hydrauliques limitées produit des fruits, des légumes et des fleurs hors saison (des primeurs) destinés à l’export, il ne fait en réalité qu’exporter des volumes considérables de son eau. Ainsi la Tunisie est devenue l’un des premiers pays qui présentent ce paradoxe d’être à la fois un grand exportateur de produits agricoles et importateur de produits alimentaires. Toutes les devises du monde ne remplaceraient pas les eaux exportées et ne pourraient même pas garantir une sécurité alimentaire durable.
Non seulement personne ou presque ne semble se soucier de ce problème, mais un triste consensus semble se dégager sur la « nécessite » de continuer cette politique d’intensification à outrance, en attirant dans le secteur agricole davantage d’investissements et d’investisseurs tunisiens et étrangers. Quand une même personne mène, à juste titre, campagne à la fois contre l’envahissement de nos rues par des tas d’ordures et pour la poursuite des politiques agricoles intensives et fortement destructrices de nos ressources naturelles et marginalisantes de centaines de milliers de familles paysannes, cela relève à la fois de la défense de ses petits intérêts personnels (réduire les nuisances immédiates) et de l’absence de toute conscience écologique réelle. C’est de l’environnementalisme de mode postrévolutionnaire.
On peut aussi parler des politiques industrielles suivies et de leurs conséquences catastrophiques sur la population, l’environnement et les ressources naturelles. De Gafsa à Bizerte, en passant par Gabes, Sfax, Ben Arous, le Kef..., les exemples ne manquent guère.
Si on devait se limiter à un seul, je rappellerai celui du complexe chimique de Gabes que j’ai évoqué plus haut. L’une de ses plus spectaculaires conséquences dramatiques restera, sans aucun doute, la mort progressive du Golfe de Gabes, dans lequel le complexe chimique a déversé pendant plus de 40 années des centaines de milliers de tonnes de phosphogypses et d’autres déchets acides. Fortement polluée et appauvrie, la mer jadis très poissonneuse, est totalement désertée par la faune et la flore marines. Contrairement à celles qui s’entassent dans les rues, cette poubelle là n’est pas directement visible. En dehors de la population de Gabes et surtout de certains de ces habitants actifs et activistes, personne ne semble s’alarmer, outre mesure, par l’ampleur de la catastrophe. Pire, experts et décideurs au pouvoir depuis le 14 janvier ne cessent d’essayer de nous convaincre qu’il faut accepter ce prix du développement. Circulez il n’y rien à voir.
Il y aurait autant à dire sur l’industrie touristique du pays qui consomme, à elle seule, des volumes considérables d’eau. Le fait que l’un des ministres les plus actifs du gouvernement actuel soit la ministre du tourisme, qui n’hésite pas de payer de sa personne pour attirer davantage de touristes, souligne combien les décideurs actuels s’acharnent à reproduire les mêmes choix économiques des périodes précédentes sans même en avoir fait le bilan économique mais aussi social et écologique.
Les quads de Djerba, auxquels je faisais allusion ci-dessus, ne sont que l’expression audible et visible du sacrifice de l’environnement et des ressources naturelles au service de la croissance économique qui ne profite qu’à la minorité des « possédants ». Je reconnais qu’un quad, même bruyant, reste moins désagréable à voir qu’un tas d’immondices. Mais les conséquences du premier sont autrement plus graves que celles du second.
En guise de conclusion : Pour une réelle écologie sociale
Il n’est pas inutile de relancer le débat sur les questions écologiques de fond, loin de l’environnementalisme de mode qui porte en lui même les germes de son échec. Bien sûr, il n’existe pas de solutions miracles immédiates pour corriger, à court terme, les conséquences dramatiques de six décennies de mauvais développement (sans parler de la période coloniale).
Evidemment quelques initiatives peuvent être entreprises ici ou là en fonction des moyens, des contraintes et des urgences, mais ce qu’il faut c’est changer progressivement de modèles de développement.
En effet, il me semble de plus en plus urgent d’adopter de nouvelles politiques de développement visant la croissance sociale plutôt que la croissance économique. Mais la croissance sociale ne peut être atteinte qu’à travers une politique basée sur certains engagements précis, relevant de l’écologie sociale. J’en donne les dix suivants, à titre d’exemples de ce qu’il conviendrait de faire :
• La valorisation des ressources naturelles (l’eau, la terre, la biodiversité locale, les variétés locales...) ;
• La valorisation du travail des petits paysans qui devraient bénéficier d’un soutien sécurisé de la part de l’État ;
• La sécurisation de l’accès des paysans et des paysannes (les femmes paysannes sont les plus exposées aux processus de dépossession et d’appauvrissement) aux différentes ressources agricoles, dont l’eau et la terre ;
• La sur-taxation de tout usage des ressources hydrauliques pour des activités et des productions spéculatives ;
• L’application systématique et à toutes les échelles du principe « pollueur, payeur » ;
• L’imposition d’une taxe environnementale dans le secteur touristique ;
• La fourniture de l’eau potable gratuitement à tous/toutes à hauteur des besoins réels (environ 50 litres par personne et par jour, à discuter et décider) et l’application d’un tarif prohibitif pour toute consommation dépassant ces besoins réels ;
• Le développement des énergies renouvelables ;
• Le développement des infrastructures de transports publiques respectueuses de l’environnement ;
• La constitutionnalisation des ressources naturelles comme « biens communs » non privatisables...
Toutefois, de tels choix politiques qui changeraient radicalement les politiques de développement, supposent l’existence d’un véritable courant porteur d’un projet d’écologie sociale volontariste, ambitieux, visible et audible.
Les partis écologistes existants sont malheureusement peu audibles, malgré les grands efforts de nombre de leurs militants, et l’environnementalisme petit-bourgeois n’est qu’une tendance néo-libérale qui n’envisage aucune politique économique en dehors des dogmes du libéralisme dominant.
Soyons réellement écologistes, exigeons l’impossible.
Habib Ayeb
Géographe, enseignant-chercheur à Paris 8, réalisateur -
En Syrie, le régime, la Russie et l’Etat islamique unis pour exploiter un champ de gaz (Le Monde)

A 75 kilomètres au sud-ouest de Rakka, la « capitale » syrienne de facto de l’organisation Etat islamique (EI), des torchères continuent d’éclairer de nuit un coin perdu dans la steppe.
Le champ de gaz de Twinan et son usine attenante ont été épargnés par les bombardements et les combats qui ravagent le pays, si l’on excepte un raid aérien de la coalition menée par les Etats-Unis, qui a brièvement interrompu la production début décembre 2015. Jusque-là, le complexe a bénéficié de la bienveillance intéressée des autres belligérants : l’installation a été au cœur d’un accord impliquant les djihadistes de l’EI et le régime.
Dès octobre 2014, le collectif d’activistes anti-EI « Rakka se fait massacrer en silence » dénonçait un arrangement entre le régime et les djihadistes pour se partager la production du site. Mais, comme l’a révélé dernièrement la revue Foreign Policy et comme l’ont confirmé au Monde des sources syriennes, le rôle d’un troisième acteur dans cet accord contre nature intrigue au plus au point : il s’agit de la société russe Stroytransgaz.
Un contrat au profit d’une société russe
Tout commence en 2007, quand la Syrie accorde, pour 160 millions d’euros, le contrat de la construction clés en main de l’une des plus grandes installations gazières du pays à l’entreprise Stroytransgaz, détenue par l’oligarque Guennadi Timtchenko, et épaulée par une société syrienne, Hesco, propriété de l’homme d’affaires George Haswani. Deux hommes très proches des dirigeants de leurs pays respectifs, Vladimir Poutine et Bachar Al-Assad. Le premier, sixième fortune russe selon le magazine américain Forbes, a été placé en mars 2014 par le Trésor américain sur une liste noire établie en représailles à l’annexion de la région ukrainienne de Crimée par la Russie ; le second est visé, depuis novembre 2015, par Washington pour des activités de contrebande pétrolière entre l’EI et le régime syrien.
On retrouve la trace de ce contrat en 2013 sur le site Neftegaz.ru pour ce qui concerne Stroytransgaz. Hesco, le sous-traitant syrien de Stroytransgaz, mentionnait sur son site son activité sur le champ de Twinan, mais l’information a disparu depuis.
Les travaux, débutés en 2007, s’interrompent en janvier 2013 quand une coalition rebelle et le Front Al-Nosra, la branche d’Al-Qaida en Syrie, prennent le contrôle de la région et du complexe, avant d’en être chassés à leur tour par l’Etat islamique en janvier 2014. Entre-temps, Hesco se serait fait verser 120 millions d’euros en guise de dédommagement par le ministère syrien de l’énergie, selon des informations recoupées par Bachir Al-Ibad, membre de l’Union des coordinateurs de la révolution syrienne de Deir ez-Zor et ancien porte-parole d’une brigade de l’Armée syrienne libre (ASL), ainsi que la revue Ayn Al-Madina (« L’Œil de la ville »), un magazine bimensuel de la région qui s’est notamment spécialisé dans la « surveillance » des activités gazières et pétrolières de l’EI. Joints par Le Monde, ils livrent un même récit de la suite des événements.
Ingénieurs russes et hélicoptères
L’arrivée des djihadistes de l’EI va avoir une conséquence inattendue sur les installations de Twinan : les travaux reprennent. Le 12 janvier, le quotidien gouvernemental syrien Tishreen annonce même, sur la foi d’informations officielles, la « livraison au ministère de l’énergie et pour la fin de l’année de l’usine de Twinan par Stroytransgaz ». Et le quotidien de féliciter Stroytransgaz et les Russes en général : « Les compagnies pétrolières russes ont prouvé leur capacité d’adaptation à toutes les conditions, elles sont celles qui respectent leurs contrats dans le monde en général et en Syrie en particulier. » Les lecteurs de Tishreen sont pourtant privés d’une information importante : l’identité des nouveaux occupants des lieux, à savoir les djihadistes de l’EI…
Au tournant de l’année 2014-2015, les travaux s’achèvent et l’installation est livrée. Stroytransgaz n’a pas chômé.Au tournant de l’année 2014-2015, les travaux s’achèvent et l’installation est livrée. Stroytransgaz n’a pas chômé. Au point que la présence d’ingénieurs russes sur le site durant cette période est aujourd’hui dénoncée par des responsables turcs et un ancien commandant rebelle de l’ASL de la région qui, contacté par Foreign Policy, les accuse même d’être encore présents. Directeur de la rédaction de Ayn Al-Madina, Ziad Awad confirme de son côté la dernière visite d’un ingénieur russe, acheminé par hélicoptère, en juin 2015.
Quoi qu’il en soit, les négociations entre l’EI, le régime syrien et Hesco débutent très rapidement, début 2015. A la manœuvre côté EI, le diwan Al-Rakaz, l’administration chargée de l’exploitation des richesses du sous-sol. Le « bureau », qui supervise l’industrie des hydrocarbures sur les territoires contrôlés par l’organisation, est organisé en divisions territoriales qui rendent compte directement à la haute hiérarchie de l’organisation. A Twinan, c’est Abou Bakr Al-Ourdouni, un ancien étudiant jordanien en pétrochimie, qui règne sur le site, flanqué d’un adjoint chargé de la sécurité : le Saoudien Abou Al-Hassaïb Al-Jazraoui, chef de la Hisba (la police islamique de l’EI), unanimement décrit comme un « cerbère » par d’anciens travailleurs du complexe gazier.
Le « loyer » fixé par les djihadistes de l’EI en contrepartie de la protection des installations est alors fixé à 15 millions de lires syriennes (72 000 euros) mensuellement, auxquels s’ajoutent des taxes dont l’EI s’est fait une spécialité dès lors qu’il s’agit de remplir ses caisses. Ainsi, des employés chrétiens se sont vu imposer « 24 grammes or en guise de jizya [l’impôt dû par les non-musulmans], payés par Hesco. La plupart ont été exfiltrés après des intimidations de la part de membres de l’EI », selon des témoignages d’anciens employés parvenus au Monde.
Tensions entre les djihadistes et le régime
Après deux mois de négociations, les deux parties conviennent finalement de se partager la production de la centrale électrique d’Alep, alors contrôlée par l’EI et alimentée par le gaz de Twinan : 50 mégawatts allant au régime et 70 mégawatts à l’organisation djihadiste, selon Bachir Al-Ibad et « Rakka se fait massacrer en silence ». Une répartition confirmée par Ayn Al-Madina. Selon les calculs de la revue, l’EI engrange alors 120 000 dollars (109 000 euros) par jour.
Tah Ali, un ingénieur précédemment en poste à l’usine de gaz Koniko de Deir ez-Zor, est transféré par le régime à Twinan pour y assurer la direction des opérations. Il va payer de sa vie l’exercice de ses nouvelles fonctions. Victime des tensions entre les djihadistes et le régime, il est exécuté à l’été 2015 sous les yeux des ouvriers de l’usine rassemblés par l’EI. Les opérations militaires et les difficultés d’approvisionnement en pièces détachées ont fini par faire plonger la production, et les deux camps s’opposent désormais sur la question du partage de la production, l’EI refusant de livrer du gaz à d’autres centrales électriques contrôlées par le régime.
Les opérations militaires et les difficultés d’approvisionnement en pièces détachées ont fini par faire plonger la production.Aujourd’hui, 20 000 mètres cubes de gaz sont produits, en pure perte. C’est loin, très loin des mois fastes de l’année 2015, quand le complexe produisait quotidiennement jusqu’à un million de mètres cubes et 2 000 barils de condensat. La faute, pour l’instant, aux « problèmes techniques et à un désaccord entre le régime et l’EI sur les débouchés de la production », selon Ziad Awad.
La centrale électrique d’Alep vient en effet d’être reprise par le régime à l’EI, et les deux camps s’affrontent violemment dans les provinces de Homs et de Deir ez-Zor. L’entreprise Hesco continue de nier toute collaboration passée ou présente avec l’Etat islamique ; la société Stroytransgaz n’a pas répondu aux sollicitations du Monde.
Madjid Zerrouky LE MONDE |
http://www.lemonde.fr/djihad-online/En-syrie-un-champ-de-gaz-a-reuni-russes-regime-et-etat-islamique
-
Mars 1956 : le vote des pouvoirs spéciaux pour la guerre en Algérie (Lutte Ouvrière)

Le 12 mars 1956, la majorité de l’Assemblée nationale, Parti communiste compris, accordait les pouvoirs spéciaux au gouvernement du socialiste Guy Mollet pour poursuivre la guerre en Algérie.
Et, dès le 17 mars, Guy Mollet donnait par décret les pleins pouvoirs à l’armée française en Algérie. Celle-ci allait s’en servir en employant les pires méthodes contre la population algérienne et le Front de libération nationale, multipliant massacres et opérations arbitraires et généralisant l’usage de la torture.
L’Algérie restait une colonie dominée par l’administration française et quelques grandes familles coloniales, comme Borgeaud et Blachette. Les Européens d’Algérie n’étaient évidemment pas en majorité de riches colons, mais ils occupaient de fait une position privilégiée par rapport aux Algériens.
Le statut de 1947, dû au socialiste Ramadier, accordait théoriquement la citoyenneté française à tous les Algériens, mais aux élections à l’Assemblée algérienne, les 9 millions de musulmans votaient dans un collège à part, n’ayant pas plus d’élus que le 1,2 million d’Européens. Et l’administration française bourrait les urnes pour faire élire des candidats musulmans à sa dévotion.
Guy Mollet et la « paix en Algérie »
Le Front de libération nationale avait engagé la lutte armée en novembre 1954 sous l’impulsion d’une poignée de militants nationalistes. La riposte de l’État français ne se fit pas attendre. L’opération de police se transforma en véritable guerre coloniale. Le gouvernement d’Edgar Faure fit appel aux réservistes. De 50 000 en 1954, les troupes françaises présentes en Algérie passèrent à 200 000 en 1955.
Le gouvernement, incapable de venir à bout d’un soulèvement montant, fit alors le choix de dissoudre l’Assemblée. Les socialistes, alliés à des radicaux et des mitterandistes au sein d’un Front républicain, se présentèrent aux élections de janvier 1956 en promettant « la paix en Algérie ». Guy Mollet, dirigeant du parti socialiste SFIO, évoqua des élections à collège unique, et qualifia la guerre en Algérie d’ « imbécile et sans issue ». Mais pour autant il considérait l’indépendance comme « une solution inacceptable pour la France qui deviendrait une puissance diminuée ». Guy Mollet se plaçait dans la continuité de la politique coloniale menée par ses prédécesseurs, tout en laissant entendre le contraire à ses électeurs.
À l’issue des élections, Guy Mollet fut chargé de former un gouvernement, dont le programme pourtant bien limité se heurta immédiatement à l’opposition des partisans de l’Algérie française en métropole et surtout en Algérie. En visite à Alger en février 1956, Guy Mollet fit face à une manifestation violente organisée par l’extrême droite colonialiste. Il recula immédiatement, démettant le ministre-résident Catroux, cible des manifestants, et le remplaçant par le socialiste et ancien syndicaliste Robert Lacoste. Ce dernier exigea immédiatement des moyens militaires supplémentaires, et les obtint.
Le gouvernement socialiste se montrait faible face à la droite, aux colons et à l’armée. Les masses algériennes, pour leur part, ne devaient en attendre que des coups.
Le PCF et les pouvoirs spéciaux
Avec la majorité de l’Assemblée, les élus du Parti communiste votèrent les pouvoirs spéciaux à Guy Mollet le 12 mars 1956. Ils savaient qu’ils approuvaient ainsi la poursuite de la guerre en Algérie. Mais le Parti communiste avait depuis longtemps abandonné toute politique anticolonialiste et se portait garant des intérêts de l’impérialisme français. Par ailleurs, le Parti communiste voulait rompre l’isolement dans lequel le confinaient les autres partis depuis le renvoi des ministres communistes en 1947. En votant avec les socialistes, le PCF espérait réintégrer le jeu politique et retrouver à terme des positions dans un gouvernement dirigé par les socialistes.
Le vote des pouvoirs spéciaux allait désorienter tous ceux qui, membres du PCF ou non, voulaient s’opposer à la guerre et au colonialisme. Cette complicité ouverte des organisations ouvrières françaises avec la politique coloniale contribuait à creuser le fossé entre les masses algériennes et les travailleurs de la métropole.
Les moyens militaires s’accrurent les mois suivants, avec le rappel immédiat de 70 000 réservistes et la mobilisation du contingent dont le service fut prolongé à trente mois. De 200 000 hommes, les effectifs militaires en Algérie montèrent à 400 000 en juillet 1956, avec mission de quadriller le territoire algérien. Une partie significative de la jeunesse, sous l’uniforme, était enrôlée pour faire subir aux populations d’Algérie les déportations, les emprisonnements, les tortures et les massacres.
Mitterrand, ministre de la Justice mais pas encore adhérent du PS, accorda les pleins pouvoirs aux tribunaux militaires, qui firent guillotiner de nombreux combattants algériens. En tant que ministre, il approuva l’exécution d’au moins trente militants du FLN et celle du communiste Fernand Yveton.
Suite à des attentats du FLN dans le centre d’Alger, le socialiste Lacoste donna carte blanche au général Massu pour « pacifier » la ville dans laquelle il lâcha ses paras en janvier 1957. Ce fut la « bataille d’Alger ». L’armée pratiqua systématiquement la torture. Le bilan fut de plusieurs milliers de morts et de plus de 20 000 arrestations.
La politique du gouvernement de Guy Mollet et de ses successeurs à participation socialiste jusqu’en 1958 fut menée sous la pression de la droite et des sommets de l’armée. L’incapacité de ces gouvernements à trouver une issue à cette guerre ignoble amena la fin de la quatrième République. La gauche de gouvernement finit de se déconsidérer en se jetant dans les bras de De Gaulle, que Mollet alla en personne tirer de sa retraite de Colombey. Les socialistes Guy Mollet et Max Lejeune participèrent d’ailleurs à son premier gouvernement, en juin 1958.
Les guerres coloniales, une constante dans la politique des socialistes au pouvoir
De Gaulle allait mettre fin à la guerre d’Algérie par un compromis avec le FLN, lors des accords d’Évian en 1962. Il fallut pour cela encore quatre ans de massacres. De Gaulle dut imposer un accord à l’armée et aux Français d’Algérie, ce que les socialistes n’avaient jamais osé faire.
Le Parti socialiste, pour sa part, sortit de la guerre d’Algérie profondément déconsidéré. Il ne réussit pas à présenter de candidature aux élections présidentielles de 1965, et en 1969, son candidat Gaston Defferre recueillit un score dérisoire de 5 %. Le Parti socialiste allait devoir attendre 1981 pour accéder de nouveau au pouvoir. Il allait s’inscrire d’emblée dans la continuité de la politique de la droite, en soutenant les dictatures sanglantes des ex-colonies alliées de la France, et en intervenant militairement pour maintenir les intérêts de l’impérialisme français, dans ses propres colonies, en Nouvelle-Calédonie, mais aussi en Afrique et au Liban.
Alain CHEVARD 02 Mars 2016