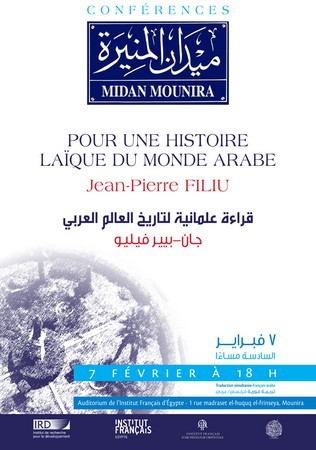Depuis le 15 novembre, le monde entier est ému par les cris d’alarme et les adieux déchirants que lancent les habitants et habitantes d’Alep, ville syrienne sous contrôle rebelle depuis 2012, en passe d’être totalement reprise par le régime de Bachar el-Assad.
Son aviation bombarde l’est de la ville et les zones résidentielles de l’ouest avec le soutien d’un porte-avions russe et de milices chiites composées de combattant libanais, afghans et iraniens, aux ordres de Téhéran. Elle utilise des bombes anti-bunker, dont la puissance permet de détruire des immeubles et des abris souterrains.
Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, elle a détruit au moins trois hôpitaux le premier jour. Le bilan humain était estimé mi-décembre à plus de 400 morts civils, dont de nombreux enfants, et plus de 350 parmi les combattants rebelles. Des chiffres sans doute sous-estimés et en constante augmentation : l’armée syrienne ne se contente pas de pilonner des bâtiments avec leurs occupants. Elle procède ensuite à des arrestations et à des exécutions sommaires.
À ces morts s’ajoutent au moins 40 000 déplacés, là encore un nombre qui continue de croître. Le régime s’apprête à reprendre le contrôle du pays et à gagner la guerre civile. Il procédera alors à un nettoyage ethnique et religieux en chassant la majorité sunnite des grandes villes insurgées. De leur côté, certains des « rebelles », comme le Front Fatah Al-Cham (qui prêtait allégeance à Al-Qaïda jusqu’à cette année) et les brigades Abu Amara (liées à l’Arabie saoudite et au Qatar) empêchent les civils de fuir en les assassinant ou en les enlevant.
Au Kurdistan, l’offensive lancée par Erdoğan depuis la fin de l’été est censée marquer un tournant dans la guerre, alors qu’en Irak, une nouvelle offensive a été lancée le 28 octobre pour reprendre Mossoul, au nord du pays. La coalition internationale agit avec les forces militaires du gouvernement de Bagdad et du Kurdistan « irakien », en lien avec les milices chiites Hachd al-Chaabi, proches de l’Iran.
L’État islamique en Irak et au Levant (Daech) subit de fortes pressions dans les deux pays. Depuis le 25 novembre, sa retraite entre les deux territoires est coupée. Mais pour combien de temps ? Et à quel prix pour les peuples de la région, toujours otages des calculs et rapports de force géopolitiques ? Exposés aux bombardements, servant de boucliers humains aux combattants de Daech en fuite, ils ont aussi à craindre les exactions des futures forces d’occupation une fois leur « libération » achevée...
Les hésitations et retournements des États-Unis, de la Russie et des pays ouest-européens vis-à-vis des forces régionales rivales ajoutent au chaos. La Turquie ou l’Iran sont tour à tour soutenus ou mis de côté ; le gouvernement de Bachar el-Assad, longtemps cible prioritaire, est depuis l’an dernier devenu secondaire par rapport à Daech. Et les voix sont nombreuses, de Trump à Fillon, à le considérer comme le « moindre mal ». Le PKK et le PYD aux Kurdistan « turc » et « syrien », sont alternativement qualifiés d’organisations terroristes ou d’alliés valables sur le terrain, tout comme les Hachd al-Chaabi...
Pour tenter de démêler les fils et de développer une orientation politique pour les militants et militantes anticapitalistes et internationalistes des pays impérialistes, un tour d’horizon et un détour par l’histoire récente sont nécessaires.
En Irak
Le Kurdistan « irakien »
Depuis le démantèlement de l’Empire ottoman au lendemain de la Première Guerre mondiale, le territoire kurde est séparé entre l’Iran, l’Irak, la Syrie et la Turquie. Les Kurdes sont 15 millions en Turquie (20 % de la population environ), 8 millions en Iran (18 %), 7 millions en Irak (20 %) et 2 millions en Syrie (8 %).
Excepté une éphémère république de Mahabad (capitale du Kurdistan « iranien ») en 1946, sous la protection de l’URSS, aucun État kurde n’a vu le jour.
Le Kurdistan « irakien » bénéficie cependant d’une grande autonomie depuis la fin de la guerre du Golfe de 1990-1991. Les deux principaux partis kurdes d’Irak, le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et l’Union patriotique du Kurdistan (UPK), sont des alliés de l’Iran depuis les années 1980 et la guerre Iran-Irak (trahissant au passage les Kurdes d’Iran, en lutte contre le gouvernement de la République islamique). Ils sont aussi alliés aux États-Unis depuis que ceux-ci se sont retournés contre Saddam Hussein. Leurs dirigeants ont accédé aux plus hautes fonctions grâce à l’invasion de l’Irak par les États-Unis en 2003. Massoud Barzani, dirigeant du PDK, est le président du gouvernement régional du Kurdistan depuis 2005. Jalal Talabani, de l’UPK, a été président de la République d’Irak de 2005 à 2014. Son successeur Fouad Massoum est issu de la même formation.
Pour Barzani, une victoire contre Daech prouverait la viabilité d’un État kurde indépendant. Il serait un rempart contre l’État islamique bien plus solide que le faible État irakien, et à terme un tampon entre la Turquie et l’Irak. Le projet d’un référendum d’indépendance a ainsi été ravivé en février 2016. Quitte à trahir, une nouvelle fois, le reste des forces kurdes, car pour s’assurer le soutien d’Ankara, Barzani n’hésite pas à dénoncer le soutien des États-Unis au PYD, organisation sœur du PKK au Kurdistan « syrien » (voir plus bas), pourtant en première ligne dans la lutte contre Daech.
La place de Bagdad dans le « croissant chiite »
Si la branche chiite de l’islam ne regroupe que 10 à 15 % des musulmans du monde, elle est majoritaire en Iran (environ 80 % de la population), en Irak (51 %) et à Bahreïn (50 %). Elle occupe la première place des communautés religieuses au Liban (25 %) et compte une très forte minorité au Yémen (45 %) et au Koweït (21 %). En Syrie, sa sous-branche alaouite ne représente que 11 % de la population, mais il s’agit de la religion de la famille Assad.
Au pouvoir, Saddam Hussein s’appuyait sur la minorité sunnite irakienne (tout de même 46 % de la population). Les partis et le clergé chiites se sont donc rapprochés de la République islamique d’Iran dès sa naissance en 1979, et plus encore pendant la guerre Iran-Irak (1980-1988). Les dirigeants du principal parti chiite, le Parti islamique Dawa (PID), ont vécu en exil, le plus souvent en Iran, de 1979 à 2003. À partir des années 1990, ils ont bénéficié du soutien des États-Unis. Le PID a ainsi participé en 1992 au Congrès national irakien, organisation créée par la CIA afin de préparer un éventuel gouvernement post-Saddam Hussein.
Depuis 2005, les trois Premiers ministres irakiens qui se sont succédé, Ibrahim al-Jaafari, Nouri al-Maliki et Haïder al-Abadi depuis 2014, sont issus du PID. Et si l’actuel chef du gouvernement se prononce pour une plus grande indépendance vis-à-vis de l’Iran, il sait à quel point son emprise réelle sur son territoire dépend de l’aide de Téhéran.
L’idée d’un « croissant chiite », de l’Irak au Liban en passant par l’Iran et la Syrie, avec l’Iran comme force motrice et la Russie comme parrain international, est apparue en 2004 dans une déclaration du roi Abdallah de Jordanie. Un projet de la Turquie, en lien avec l’Égypte, l’Arabie saoudite et le Qatar, serait d’y répliquer par un « axe sunnite ».
Mais si l’alliance politique entre Téhéran, Damas et le Hezbollah libanais est bien réelle, la convergence d’intérêts entre l’Iran et les États-Unis dans l’occupation de l’Irak, le choix de ses dirigeants et la lutte contre Al-Qaïda et Daech montrent que la situation ne peut être réduite à un simple affrontement de blocs.
Daech au « secours » des Arabes sunnites ?
Avec l’occupation militaire impérialiste de 2003 et donc la prise du pouvoir par les forces kurdes et chiites – fruit du compromis entre Washington et Téhéran –, la population arabe sunnite se retrouve dans la ligne de mire du nouveau pouvoir.
C’est par exemple le cas à Falloujah, lieu emblématique des conditions qui ont mené à la naissance et au succès de l’État islamique. Ville sunnite du centre du pays, où dès le 29 avril 2003, un mois après le début de l’invasion, l’armée américaine a fait feu sur une manifestation, tuant 13 personnes, elle est un an plus tard un lieu de convergence des groupes guérilléristes, constitués de partisans de l’ancien régime (Armée des hommes de la Naqshbandiyya, Brigades de la révolution de 1920) et de religieux sunnites intégristes (Al-Qaïda en Irak, Ansar al-Islam, Ansar al-Sunna, Armée islamique en Irak, Brigade de l’étendard noir).
C’est dans ce type d’affrontements qu’Al-Qaïda en Irak se lie à d’autres forces et individus, y compris d’anciens baasistes. De ces alliances naît l’idée qu’il ne faut pas simplement chasser les forces coalisées et les chiites, mais prendre le contrôle du pays ; autrement dit, créer, donc, un État islamique. Celui-ci est annoncé officiellement en 2006. Son premier « émir », Abou Omar al-Baghdadi, serait un ancien général de la police de Saddam Hussein.
Il faut près de 45 000 soldats de la coalition et du gouvernement, un mois et demi de bataille en novembre et décembre 2004, et des centaines voire des milliers de victimes civiles, pour mettre fin à l’insurrection. Pendant les dix années suivantes, la ville est maintenue sous contrôle militaire, mais sans qu’aucune politique de reconstruction et de services publics ne soit développée. En 2014, elle tombe dans les mains de l’État islamique sans résistance. Pour la population, malgré ses crimes et la terreur qu’il fait régner, Daech est souvent perçu comme un moindre mal.
Sa reprise par les forces gouvernementales et iraniennes en mai et juin 2016 occasionne de nombreuses exactions de la part des Hachd al-Chaabi et de la police gouvernementale : détentions arbitraires, enlèvements, torture, exécutions sommaires de civils.
La reprise de Mossoul
Au moment où nous écrivons ces lignes, l’État islamique est presque encerclé à Mossoul. Les troupes d’élite irakiennes auraient repris le contrôle de plus de 40 % de la ville. Les peshmergas seraient près d’y entrer, tandis que les Hachd al-Chaabi occuperaient les alentours, notamment les voies menant au fief syrien de Daech, Raqa. De leur côté, les bombardements de la coalition auraient détruit les derniers ponts enjambant le Tigre, au milieu de la ville. Sans renforts ni possibilité de se réalimenter, l’État islamique serait acculé.
Mais plus d’un million de civils sont eux aussi bloqués dans la ville. Dans les zones reprises, le couvre-feu est déclaré, preuve que les forces de libération ne sont pas exactement accueillies à bras ouverts.
Quant à Daech, la situation ne l’empêche pas de frapper à distance. Difficile de compter le nombre des attentats anti-chiites, de Bagdad à Kaboul ou à Beyrouth. Le dernier, le 24 novembre, a tué au moins 70 pèlerins revenant de la ville sainte chiite de Kerbala, dont une majorité d’Iraniens, alors que près de 20 millions de chiites avaient participé aux célébrations religieuses de l’Arbaïn.
Une façon de dire que même s’il perdait tous ses territoires, l’État islamique pourrait continuer longtemps ses attentats dans le monde entier. Al-Qaïda l’a fait bien avant lui.
En Syrie
PKK et PYD
Le Parti des travailleurs du Kurdistan (en kurde PKK) et le Parti de l’union démocratique (PYD) sont les deux branches d’un même mouvement né dans le Kurdistan « turc » en 1978 (pour le PKK) et implanté au Kurdistan « syrien » en 2003. Les branches armées du PYD sont les Unités de protection du peuple (YPG) et les Unités féminines de protection (YPJ). Le PYD contrôle le Rojava (« Ouest » en kurde) depuis 2012, avec la coalition des Forces démocratiques syriennes (FDS), qu’il domine totalement. Il a obtenu une autonomie de fait, sans doute négociée avec Assad. D’inspiration mao-stalinienne, le mouvement prétend avoir évolué vers des idées social-démocrates, féministes, autogestionnaires et « confédéralistes démocratiques » depuis 2005.
Le PKK est considéré comme une organisation terroriste par l’Union européenne et les États-Unis, mais pas le PYD. La Turquie considère les deux organisations comme telles. En revanche, le PKK bénéficie de longue date d’un soutien passif de l’Iran, qui l’autorise à se réfugier de son côté de la frontière. Depuis 2013, la République islamique lui fournit même des armes et un soutien logistique.
Et un pacte de non-agression est vraisemblablement en place entre le PYD et Assad. Le sectarisme des composantes arabes de l’Armée syrienne libre (ASL) vis-à-vis des revendications kurdes explique en grande partie sa méfiance et sa mise à l’écart du reste du mouvement anti-Assad. Mais il est paradoxal que cela l’amène à une alliance, au moins de fait, avec le dirigeant nationaliste arabe.
Certes, la lutte pour l’auto-détermination du plus grand peuple privé d’État, contre l’intégrisme, son héroïsme dans les affrontements face à l’État islamique ou la place occupée par les femmes dans les combats et l’organisation politique, placent incontestablement le courant « confédéraliste démocratique » dans le camp des organisations populaires progressistes. Mais ces qualités ne sauraient effacer les relents de stalinisme et d’autoritarisme qui doivent nous faire relativiser son caractère « libertaire » et « autogestionnaire » [Human Right Watch cite ainsi dans les territoires qu’il contrôle : « des arrestations arbitraires, des procès iniques et l’utilisation d’enfants soldats »].
Quoi qu’il en soit, sa capacité à résister à Daech force le respect, y compris à Washington. Dès septembre 2014, au début de la bataille de Kobané, ses dirigeants militaires ont été invités par l’état-major des États-Unis à indiquer les positions à bombarder. En octobre 2015, l’armée américaine lui a largué 50 tonnes de munitions et Obama a autorisé pour la première fois l’envoi de cinquante membres des forces spéciales sur le terrain aux côtés des FDS. Un affront complet pour la Turquie, qui n’a pas cessé de bloquer sa frontière pour interdire le passage de renforts kurdes dans la lutte contre Daech.
Erdoğan, d’abord contre le Rojava
L’opération « Bouclier de l’Euphrate » a été lancée le 24 août, quelques semaines après la tentative de coup d’État contre Erdoğan. Pour l’apprenti dictateur, le premier enjeu est de réaffirmer son rôle vis-à-vis de dirigeants occidentaux qui semblent hésiter à le soutenir, lui qui ne joue clairement plus son rôle de stabilisateur régional.
En reprenant l’offensive, et en prétendant la gagner, Erdoğan fait d’une pierre trois coups : combattre Daech, éliminer les FDS et regagner sa place auprès des États-Unis. L’arrestation, le 4 novembre, de députés et dirigeants du HDP [Coalition de la gauche de la gauche et de divers mouvements sociaux, le Partidémocratique des peuples a obtenu 13,4 % des voix et 80 députés en juin2015. C’est le principal parti pro-kurde au parlement turc] montre que de ces trois objectifs, le deuxième est le plus important.
Selon ses propres mots, la Turquie entend lutter « avec la même détermination » contre Daech et le PYD pour « créer une zone libérée des terroristes au nord de la Syrie ».
Le 24 août, une cinquantaine de chars turcs et quatre cents soldats sont donc entrés en Syrie dans le couloir de Djarabulus, seule partie de la frontière turco-syrienne sous contrôle de Daech, à l’ouest de l’Euphrate et du Rojava. Le 12 août, le FDS et les YPG/YPJ avaient repris des territoires à Daech, dont la ville de Manbij. Sans grande surprise, l’armée turque n’a pas affronté les djihadistes, en fuite dès son arrivée (les combats n’ont fait qu’un mort, dans les rangs des rebelles syriens). Elle n’a pas cherché à les poursuivre, mais s’est tournée vers les forces kurdes, les forçant à repasser à l’est de l’Euphrate. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), les frappes ont tué au moins 40 civils et blessé plus de 70 personnes dans les trois jours suivants . L’urgence pour Erdoğan étant d’empêcher la jonction des trois régions kurdes de Syrie (Afrin, Kobané et Djazira à l’est) que le FDS était sur le point de réaliser en chassant Daech .
Désormais, la zone est donc sous contrôle de la Turquie et de composantes de l’ASL [enl’occurrence, Nourredine al-Zenki et Faylaq al-Sham, deux partis« islamistes » modérés proches des Frères musulmans et la Brigade SultanMourad, composante turkmène de l’ASL] avec la bénédiction des États-Unis qui, par la voix du vice-président Joe Biden, ont menacé de retirer toute aide aux Kurdes s’ils ne repassaient pas l’Euphrate ; et celle de la France, qui y voit un lieu où renvoyer les réfugiés syriens de Turquie, plutôt que de les laisser partir vers l’Europe
Longtemps première cible d’Ankara, Assad n’est désormais plus un enjeu. Le vice-Premier ministre Numan Kurtulmuş explique même qu’une fois la « zone de sécurité » créée à la frontière, des négociations devront être ouvertes, auxquelles il serait « naturel » que participe Assad. Un changement de cap qui montre un réchauffement des relations de la Turquie avec l’Iran et la Russie (fait confirmé par la presse officielle iranienne elle-même), au détriment des Kurdes. Même Poutine est donc sujet aux retournements et trahisons d’alliés, alors que la Russie assurait encore son soutien au PYD en mai dernier.
Nos mots d’ordre
À bas l’impérialisme et ses crimes ! Solidarité internationale !
Dans toute cette complexité, certaines certitudes demeurent. D’abord, celle que le terreau qui a donné naissance à Daech, c’est l’occupation militaire impérialiste de l’Irak et un État défaillant, qui n’hésite pas à faire appel à des milices extra-gouvernementales, voire étrangères, pour faire régner la répression. Ce n’est certainement pas avec plus d’interventions militaires et le renforcement de l’axe chiite sous direction iranienne que les bases de Daech seront sapées. Au contraire, elles seront d’une manière ou d’une autre renforcées. Nous devons donc revendiquer l’arrêt immédiat de toutes les opérations militaires de la coalition, à commencer par les bombardements français. Le rapprochement envisagé, à Washington comme à Paris, avec Moscou, et donc Damas et Téhéran, montre bien l’hypocrisie de dirigeants prêts à défendre les pires régimes au nom de la stabilité, conscients qu’ils sont, pourtant, de renforcer la légitimité de l’État islamique auprès d’une population victime des gouvernements en place et de leurs complices impérialistes.
Du reste, depuis septembre 2014, ces bombardements visent exclusivement Daech. En très grande partie, ils ont servi Assad en le soulageant d’un front. Et ils ne font pas moins de morts et de drames. Quant aux groupes intégristes que les impérialistes soutiennent sur place, ils commettent les mêmes exactions contre les civils.
Ensuite, nous avons la conviction que la résistance doit venir du terrain et des peuples concernés. La désinscription du PKK de la liste des organisations terroristes, l’arrêt du soutien à Erdoğan et l’ouverture de la frontière turque sont des revendications urgentes évidentes. Leur satisfaction aurait sans aucun doute des conséquences immédiates dans la région. Elle affaiblirait Daech et presque autant la dictature naissante à Ankara. Mais défendre n’est pas soutenir ou, dans tous les cas, idéaliser le PKK et le PYD.
Dans le reste de la Syrie, la situation n’est certes plus celle de 2011. La terrible répression et la force militaire des groupes intégristes armés par l’Arabie saoudite, le Qatar ou la Turquie ont mis à mal les cadres d’auto-organisation démocratiques, laïques et populaires. Pourtant, en janvier 2014, c’est bien la population d’Alep qui a chassé Daech. Nous devons continuer de défendre les revendications de 2011 : la démocratie, la liberté, la justice sociale, le contrôle des richesses du pays.
Dans l’urgence, nous devons exiger l’ouverture des frontières et l’arrêt du soutien financier à Erdoğan, pour mettre fin à la prison à ciel ouvert dans laquelle sont bloqués les réfugiés. Leur accueil n’est pas une œuvre de charité, mais le minimum que puissent faire des puissances impérialistes qui sont directement responsables de la situation !
Jean-Baptiste Pelé
http://anticapitalisme-et-revolution.blogspot.fr
Commentaire: Anticapitaliste et Révolution est un des courants internes du NPA, affilié à la 4è Internationale, contrairement à "Révolution Permanente".