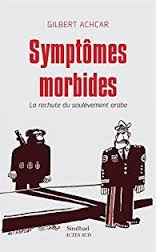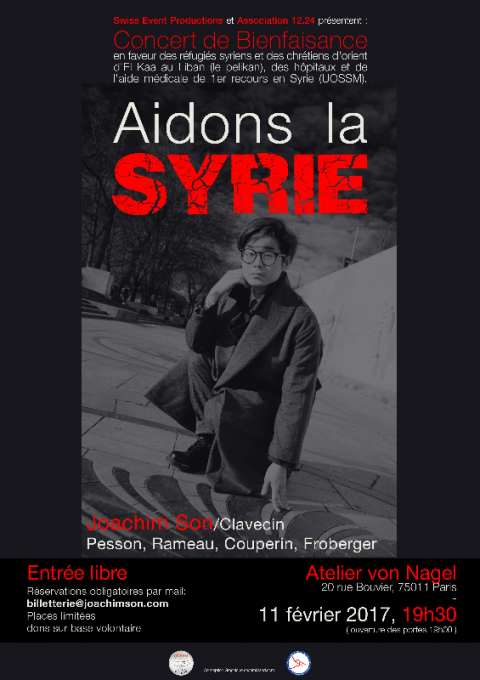La victoire russo-iranienne à Alep marque une nouvelle étape dans la mêlée impérialiste en Syrie. Moscou et Téhéran sont à présent en position de force pour régler le conflit à leur avantage, avec le consentement d’Ankara. Dans cette nouvelle configuration, la gauche kurde cherche à consolider le Rojava.
Les 23 et 24 janvier, à Astana (Kazakhstan), la Russie, la Turquie et l’Iran ont lancé un premier round de négociations de paix avec leurs clients respectifs – Bachar d’un côté, chapeauté par Moscou et Téhéran ; les brigades islamistes parrainées par la Turquie de l’autre. Les autres puissances ingérentes sont, pour le moment, en retrait. Mais que s’est-il passé pour qu’un tel retournement de situation soit possible ?
Il se passe que la Turquie, qui apparaît d’ores et déjà comme la grande perdante de la guerre civile en Syrie, cherche à sauver les meubles.
Erdoğan embourbé
En 2011, le Printemps syrien et sa féroce répression avaient convaincu le président turc que le régime Assad ne tiendrait pas longtemps, et qu’il fallait parier sur l’avenir. Il avait donc rompu les relations diplomatiques avec son allié de la veille et accueilli les partis d’opposition qui, à Istanbul, forment le Conseil national syrien. En peu de temps, pensait-il, serait installé à Damas un nouveau gouvernement qui serait son obligé. Dès la fin 2011, la Turquie finançait et armait les mutins de l’Armée syrienne libre (ASL), de même que la France, le Royaume-uni, les États-Unis et les pétromonarchies du golfe.
Las, tout a mal tourné.
Moscou et Téhéran ont volé au secours de Bachar, qui n’est pas tombé. Profitant du chaos, la gauche kurde – ennemie jurée d’Ankara – a proclamé l’« autonomie démocratique » du Kurdistan syrien. Erdoğan a surenchéri en encourageant les brigades salafistes et djihadistes qui ont émergé à cette époque, notamment le front Al-Nosra, puis l’État islamique.
On connaît la suite : les Occidentaux qui, peu confiants dans une ASL gangrenée par l’islamisme, renoncent peu à peu à leur soutien, songent un temps à intervenir militairement par eux-mêmes (2013), puis font machine arrière ; la montée en puissance de Daech (2014), qui acquiert des moyens de rétorsion envers son parrain turc ; la bataille de Kobanê qui met en lumière la duplicité d’Erdoğan ; l’enlisement des pétromonarchies dans une intervention désastreuse au Yémen (2015) ; les bombardements russes sur l’ASL qui remettent Bachar en selle et provoquent une escalade diplomatique avec Ankara...
A l’été 2016, le résultat de cinq ans d’intervention en Syrie est donc calamiteux pour le régime Erdoğan : Bachar est toujours là ; des sommes considérables ont été englouties en pure perte ; 2,7 millions de réfugiés syriens survivent sur le sol turc ; le Rojava et Kobanê ont galvanisé l’extrême gauche turque et kurde ; Daech a créé des cellules actives jusqu’à Istanbul ; la Russie a engagé des sanctions économiques contre la Turquie ; la guerre contre le PKK ravage de nouveau l’Anatolie.
Bref, le rêve néo-ottoman des années 2000, celui d’une Turquie à la fois membre de l’Union européenne et leader au Moyen-Orient, est en miettes.
La tentative de putsch de juillet 2016 couronne le tout, révélant que l’hostilité à l’aventurisme d’Erdoğan en Syrie a gagné jusqu’à l’état-major de l’armée – le rôle de confrérie Gülen, montrée du doigt par le pouvoir, ne suffit pas à expliquer cette sédition ni les purges de dizaines de milliers de personnes qui ont suivi.
Ce putsch raté décide Erdoğan à chercher une porte de sortie en Syrie tout en gardant la tête haute. Il renonce à renverser Bachar ; l’endiguement des Kurdes devient l’objectif prioritaire.
Le nouveau trio Moscou-Téhéran-Ankara
Entre août et octobre, c’est la réconciliation russo-turque dont on visualise bien, aujourd’hui, les tenants et les aboutissants : Poutine autorise la création d’une zone d’occupation turque en Syrie en échange du lâchage d’Alep-Est par Erdoğan, prélude à des négociations de paix. Washington a vraisemblablement acquiescé à la condition qu’Erdoğan lâche Daech.

- Poutine et Erdogan le 10 octobre 2016 à Istanbul. Le deal : laisse-nous prendre Alep ; je t’autorise à occuper le nord de la Syrie.
- cc Kremlin.ru
En septembre, l’armée turque envahit donc le nord de la Syrie, empêchant l’unification du Rojava. Daech lui cède le terrain sans résister. Dans la foulée, plusieurs milliers de combattants islamistes à la solde d’Ankara abandonnent Alep pour se replier dans la zone turque. Le mois suivant, l’offensive russo-iranienne contre Alep-Est débute. Elle se termine en décembre avec l’évacuation du dernier carré de combattants vers des territoires tenus par la rébellion – un deal, encore une fois, entre Moscou et Ankara [1]. Pendant que les vaincus d’Alep quittent la ville dans une noria d’autocars, l’armée turque et ses supplétifs donnent l’assaut à Al Bab, ville tenue par Daech, pour s’en emparer avant les Forces démocratiques syriennes (FDS, coalition arabo-kurde).
La nouveauté c’est qu’à Al Bab, pour la première fois, Daech ne se retire pas sans combattre. Malgré les bombardements de l’aviation russe, l’EI tient les Turcs en échec. Cela confirme deux choses : primo, l’armée turque a été passablement désorganisée par les purges de l’été ; secundo, le divorce entre Erdoğan et Daech est consommé. L’EI a d’ailleurs commis plusieurs attentats sur le sol turc – notamment le massacre du Nouvel An – et, pour la première fois, les a revendiqués. Jusqu’ici, Daech ne revendiquait ni ne démentait ses attentats en Turquie [2]. Ils avaient valeur de coups de semonce. Ce jeu-là est révolu. La guerre est officielle entre l’EI et son ex-parrain.
Les autres impérialismes sur la touche
Après Alep, l’avantage est donc aux impérialistes russes et iraniens. Leurs rivaux du golfe persique d’une part, occidentaux d’autre part, tergiversent.
Pour l’Arabie saoudite, le Qatar, et les Émirats arabes unis, l’objectif d’un remplacement de Bachar el Assad par un gouvernement islamiste s’éloigne. Leurs dollars alimentent certes toujours d’importantes brigades salafistes – dont Ahrar al Cham – qui ont refusé d’aller à Astana. Mais, enlisées au Yémen, les pétromonarchies sont plus que jamais inaudibles sur le dossier syrien. Leur seul gain dans cette affaire sera d’avoir anéanti la portée subversive de la révolution populaire de 2011 en nourrissant, en son sein, la contre-révolution islamiste.
Quant aux États-Unis, à la France et au Royaume-Uni, ils ont désormais renoncé à soustraire la Syrie à l’aire d’influence russe et iranienne. Cela ne signifie pas pour autant que l’impérialisme US va, avec fair-play, s’en laver les mains. Donald Trump demandera sans doute des gages avant d’approuver une éventuelle pax russia en Syrie – et celle-ci est loin d’être gagnée.
La gauche kurde sur la corde raide
Malgré sa déclaration de victoire, Bachar ne contrôle pas toute Alep. De 15% à 20% de la ville autour du quartier de Cheick Maqsoud sont contrôlés par les FDS [3]. Se tenant à équidistance du régime et des groupes rebelles pendant la bataille d’Alep, les FDS ont accueilli à Cheick Maqsoud à peu près un tiers des réfugié.es fuyant les bombardements russes – 8.000 à 30.000 personnes selon les sources –, dont des rebelles non islamistes. La police militaire russe a été déployée autour de Cheick Maqsoud, pour éviter tout accrochage avec le Hezbollah ou les soldats de Bachar.

- Les FDS contrôlent 15% à 20% d’Alep (ici un groupe de miliciens dans le quartier de Cheick Maqsoud, en avril 2016.
- cc YPG Alep
Dans le contexte post-Alep, la gauche kurde reste entourée d’ennemis. D’une part, Daech menace toujours. D’autre part, Ankara, Téhéran et Damas veulent étrangler cet insolent Rojava, contre-modèle démocratique et symbole anticolonialiste.
Pour le moment, Moscou et Washington font barrage à ces prétentions. Les Russes sont bien disposés à l’égard du Parti de l’union démocratique (PYD) et pensent que son inclusion est nécessaire dans un processus de paix [4]. Mais l’opposition des trois autres est totale à la présence du PYD aux négociations de Genève et d’Astana. Quant aux Américains, ils continuent de livrer des armes aux FDS tant que ceux-ci poursuivent la campagne Colère de l’Euphrate vers Raqqa, la capitale du califat.
Raqqa peut sembler un objectif téméraire pour les FDS, même si la libération de Manbij, en juin, a montré que le confédéralisme démocratique était « exportable » en dehors du Rojava. Mais selon une source proche de la gauche kurde, les FDS cherchent en premier lieu à s’emparer du barrage d’Al Tabqah, ce qui garantirait l’approvisionnement électrique du Rojava, et à engranger le plus possible de livraisons d’armes, en prévision d’un éventuel lâchage russe et américain et d’une confrontation directe avec Bachar et Erdoğan.
La gauche kurde s’efforce cependant d’éviter ce scénario. Fin décembre, un congrès a réuni, à Rmaylan, 151 délégué.es des cantons kurdes et des zones libérées par les FDS. Il y a été décidé d’adjoindre à l’appellation Rojava celle de « Fédération démocratique du nord de la Syrie », moins exclusivement kurde et clairement inscrite dans le cadre syrien. L’idée est d’éviter l’accusation de séparatisme tout en persévérant dans le projet fédéraliste [5].
Guillaume Davranche (AL Montreuil), le 19 janvier 2017
LA SYRIE, OTAGE DES CRIMINELS DES DEUX CAMPS
Pendant la bataille d’Alep, les médias occidentaux ont relayé, à juste titre, la détresse de la population civile sous le déluge des bombes russes. Mais, par rejet de Bachar, ils ont souvent été complaisants avec les rebelles d’Alep-Est. Notamment en minimisant la domination de l’extrême droite islamiste en leur sein, au motif que le front Fatah al Cham (proche d’Al Qaeda) y était minoritaire et l’ASL majoritaire [6]. Or l’ASL n’est qu’une étiquette, couvrant un agrégat de brigades dont beaucoup sont gangrenées par l’islamisme, voire « djihado-compatibles » [7].
Cette réalité était connue avant la bataille d’Alep [8] et les crimes commis par des brigades estampillées ASL largement documentés [9]. Le Monde, dans un long récit collectif, a bien raconté l’étranglement de la révolution à Alep dès 2013, réprimée par le régime et poignardée dans le dos par les djihadistes arrivés de l’étranger [10]. La victoire de cette rébellion dégénérée en Syrie aurait des conséquences redoutables non seulement pour les minorités, mais aussi pour les démocrates anti-Assad. Cela explique qu’une partie de la population préfère le maintien du régime, malgré ses crimes.
Massacres punitifs

- « Prisonniers en Syrie : des méthodes de survie désespérées »
- Lire les témoignages recueillis par Amnesty International.
De leur côté les médias du Kremlin – le site Sputnik ou la chaîne Russia Today –, ont encore plus biaisé leur information, en englobant toute la rébellion anti-Assad sous l’étiquette commode de « terroriste » et en réhabilitant un régime pourtant indéfendable : quarante ans de colonialisme, de hiérarchisation raciste et de terreur policière, pratiquant enlèvements, torture et meurtres à grande échelle. Fin 2013, un photographe des services de sécurité (sous le pseudo Caesar) avait déserté en emportant une clef USB contenant près de 28.000 photos de corps suppliciés, mettant des images sur ce que l’on savait de longue date. L’ONG Human Rights Watch a authentifié le document au terme d’une enquête de onze mois, recueillant des dizaines de témoignages d’anciens détenus et de familles ayant reconnu l’un des leurs sur les photos [11].
Amnesty International a, pour sa part, estimé à 17.000 le nombre de détenus morts en prison depuis 2011 : une moyenne de 300 morts par mois, soit cent fois plus que durant la période 2001-2011 [12]… Si l’on y ajoute les massacres punitifs de l’armée dans les zones rebelles, notamment les largages de barils d’explosifs sur la population civile, il devient évident que les prétentions de Bachar à régner de nouveau sur la Syrie sont illusoires. Reste à savoir ce que le Kremlin va faire de son protégé. G.D.
JUSTICE : LA MORT « BIEN OPPORTUNE » D’ÖMER GÜNEY
Le 9 janvier 2013, trois militantes de la gauche kurde, Sakinê Cansiz, Fidan Dogan et Leyla Saylemez, étaient abattues à Paris, en plein jour. L’enquête a montré que l’assassin, Ömer Güney, un militant d’extrême droite, était connecté aux services secrets turcs. Les investigations ne sont pas allées plus loin. Raison d’État : Paris n’a pas voulu se fâcher avec Ankara. Que vaut la vie de trois révolutionnaires kurdes ?
Gravement malade, l’assassin est finalement mort en prison un mois avant l’ouverture de son procès, qui devait avoir lieu le 23 janvier. Frustration et colère dans la diaspora kurde. Les avocats des familles ont dénoncé le peu d’empressement du parquet à fixer une date d’audience, alors qu’on savait Güney en fin de vie, permettant cette mort « bien opportune » alors que l’enquête n’a jamais été achevée. Conclusion : « La France n’est toujours pas capable de juger un crime politique commis sur le territoire français par des services secrets étrangers. »
Pour que l’affaire soit malgré tout jugée, la diaspora kurde organise une grande manifestation chaque année à Paris. Le 7 janvier, plusieurs milliers de personnes venues de France, d’Allemagne et de Belgique ont ainsi défilé à Paris, encadrés par un fort dispositif policier. Le Conseil démocratique kurde de France (CDKF) avait également mis en place un solide service d’ordre, et chaque manifestant.e était préalablement fouillé.e, pour réduire le risque d’attentat terroriste. Des délégations amazigh et arménienne étaient là, ainsi qu’AL, le NPA, le PCF, la CGA, la CNT et l’Union syndicale Solidaires.

- Près de 4.000 personnes ont défilé le 7 janvier à Paris à l’appel des organisations kurdes pour réclamer vérité et justice.
- (c) Xénia Kozlitina
Dans son allocution, AL a affirmé sa solidarité avec toutes celles et ceux qui luttent pour la justice sociale, la démocratie et l’égalité, et a dénoncé la duplicité du gouvernement français. Celui-ci salue la gauche kurde quand elle combat Daech, mais maintient le PKK sur la liste des organisations terroristes et bloque l’enquête sur l’assassinat de 2013. Ce même gouvernement condamne l’étouffement de la liberté de la presse en Turquie mais se tait quand l’armée turque martyrise le Kurdistan. Le discours, traduit en turc, a été très applaudi.