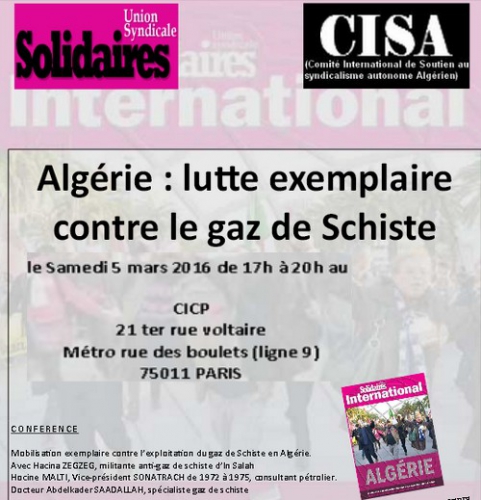La catastrophe continuera de s’approfondir
Au milieu de ce chaos, divers intérêts économiques et géopolitiques sont en jeu. Et ces nouvelles annonces d’une nouvelle vague d’interventionnisme ne seront synonymes que de souffrances supplémentaires pour les masses. On parle de négociation de paix, pour mieux dissimuler les offensives guerrières. On promet de signer un armistice, tout en proclamant que l’on va poursuivre les bombardements. Et ce sont les populations civiles qui payent. Des femmes, des enfants, des vieillards et des hommes qui fuient l’horreur, bombardés même dans les hôpitaux.
Tout le monde dit agir contre « le terrorisme islamiste ». Une bonne excuse, alors que le phénomène réactionnaire qu’est Daesh est précisément né de l’ingérence impérialiste et du chaos engendré sur le terrain. En définitive, chaque force en présence poursuit ses propres intérêts. Le régime de Bachar Al-Assad cherche avant tout à survivre et rester au pouvoir d’une manière ou d’une autre. L’Iran, soutenu par ses alliés libanais, soutient le régime pour contrer l’influence de l’Arabie Saoudite et réaffirmer sa nouvelle position géopolitique suite à l’accord sur le nucléaire signé avec les puissances impérialistes.
Quant à la Russie, son objectif en Syrie est de renforcer son allié Assad. Poutine, depuis le début de son intervention aérienne en septembre, cherche à faire en sorte que les occidentaux n’aient le choix qu’entre Daesh et Assad. En ce sens, il lui est fondamental d’aider le régime à écraser les rebelles (que la Russie appelle « terroristes ») soutenus par les occidentaux et ses alliés, à commencer par la Turquie et l’Arabie Saoudite. C’est de cette façon que la Russie pourrait réussir non seulement à conserver sa base militaire en Syrie, tout en renforçant son influence dans un éventuel régime de transition, mais aussi utiliser la Syrie comme un « monnaied’échange » avec les puissances occidentales, à commencer par celles de l’UE, dans le dossier ukrainien.
En ce sens, on comprend le ridicule des représentants politiques et de la presse en Occident exigeant que la Russie arrête d’attaquer les opposants « modérés ». L’écrasement de ces opposants du régime d’Assad fait partie des objectifs centraux de la Russie en Syrie.
Dans un même temps, les alliés des puissances occidentales tentent aussi d’avancer leur pion pour atteindre leurs objectifs. Et ces objectifs ne sont pas toujours les mêmes que ceux de leurs partenaires impérialistes. Ainsi, pour la Turquie, l’objectif principal en Syrie n’est nullement de combattre Daesh mais d’empêcher que les kurdes de Syrie sortent renforcés de ce conflit. Celle-ci ne va donc pas s’attaquer à Daesh si cela permet que les forces kurdes progressent. Au contraire, le régime d’Erdogan pourrait avoir plutôt tendance à aider directement ou indirectement Daesh et toutes les forces hostiles aux combattants kurdes.
Le problème qui se pose pour la Turquie actuellement, c’est que les États-Unis, dans leur tournant pragmatique en Syrie, deviennent des alliés conjoncturels des forces kurdes en Syrie, les seuls ayant réellement connu des victoires sur Daesh. Bien entendu, cette conjoncture fragilise l’alliance américano-turque.
L’Arabie Saoudite, quant à elle, voit dans le conflit syrien un moyen d’augmenter son influence et surtout bloquer le développement de l’influence iranienne, son rival régional. Ainsi, l’Arabie Saoudite ne va pas s’engager dans la lutte contre Daesh tant qu’elle ne s’assurera que cela ne va pas favoriser les alliés de l’Iran (Assad) et l’Iran lui-même en Syrie.
On comprend alors que l’avancée des forces d’Assad, appuyées par la Russie et l’Iran sur le champ de bataille, pousse la Turquie et l’Arabie Saoudite à envisager d’envoyer leurs propres troupes sur le terrain. Il ne s’agit en effet d’aucune tentative de sauver des forces démocratiques, ni de lutte contre le « terrorisme », mais de poursuivre leurs propres objectifs qui ne sont pas moins réactionnaires que ceux du régime d’Assad ou de Poutine.
Pour le moment, aussi bien Ankara que Riyad déclarent que leur mission en Syrie devrait être soutenue par les États-Unis. Or, ceux-ci, ainsi que les européens, ne veulent surtout pas que tout ceci ait lieu, notamment sur le fait que la Turquie s’engage en Syrie. Le risque étant que cela conduira sans aucun doute à des affrontements avec la Russie. L’OTAN serait alors dans un dilemme très difficile : soit soutenir un État membre, embarqué dans une aventure militaire et attaqué par une puissance nucléaire comme la Russie, soit rester en retrait et voir sa crédibilité affectée et, à terme, risquer l’explosion de l’Alliance Transatlantique.
À cela, il faudrait ajouter que les États-Unis voient (aujourd’hui) comme principal objectif en Syrie-Irak la défaite de Daesh afin de la présenter comme la fin de leur mission dans la région, et pouvoir pivoter dans un second temps leur politique internationale vers l’Asie-Pacifique. Mais cela ne sera pas si facile étant donné le chaos existant sur le terrain, conséquence en grande partie des interventions militaires impérialistes dans la région.
Les puissances de l’UE, quant à elles, cherchent de manière très pragmatique à faire en sorte que la guerre s’arrête pour mettre un terme au flux de réfugiés qui arrivent sur le continent depuis au moins un an. En ce sens, une intervention de la Turquie et de l’Arabie Saoudite pourrait avoir comme conséquence d’augmenter le flux migratoire vers l’Europe.
Comme on le voit, la direction politique, aussi bien des impérialistes et de leurs alliés régionaux, de la Turquie et l’Arabie Saoudite que celle de la Russie, de l’Iran et du régime Assad, est en train de préparer des troubles géopolitiques et sociaux néfastes dans toute la région et bien au-delà encore. En ce sens, il est inévitable que des phénomènes réactionnaires comme Daesh continuent à surgir, notamment face à l’absence d’alternative révolutionnaire pour les travailleurs et les classes populaires de Syrie qui s’opposent clairement à l’impérialisme, ainsi qu’à toutes les factions des classes dominantes locales. Philippe Alcoy 19 février 2016
http://www.revolutionpermanente.fr/Pourquoi-Turquie-et-Arabie-Saoudite-envisagent-d-envahir-la-Syrie
Commentaire: Contribution d'une "fraction" du NPA qui n'engage donc pas tout le parti...