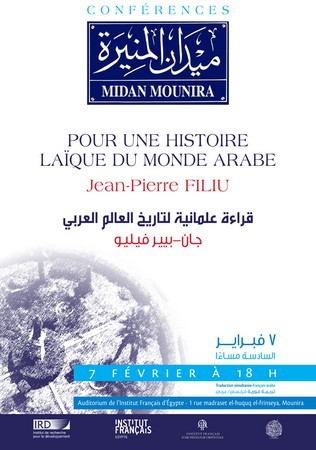Avec la chute d’Alep aux mains du régime de Bachar Al-Assad et de ses alliés, la révolution syrienne est arrivée à un tournant.
Il semble ne plus y avoir aucun obstacle à l’écrasement de celles et ceux qui ont osé se soulever contre un régime dictatorial, pour la liberté, la dignité et la justice sociale. Alors que les lambeaux de l’armée syrienne, l’aviation russe, le Hezbollah libanais et d’autres milices chiites sous commandement iranien annihilent toute résistance au régime, la « communauté internationale » et les États soi-disant « amis du peuple syrien » ont révélé leur impuissance au grand jour, qui trahit en réalité l’absence totale de soutien au processus révolutionnaire.
Malgré les différences majeures entre le mode d’organisation libéral du capitalisme des pays occidentaux et celui, autoritaire, du capitalisme de copinage des États de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, on pouvait difficilement espérer que les puissances capitalistes d’Europe et d’Amérique du Nord apportent leur soutien à un processus d’émancipation populaire dirigé directement contre l’exploitation et l’oppression.
Ces puissances sont au cœur du système impérialiste mettant à genoux les peuples des pays dits du Sud. Rappelons-nous d’ailleurs qu’en décembre 2010, la France avait offert son soutien au despote tunisien Ben Ali dans la répression du soulèvement, et que ces puissances sont aujourd’hui ravies de collaborer avec la contre-révolution menée en Tunisie conjointement par l’ancien régime et Ennahdha (Frères musulmans), ou avec celle dirigée par Al-Sissi et les militaires en Égypte. En l’absence d’expression de solidarité internationale par le bas, de mobilisations de masse en soutien à la révolution syrienne, il était vain de penser que des pays comme la France ou les Etats-Unis apporteraient leur soutien aux révolutionnaires syrien-ne-s (les gesticulations de façade devant les Nations unies ne pouvant être sérieusement assimilées à un soutien au processus révolutionnaire).
En ce sens, les forces progressistes se revendiquant de l’internationalisme et de l’anti-impérialisme portent une lourde responsabilité dans le drame qui continue à se jouer en Syrie.
Si une majorité de la gauche a fermé les yeux ces dernières années sur les crimes du boucher de Damas (Bachar Al-Assad) et de ses alliés, au nom d’une prétendue lutte contre l’obscurantisme islamiste, on aurait pu penser que cette gauche se réveillerait face aux massacres mis en lumière avec la chute d’Alep. Il n’en est rien. Au contraire, la fraction de la gauche qui s’était empêtrée dans différentes variations plus ou moins affirmées d’un campisme pro-régime et pro-russe s’enfonce plus encore dans une fuite en avant justifiant, relativisant ou niant les massacres de masse et les déplacements forcés de populations qui sont en cours. Une autre partie de la gauche, qui ne verse pas directement dans le campisme, a rapidement estimé que la révolution avait été entièrement pervertie par des forces réactionnaires, et s’est contentée d’adopter une orientation se limitant au soutien au mouvement d’autodétermination kurde qui a gagné en puissance durant la révolution syrienne. Le résultat final est que cette gauche a également abandonné les révolutionnaires de Syrie, voire participe d’une relativisation des crimes du régime.
Une vision géopolitique manichéenne au service de l’aveuglement campiste.
L’orientation dominante dans la gauche à l’échelle mondiale consiste à expliquer qu’il n’existe pas de processus révolutionnaire en Syrie. Le conflit opposerait uniquement des milices caractérisées par leur seul « islamisme » au régime de Bachar Al-Assad, considéré au mieux comme un moindre mal face à l’obscurantisme fondamentaliste, au pire comme le gouvernement légitime de l’État syrien. La caractérisation des groupes d’opposition par leur seule idéologie « islamiste » permet de ne faire aucune distinction entre les différents groupes armés de l’opposition à Al-Assad. Qu’importe de savoir si l’on parle de Jabhat Fatah Al-Sham (anciennement Jabhat Al-Nosra – ce groupe a changé de nom pour marquer sa rupture de façade avec Al-Qaida) ou d’un des multiples groupes armés présents en Syrie auxquels on peut attribuer de près ou de loin une idéologie islamiste : tous ces groupes sont rangés sous la même étiquette (qui est également celle de Daesh) et doivent ainsi être combattus de la même façon.
Dans cette lecture dominante à gauche, nombreux sont ceux qui nous martèlent que ces groupes ont pu apparaître et gagner en puissance grâce au soutien actif des Etats-Unis et de l’OTAN.
Et de rentrer dans des considérations réductrices uniquement basées sur des facteurs géopolitiques au mieux largement exagérés, au pire totalement inventés. Le conflit serait entièrement dû à la volonté des Etats-Unis de déstabiliser l’ensemble du Moyen-Orient pour y imposer des régimes qui leur seraient favorables (« regime change » en anglais). Dans cette logique, la Syrie est supposément une cible de choix car elle serait un carrefour géostratégique en termes d’acheminement d’hydrocarbures (oléoducs et gazoducs). Pour résumer, cette gauche calque sur la situation actuelle en Syrie les principaux points d’analyse de l’invasion de l’Iraq en 2003 par les Etats-Unis, qui y avaient imposé un changement de régime et sécurisé un accès important au pétrole du Moyen-Orient.
Les différents groupes armés rangés sous l’étiquette « islamiste » ont en effet été parrainés par la Turquie, le Qatar et l’Arabie Saoudite, trois pays alliés aux Etats-Unis.
Cela suffit pour que cette fraction de la gauche en conclue qu’il y a là une manœuvre des Etats-Unis et de l’OTAN. Cette vision ignore totalement les agendas propres à chacun de ces États. Si la réalité était si simple, comment expliquer le soutien des Etats-Unis au PYD (organisation « sœur » du PKK en Syrie) dans sa lutte contre Daesh, alors même que la Turquie y est opposée puisque cela renforce logiquement la position des Kurdes dans leur lutte pour l’autodétermination contre l’État turc ?
Comment expliquer le rapprochement entre la Turquie et la Russie ?
Quelle serait la logique pour les Etats-Unis de chercher à mettre au pouvoir en Syrie Jabhat Fatah Al-Sham, c’est-à-dire un groupe takfiriste affilié à Al-Qaida qui chercherait certainement à commettre des attentats en Europe et en Amérique du Nord s’il en avait les moyens ? Si les Etats-Unis étaient réellement à la manœuvre en Syrie pour renverser le régime, pourquoi ne sont-ils pas intervenus en août ou septembre 2013, lorsque la fameuse « ligne rouge » a été franchie par Bachar Al-Assad, c’est-à-dire lorsque le régime a utilisé des armes chimiques contre les habitant-e-s de la Ghouta ? Les Etats-Unis avaient alors une fenêtre rêvée pour intervenir, mais ne l’ont pas fait. En 2003, l’annonce d’un veto de la France, de la Russie et de la Chine au Conseil de sécurité de l’ONU n’avait pas empêché les Etats-Unis d’intervenir en Iraq. Et puisque les pro-Assad n’hésiteront pas à caractériser de mensonge cette utilisation d’armes chimiques par le régime, rappelons que c’est pourtant sur la base du mensonge des armes de destruction massive que les Etats-Unis sont intervenus en Iraq en 2003.
La gauche qui fait cette analyse adopte finalement la lecture du conflit proposée par le régime de Bachar Al-Assad :
celle d’une guerre opposant un gouvernement légitime à des groupes terroristes dirigés par des puissances étrangères occidentales. Cette gauche ignore totalement le rôle joué par le régime dans le développement de cette prophétie auto-réalisatrice. C’est le régime qui a libéré de ses prisons des centaines de jihadistes emprisonnés depuis leur retour d’Iraq où ils s’étaient battus contre l’invasion américaine. Le but de cette manœuvre était de nourrir les rangs de Daesh, de l’organisation qui s’appelait alors encore Jabhat Al-Nosra, et d’autres groupes salafistes. Par la suite, le régime et ses alliés ont constamment privilégié la lutte contre les groupes non-confessionnels et pro-démocratiques plutôt que d’attaquer Al-Nosra / Jabhat Fatah Al-Sham et Daesh. Le régime a également favorisé la confessionnalisation du conflit en faisant appel aux forces militaires fondamentalistes chiites que sont la République islamique d’Iran, le Hezbollah libanais et d’autres milices sous commandement iranien. Il est pour le moins paradoxal que cette gauche, qui soutient le régime dans sa lutte contre des « terroristes » caractérisés par leur idéologie islamiste, acclame par ailleurs ces alliés fondamentalistes d’Al-Assad.
Cette fraction de la gauche nous dit que ces forces étrangères, sans lesquelles le régime serait déjà tombé vu l’état de décomposition avancé de son armée « régulière », ne peuvent pas être des forces impérialistes puisqu’elles interviennent sur demande expresse d’un gouvernement « légitime ». D’une part, il faut avoir une acception pour le moins étrange de la légitimité pour oser affirmer que le gouvernement de Bachar Al-Assad rentre dans cette catégorie. Son père Hafez Al-Assad, général de l’armée de l’air, a participé à trois coups d’État, le dernier d’entre eux le portant au pouvoir en 1970. Lors de sa mort après trente ans d’exercice du pouvoir, Bachar Al-Assad lui succède en remportant une élection pour laquelle il est le seul candidat. Il est réélu dans les mêmes conditions en 2007. Il est enfin réélu en 2014 à travers une élection fantoche, alors que cela fait trois ans qu’il massacre ses opposants ou les pousse à l’exil.
Voilà la « légitimité » du régime.
D’autre part, cette gauche qui affirme que l’intervention étrangère des alliés du régime n’est pas une intervention impérialiste devrait savoir, pour s’être mobilisée à raison contre l’invasion de l’Iraq par les Etats-Unis, que Daesh trouve sa base sociale dans la désintégration de la société iraqienne après des décennies de guerres et d’interventions impérialistes. La dernière d’entre elles, l’invasion par les Etats-Unis en 2003, ayant abouti à la mise en place d’un régime sectaire dominé par les chiites et excluant la minorité sunnite de la société iraqienne. En somme, la base sociale de Daesh est née de la guerre, de l’autoritarisme et du sectarisme confessionnel. Trois caractéristiques reproduites par le régime de Bachar Al-Assad et ses alliés en Syrie.
En adoptant la vision du régime, cette gauche verse dans le conspirationnisme le plus abject, se rapprochant en cela de l’extrême-droite.
Les puissances occidentales, les nombreux médias bourgeois occidentaux, Al-Jazeera, les ONG sur le terrain, et tous les acteurs qui ne partagent pas cette vision du conflit, s’accorderaient pour nous vendre le plus gros mensonge du 21e siècle. Cette gauche ne voit aucun souci, en revanche, à reprendre les informations diffusées par Russia Today (RT) et Sputnik News, agences de presse du Kremlin, ou celles de SANA, agence de presse du régime syrien. Pire encore, alors que les réseaux sociaux nous permettent de manière inédite d’avoir accès à une multitude de témoignages de celles et ceux qui vivent directement la conflit, cette gauche n’accorde aucune importance à la parole des Syrien-ne-s sur place, et va même jusqu’à la balayer d’un revers de la main en la qualifiant de mensongère, niant ainsi le droit à l’auto-détermination du peuple syrien (nous y reviendrons plus loin).
Aujourd’hui, cette gauche a fait le choix de soutenir l’impérialisme russe sous prétexte de refuser l’impérialisme étatsunien.
Elle a fait le choix de soutenir un régime qui avait, dans les années précédant la guerre, ouvert son économie au néolibéralisme grâce à la participation active du Fonds monétaire international (FMI), demandé l’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et signé un accord de libre-échange avec la Turquie. Voilà la réalité du prétendu « anti-impérialisme » de Bachar Al-Assad : des politiques au service de la mondialisation néolibérale, au bénéfice d’un clan familial possédant le pouvoir politique et le pouvoir économique, et augmentant considérablement le chômage, la pauvreté et la précarité au sein de la population. En soutenant ce régime et ses alliés, cette gauche a fait le choix de soutenir les massacres de masse pratiqués à travers les sièges systématiques des villes échappant au contrôle du régime, les bombardements aériens, les barils d’explosifs lâchés par hélicoptères, les attaques à l’arme chimique, les viols, les actes de torture et les exécutions sommaires. Cette gauche a fait le choix de soutenir le déplacement et l’exil forcés de millions de Syriens et de Syriennes. Cette gauche a trahi l’internationalisme comme l’Internationale ouvrière l’avait trahi en s’engouffrant dans la Première Guerre mondiale.
La révolution syrienne abandonnée au profit du seul soutien aux Kurdes.
Si cette orientation est dominante au sein de la gauche, elle n’est pas pour autant unanime. Heureusement, une autre partie importante de la gauche a bel et bien identifié Bachar Al-Assad comme un ennemi, et ses alliés russe et iranien comme des acteurs impérialistes. Pourtant, au sein de cette fraction, une partie importante des camarades reste incapable d’identifier et de soutenir la révolution syrienne, au motif que ses composantes armées sont aujourd’hui dominées par des forces islamistes réactionnaires. Ces camarades en concluent que la seule force que la gauche internationaliste peut soutenir dans la situation actuelle en Syrie et en Iraq est le mouvement d’autodétermination kurde, et notamment sa composante administrant le Rojava, à savoir le PYD et ses composantes armées, les YPG/YPJ.
En affirmant cette position comme unique orientation sur la Syrie, ces camarades passent en grande partie à côté du problème.
Bien sûr, le soutien aux Kurdes dans leur lutte pour l’autodétermination contre l’État turc et contre Daesh est une tâche essentielle de la gauche internationaliste. Cette lutte pour l’autodétermination du peuple kurde sur des bases progressistes est un élément de réponse à la situation régionale caractérisée par des appareils d’État autoritaires, confessionnels, sectaires, et tout à fait capables d’appliquer un mode de production capitaliste. Mais les camarades qui voient ce soutien aux Kurdes comme l’unique réponse à apporter à la situation en Syrie abandonnent de fait la question du pouvoir et de la révolution en Syrie.
Cela est d’autant plus paradoxal que, là où ces camarades mettent l’accent sur les caractéristiques réactionnaires de la majorité actuelle des composantes armées de l’opposition à Bachar Al-Assad, ils et elles semblent incapables d’adopter une analyse critique du PYD et de ses forces armées YPG/YPJ (notons qu’une analyse critique n’empêche pas un soutien, lui aussi critique). Il y aurait pourtant des choses à dire sur la verticalité du pouvoir, sur l’anti-pluralisme pratiqué par le PYD dans les régions qu’il administre, sur les nettoyages ethniques et les déplacements de populations arabes dans les zones dont il prend le contrôle au fur et à mesure de sa progression militaire contre Daesh. Ces camarades, dont une composante importante vient pourtant de la gauche libertaire et autogestionnaire, semblent incapables de mentionner l’existence de manifestations de populations kurdes et arabes contre la politique du PYD dans les régions qu’il administre, et donc de les soutenir.
Avec la chute d’Alep, ces camarades se sont contentés de mettre en avant la résistance kurde dans le quartier de Sheikh Maqsoud et de souligner que les groupes armés d’opposition à Al-Assad avaient attaqué ce quartier plusieurs fois au cours des dernières années. Mais, en ne mentionnant pas le rôle pro-actif joué par la Turquie dans ces attaques, ces camarades semblent finalement expliquer que les groupes d’opposition à Al-Assad sont par nature réactionnaires et confessionnels. De plus, ces camarades ne semblent pas se poser de question sur le fait que les Kurdes aient gardé le contrôle de ce quartier – à l’heure où ces lignes sont écrites – malgré la chute de la ville aux mains des alliés du régime. Si ces camarades ne mentionnent pas cela, c’est peut-être qu’ils savent que l’attitude du PYD vis-à-vis du régime et de la révolution a été problématique.
Dès juillet 2012, le PYD a passé un accord tacite de non-agression avec le régime, qui a pu retirer la plupart de ses troupes dans les régions contrôlées par le parti kurde afin de les envoyer combattre la révolution dans le reste du pays. Cet accord a été confirmé par la proclamation de l’administration autonome du Rojava en novembre 2013. Bien évidemment, il n’existe pas d’alliance directe entre le mouvement kurde de Syrie et le régime d’Al-Assad, et les affrontements peuvent exister. Mais en refusant de s’affronter au régime, le PYD a affaibli la révolution. Au cours du premier semestre 2016, l’attitude du mouvement armé kurde a été particulièrement problématique : la conquête de territoires bombardés par la Russie dans la région d’Alep, tenus jusque-là par des groupes d’opposition à Bachar Al-Assad, a accompagné la progression du régime dans sa reconquête de territoires tenus par l’opposition. Ce manque d’analyse critique est d’autant plus regrettable que l’orientation du PYD, dépourvue de vision à long terme, risque de se retourner contre le mouvement kurde lorsque le régime et ses alliés en auront fini d’écraser les bastions de l’opposition à Alep et Idlib.
Bachar Al-Assad a toujours affirmé son opposition à la partition du pays, y compris à une forme d’autonomie des régions kurdes.
Cette absence de vision à long terme du PKK / PYD s’est déjà retournée contre le mouvement kurde lorsque Hafez Al-Assad l’a abandonné à la fin des années 1990 après l’avoir soutenu, précédant la répression de « l’Intifada kurde » par Bachar Al-Assad en 2004. Ou plus récemment au mois d’août 2016 lorsque la Russie a donné son feu vert à l’intervention au sol de la Turquie contre les Kurdes dans la région de Djarabulus, ce à quoi les Etats-Unis n’ont rien trouvé à redire malgré leur coopération militaire avec les YPG/YPJ dans la lutte contre Daesh.
Si les camarades qui sont sur cette position d’un soutien inconditionnel aux Kurdes uniquement ne cherchent pas à justifier ou à nier les crimes du régime et de ses alliés, ils participent cependant de leur relativisation. Ces camarades mettent sur un pied d’égalité la domination du régime et celle de milices inlassablement définies par leur « islamisme » quelle que soit leur disparité, et refusent ainsi de reconnaître que la reprise d’Alep (ou d’autres villes qui ont échappé au contrôle de Damas ces dernières années) par le régime de Bachar Al-Assad constitue indéniablement une défaite pour les révolutionnaires de Syrie. Ces camarades sont aveugles quant aux gigantesques capacités de coercition permises par la puissance militaire des alliés de Damas et par l’appareil d’État qui, malgré sa mauvaise condition actuelle, ne manquera pas d’être reconstruit. À travers leur orientation, ces camarades en arrivent à relativiser les conséquences dramatiques pour la population syrienne de la chute d’Alep et des autres villes jusque-là libérées du régime.
Le peuple syrien oublié et son droit à l’auto-détermination nié.
Il existe des points communs entre la trahison d’une partie de la gauche et les errements d’une autre. Le premier est la négation plus ou moins affirmée de la révolution syrienne, une partie de la gauche estimant qu’elle n’a jamais existé, une autre pensant qu’elle a été entièrement pervertie par des forces réactionnaires et que l’on ne peut dès lors plus parler de processus révolutionnaire. Ce travers est permis par une lecture essentiellement géopolitique et militaire du conflit. En raison de la généralisation du conflit à l’ensemble du territoire syrien, du nombre de brigades armées luttant contre le régime (plus d’un millier), du nombre d’acteurs étrangers impérialistes et sous-impérialistes intervenant directement ou indirectement dans le conflit, et du niveau extrêmement élevé de brutalité qui caractérise celui-ci, les observateurs extérieurs, y compris à gauche, ont parfois tendance à oublier qu’il existe, autour des groupes qui se battent, une société qui vit, composée de Syriens et de Syriennes dotés d’une capacité à penser, à agir, à interagir, et donc à s’organiser et à s’auto-déterminer, pour peu qu’ils et elles ne doivent pas faire face à un déluge de feu du régime et de ses alliés.
S’il est vrai qu’il n’existait pas d’organisation forte du mouvement ouvrier en Syrie au début de la révolution, capable de prendre la direction du mouvement révolutionnaire comme l’a fait l’UGTT en Tunisie, il y a eu et il y a encore de très nombreuses expériences démocratiques d’auto-organisation de la société.
Il semble évident que ces formes d’auto-organisation du processus révolutionnaire peuvent difficilement s’exprimer alors que les populations sont assiégées, bombardées et massacrées. Mais lorsque des cessez-le-feu ont pu être appliqués, comme cela a été le cas en février et mars 2016, puis pour une courte durée et de manière précaire en septembre 2016, les manifestations de masse orientées non seulement contre le régime mais aussi contre les milices réactionnaires (notamment Al-Nosra) ont repris.
Dans un article écrit au printemps dernier, Ghayath Naisse, du Courant de la gauche révolutionnaire en Syrie, écrivait ainsi :
« le mouvement populaire reste vivant : il renoue avec les mots d’ordre de la révolution de 2011, en particulier avec les manifestations quasi quotidiennes à Ma’arrat al-Numan [contre le front Al-Nusra, branche syrienne d’Al-Qaeda], Salqin, Kifr Nubil et Saraqib, contre le régime et les forces réactionnaires. Et à Hama, 800 prisonniers politiques démocrates ont pris le contrôle de la prison centrale depuis un mois. » Aujourd’hui encore, face à la chute d’Alep et à son évacuation chaotique par le régime et ses alliés, des manifestations populaires s’organisent partout dans le pays. S’il est finalement peu étonnant que la gauche campiste, majoritairement issue de courants historiquement marqués par le stalinisme et d’autres formes d’organisations aux structures verticales et rigides, soit incapable d’identifier ces formes d’auto-organisation, il est cependant surprenant qu’une partie importante de la gauche de tradition libertaire et autogestionnaire ne se soit pas penchée sur ces processus.
En niant le processus révolutionnaire, ces fractions de la gauche se privent d’expliquer la montée en puissance des groupes armés islamistes et réactionnaires.
Si les progressistes et les démocrates sont aujourd’hui minoritaires dans la composition des groupes armés s’opposant à Al-Assad, c’est notamment parce qu’ils n’ont jamais été soutenus politiquement, financièrement et matériellement par une aide extérieure (le soutien des États occidentaux s’étant limité à de belles paroles et à des armes délivrées au compte-goutte, essentiellement dans un objectif de lutte contre Daesh et non contre le régime syrien – par ailleurs, ces armes n’incluaient pas les armes défensives pourtant demandées par les révolutionnaires, refusées par les Etats-Unis). Comme cela a été indiqué en introduction, l’absence d’un mouvement de solidarité internationale est largement responsable de cette absence de soutien. Comme cela a déjà été indiqué également, au sein de l’opposition, ces groupes ont été visés en priorité par le régime afin que sa prophétie de lutte contre le terrorisme islamiste s’auto-réalise. Par ailleurs, ces groupes ont dû se battre sur plusieurs fronts – à la fois contre le régime, contre Daesh, et contre les groupes d’opposition islamistes et réactionnaires. Pour une majeure partie d’entre eux, ces groupes ont donc été progressivement marginalisés et décimés, ou bien captés par les groupes d’opposition islamistes qui, eux, étaient activement soutenus par le Qatar, l’Arabie saoudite, puis la Turquie.
Il paraît cependant évident que les groupes réactionnaires du type Jabhat Fatah Al-Cham sont incapables de répondre aux exigences de liberté, de dignité et de justice sociale du peuple syrien et qu’ils participent de la contre-révolution (il n’est pas anodin que le régime ait favorisé le développement de cette opposition au détriment de l’opposition progressiste et démocratique). Leur base sociale s’effriterait rapidement si la guerre cessait et si les processus d’auto-organisation pouvaient de nouveau s’exprimer pleinement. En l’absence de moyens de coercition comparables à ceux de l’appareil d’État syrien et de la puissance militaire des alliés du régime, ces groupes réactionnaires seraient très certainement marginalisés par la population.
En août 2013, suite aux mouvements de masse chassant Mohamed Morsi du pouvoir en Égypte, Alain Gresh écrivait très justement à propos des Frères musulmans, qui avaient été réprimés durant plus d’un demi-siècle avant d’accéder au gouvernement à la faveur du processus révolutionnaire : « Ce que la répression n’avait pas accompli, deux ans et demi de vie publique et d’un débat pluraliste, plus ouvert et souvent polémique, l’ont réussi : exposés à la lumière, les Frères ont inexorablement reculé. » Aucune raison n’aurait empêché cela de se produire contre les groupes réactionnaires syriens si la révolution avait pu s’exprimer librement (par contre, tant la brutalisation et la confessionnalisation de la guerre par le régime en Syrie, que la répression de masse dont sont – de nouveau depuis la prise de pouvoir d’Al-Sissi – victimes les Frères musulmans en Égypte, créent les conditions d’existence de ces mouvements fondamentalistes dans la région).
Plus généralement, cette négation de la révolution syrienne et son assimilation à des groupes réactionnaires caractérisés uniquement par leur « islamisme » trahit un problème de fond particulièrement inquiétant : celui d’une condescendance, d’une islamophobie et d’un racisme envers les peuples de la région arabe.
Si ces fractions de la gauche ne font aucune distinction entre Jabhat Fatah Al-Sham et autres groupes salafistes, les groupes affiliés aux Frères musulmans, Daesh, voire même, pour certains, les combattants – ou civils – scandant « Allahu Akbar » (qui n’a rien d’un slogan spécifiquement fondamentaliste), c’est sans doute parce que les discours sur le choc des civilisations et la guerre contre le terrorisme, qui trouvent pourtant leur origine aux Etats-Unis, ont fait leur effet. Pourquoi s’évertuer à comprendre les distinctions idéologiques entre ces différentes factions, la composition de leurs bases sociales, leurs différentes stratégies d’expansion, etc., quand on peut tout simplement les ranger sous l’étiquette « islamiste » ? Pourquoi chercher à identifier des formes d’auto-organisation dans des sociétés gangrénées par le fondamentalisme islamique, d’autant plus quand les pancartes sont écrites en arabe et que, pour l’œil européen, « Justice sociale » pourrait aussi bien s’apparenter à « Charia pour tous » ?
La fraction de gauche soutenant uniquement – et de manière idéalisée – le PYD dans la région appuie sur le fait que celui-ci est multi-confessionnel et non-arabe – en somme, les Kurdes sont des gens civilisés, et non pas des barbus. La gauche campiste procède avec le même raisonnement en ce qui concerne le régime de Bachar Al-Assad, sensé représenter un compromis multi-confessionnel (comme nous l’avons écrit plus haut, cette représentation ne reflète pas la réalité de la confessionnalisation du conflit par le régime). Cette gauche en oublie d’ailleurs la discrimination pratiquée par le régime envers les populations non-arabes.
Paradoxalement, ces fractions de la gauche tendent à reproduire le discours dominant visant à essentialiser les peuples arabes comme étant des peuples passifs, incapables de s’organiser afin de résister à l’exploitation et à l’oppression, entièrement soumis à la coupe de groupes violents, qu’il s’agisse de milices islamistes ou d’États autoritaires. Et dont la seule expression politique organisée de manière forte ne pourrait qu’être le fondamentalisme islamique.
La solidarité internationale avec les exploité-e-s et les opprimé-e-s comme boussole.
Les forces progressistes et démocratiques de la révolution syrienne sont aujourd’hui minoritaires dans l’opposition armée, et il est difficile de les identifier. Pour autant, les expériences démocratiques d’auto-organisation perdurent, et notre tâche est de les soutenir. Mais dans la guerre, les révolutionnaires ont peu de moyens de s’exprimer : s’ils et elles ne sont pas mort-e-s, ils et elles sont déplacé-e-s, réfugié-e-s, tentent de survivre. S’il était juste d’armer la révolution face à la répression impitoyable du régime, le conflit militarisé ne bénéficie plus aujourd’hui qu’aux forces de la contre-révolution, c’est-à-dire au régime et aux brigades réactionnaires. À travers les massacres de civils, ce sont les forces vives de la révolution qu’on assassine.
Aujourd’hui, la tâche prioritaire pour les internationalistes est donc de revendiquer l’arrêt des combats, des bombardements et des sièges contre la population syrienne, le retrait des troupes étrangères soutenant Al-Assad (mais aussi l’arrêt des bombardements de la coalition contre Daesh qui tuent des civils et contribuent à la catastrophe humanitaire, et l’arrêt du soutien du Qatar, de l’Arabie saoudite et de la Turquie aux différents groupes réactionnaires), et l’accès de la population à une aide humanitaire sans ingérence étrangère. Bien sûr, on ne peut imaginer de paix sans justice, qu’il faut donc également revendiquer. Mais ce sont les Syriens et les Syriennes eux-mêmes qui pourront établir le rapport de forces nécessaire à son obtention. L’arrêt des combats et le retrait des forces impérialistes sans lesquelles le régime serait déjà tombé permettront au peuple syrien de reprendre son combat politique contre un mode d’exploitation et d’oppression féroce, et de reconstruire progressivement le rapport de forces nécessaire à l’éviction de Bachar Al-Assad et à l’établissement de la justice sociale.
Les internationalistes doivent indispensablement exprimer leur soutien au processus révolutionnaire syrien, relayer sa parole et ses exigences.
Afin de réaliser cela, nous devons continuer à construire des ponts avec les militant-e-s progressistes de Syrie, sur place, mais aussi dans les pays où ils et elles sont réfugié-e-s, y compris en Europe – ce qui implique de lutter contre la politique migratoire de l’Europe forteresse et d’ouvrir les frontières afin de garantir à toutes et tous la liberté de circulation et d’installation. Notre boussole ne doit pas être déterminée par les agendas des puissances impérialistes et sous-impérialistes, mais par le soutien indéfectible à l’auto-organisation des exploité-e-s et des opprimé-e-s partout dans le monde. Ainsi, au-delà du peuple syrien en lutte contre le régime de Bachar Al-Assad, notre solidarité va à tous les peuples en lutte dans la région, contre l’autoritarisme et le sectarisme des Al-Sissi, Erdogan, Khomeiny et des autres, contre l’Apartheid israélien, contre les bombardements au Yémen et en Iraq, et contre nos impérialismes complices de ces situations. En Syrie, dans l’ensemble des pays du Maghreb et du Machreq, et dans le monde entier, « le peuple veut la chute du régime ! »
http://www.lcr-lagauche.org/
20 décembre 2016 Nathan Legrand
http://www.anti-k.org/