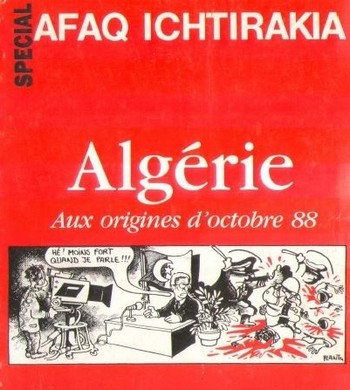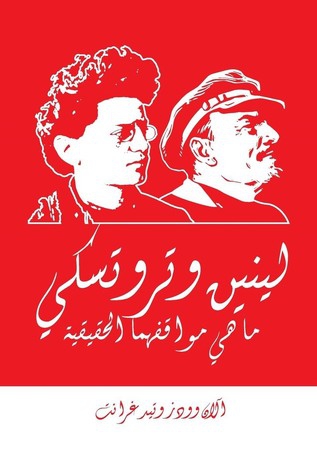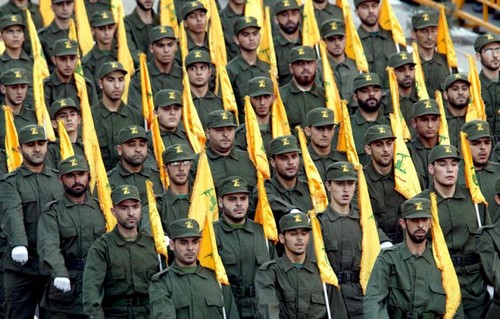Benjamin Stora est parmi les historiens français les plus connus pour ses études sur la guerre d’Algérie. Il a écrit entre autres Dictionnaire biographique de militants nationalistes algériens, L’Harmattan, 1985; Les sources du nationalisme algérien, L’Harmattan, 1989; L’histoire de l’Algérie coloniale 1930-1954, La Découverte, 1991; Histoire de la guerre d’Algérie 1954-1962, La Découverte, 2004 dernière édition; Histoire de l’Algérie depuis l’indépendance (1962-1988), Repères/La Découverte, 1995; La guerre invisible: Algérie, années 90, Presses de Sciences-Po, 2001; sous la direction de Mohammed Harbi et Benjamin Stora, La Guerre d’Algérie – 1954-2004, la fin de l’amnésie, Robert Laffont, 22 mars 2004; La gangrène et l’oubli: La mémoire de la guerre d’Algérie, La Découverte Poche, 2005; La guerre d’Algérie vue par les Algériens, tome 1, Denoël, 2007; Algérie 1954-1962: Lettres, carnets et récits des Français et des Algériens dans la guerre (avec Tramor Quemeneur), Arènes Editions, 2010; La Guerre des mémoires – La France face à son passé colonial (avec Thierry Leclère), Editions de l’Aube, 2011; La Guerre d’Algérie expliquée à tous, Seuil 2012.
Stora a commencé à étudier la guerre d’Algérie dès la seconde moitié des années 1970, au moment où la France découvrait enfin Vichy, entre autres grâce à l’historien américain Paxton et du documentaire d’Ophuls, Le chagrin et la pitié. Stora a été un militant politique engagé. Il l’explique dans une autobiographie politique, La dernière génération d’Octobre, Stock (septembre 2003). Benjamin Stora est né dans une famille juive en Algérie – depuis le décret Crémieux de 1870, les juifs d’Algérie sont considérés comme citoyens français – à Constantine, en 1950. En 1955, Constantine sera l’une des grandes villes soumises à une offensive militaire de l’armée française et Stora découvrira, à l’âge de 5 ans, cette guerre. Dans son autobiographie, il fait une description pleine de tact et de subtilité de son enfance, de sa famille et du choc que fut, pour lui et pour elle, la guerre d’Algérie.
Pour celles et ceux qui liront ces propos, l’étude de « l’histoire de la guerre d’Algérie », c’est-à-dire de la période allant de 1954 à 1962, devrait être poursuivie en lisant des ouvrages mentionnés ci-dessus. (Rédaction A l’Encontre)
Un sujet qui n’est plus tabou en France
Un sujet fait un retour en force dans la société française depuis de nombreuses années, un sujet sur lequel je travaille depuis près de trente ans, l’Algérie, la guerre d’Algérie, la guerre d’Algérie dans les sociétés française et algérienne, c’est-à-dire entre les deux rives de la Méditerranée. Il est évident que cette question de la guerre d’Algérie, dont nous allons commémorer, si l’on peut dire, le 50e anniversaire de son déclenchement, puisque cette guerre commence en fait en novembre 1954, eh bien cette guerre d’Algérie, plus on s’en éloigne, et plus elle semble de plus en plus présente dans la société française d’aujourd’hui, plus elle se rapproche de nous, elle est autour de nous et elle semble travailler en profondeur la société française, que ce soit sur les questions de l’islam, que ce soit sur les questions d’immigration, ce qu’on appelle aujourd’hui le communautarisme, les questions du terrorisme, de droits de l’homme, la question de la torture. Toutes ces grandes questions ont été soulevées pendant la guerre d’Algérie, se sont produites et ont été engendrées dans et par la guerre d’Algérie. On pourrait dire aussi que cette guerre d’Algérie, cette période a été aussi trop importante dans la mesure où elle a été une période qui a vu la chute de la IVe République, la naissance de la Ve République et avec cette naissance la Constitution de la Ve République avec laquelle nous vivons encore. Et c’est donc par conséquent un événement fondateur de la Ve République. Un événement qui intègre des éléments tels que: le retour d’un million de pieds noirs, ceux qu’on va appeler les rapatriés d’Algérie; le massacre des harkis après la fin de la guerre d’Algérie, mais également le fait que cette guerre a vu des centaines et centaines de milliers de jeunes Français aller «de l’autre côté de la Méditerranée». Environ 1,2 million ont été en Algérie dans l’armée. Il s’agit d’hommes du contingent et non pas seulement de professionnels comme cela avait été le cas en Indochine. Ils ont passé 6 mois, 12 mois, 15 mois, 30 mois en Algérie. Ils y ont passé leur jeunesse, en quelque sorte. Ils ont découvert à la fois un pays magnifique, avec des paysages merveilleux, mais ils y ont aussi découvert la misère, la misère du tiers monde, le système colonial et la guerre, ce qui signifiait pour eux le rapport à la mort. Cette période les a marqués fortement.
Pour la société algérienne, cette guerre constitue aussi de même l’acte fondateur de la nation algérienne dans la mesure où c’est au travers de cette guerre que l’Algérie a accédé à son indépendance politique en 1962. Cette guerre a vu près d’un million de paysans déplacés par l’armée française dans les «zones interdites» à partir de 1956-1957. Cette guerre d’Algérie, c’est aussi l’exode de plusieurs centaines de milliers de personnes aux frontières, c’est-à-dire au Maroc et en Tunisie. Ils ont dû attendre l’indépendance de l’Algérie pour revenir dans le pays. Enfin, cette guerre, c’est aussi pour les Algériens des exactions, des exécutions sommaires – ce que l’on appelait les «corvées de bois» – et donc aussi la mort de centaines de milliers d’Algériens.
A partir de ces grands traits, on peut constater que cette guerre a marqué profondément les deux sociétés. La société française avec la naissance de la Ve République, avec toute cette jeunesse qui est née entre 1932 et 1943 et qui a été mobilisée dans le contingent. Cette génération a connu l’Algérie et une partie d’entre elle vit encore avec l’Algérie «dans sa tête». Il y a aussi tous ces enfants de pieds noirs, de harkis, d’immigrés – car c’est durant la guerre d’Algérie que l’immigration algérienne en France a été presque multipliée par deux. On est passé de 220000 immigrés algériens en France en 1954 à près de 400000 en 1962.
Cette guerre a été une sorte de cataclysme social, politique et culturel. Elle n’a pas été regardée en face par la société française après 1962. Elle a été ensevelie dans l’oubli. Elle avait été à l’origine, aussi, de la mort de 25000 soldats français. Elle a été recouverte par ce qui a été appelé, quelques années plus tard, les «événements de 1968». La génération de 1968, la voix de cette génération, vient en quelque sorte recouvrir la voix de ceux du djebel (c’est-à-dire les régions montagneuses telles qu’elles sont nommées en Afrique du Nord), autrement dit la voix de ceux qui font la guerre dans ces régions d’Algérie. Il faut attendre la fin des années 1990 pour que cette guerre d’Algérie revienne avec force dans la société française. On en reparlera lorsque l’Assemblée nationale française, en juin 1999, va reconnaître qu’il n’y a pas eu d’événements en Algérie ou de simples opérations de police, mais véritablement une guerre. Elle reviendra aussi au travers de toute une série d’ouvrages sur les exactions, la torture, des livres de témoignages, et aussi par des travaux universitaires.
Comment écrire la guerre d’Algérie ?
Le travail historique s’est d’abord effectué sur les «traces écrites», les archives. Les principales archives sur la guerre d’Algérie sont déposées en Aix-en-Provence. La France, en 1962, a rapatrié la quasi-totalité des archives présentes en Algérie. Les Algériens se battent depuis des années pour se réapproprier une partie de ces archives. La France s’y refuse, car elle estime des «archives de souveraineté», puisque l’Algérie était française. Les archives couvrent la période 1830-1962. Elles réunissent un éventail très large, allant des archives civiles à celles des renseignements, de la police qui surveillaient les multiples manifestations des «Algériens musulmans» tels qu’ils étaient nommés. Dans l’histoire de l’Algérie coloniale, les organisations religieuses, politiques, culturelles jouent un rôle important. Les archives des Renseignements généraux sont une autre source très importante qui m’a servi, après ma thèse sur Messali Hadj [leader du nationalisme algérien, né à Tlemcen en 1898 et décédé à Paris en 1974], de faire ma thèse d’Etat sur l’immigration algérienne en France. Ces archives doivent être utilisées avec précaution, car elles renseignent aussi sur la mentalité de ceux qui sont chargés de surveiller les indigènes, comme l’administration les nommait. Dans ces archives, on trouve une partie des éléments se rapportant à l’univers des militants politiques en particulier. La presse est une autre source, même si de nombreux journaux, tels que l’Express, Témoignage chrétien, Le Canard enchaîné ou L’Observateur [qui deviendra France Observateur et aujourd’hui Le Nouvel Observateur], ont été très souvent censurés. C’est une période où la présence de la télévision n’était pas celle que l’on connaît aujourd’hui. La radio était un média très important pour s’informer, outre la presse écrite, c’est l’époque naissante du transistor. C’est en 1955 qu’Europe 1 est créée. C’est à la radio que travaille un journaliste comme Yves Courrière, auteur des Fils de la Toussaint (Fayard 1970). La couverture radiophonique de la guerre d’Algérie est une source aussi cruciale. J’ai déjà cité Europe 1, il faudrait aussi mentionner RTL. Ce sont des radios qui ne sont pas des radios gouvernementales. Il y a aussi la radio du mouvement d’indépendance, La Voix des Arabes, qui est très écoutée parmi la population algérienne musulmane. Cette dernière disposait ainsi d’informations sur ce qui se passait dans les maquis.
Il y a une deuxième source que l’on peut réunir sous le titre: les témoignages d’acteurs. L’histoire orale est particulièrement importante si l’on a à l’esprit que la majorité de la population était paysanne, analphabète. Pour restituer les besoins, les perspectives, les désirs de cette population, il faut pratiquer la langue et communiquer avec elle. Il faut recueillir les témoignages des acteurs encore vivants. C’est la base de mon Dictionnaire biographique des militants algériens, quelque 600 portraits de militants nationalistes indépendantistes. J’ai recueilli les témoignages de ces militants et je les ai confrontés aux archives.
Une troisième source existe. Elle a été peu utilisée jusqu’à présent. Ce sont les images, les sources visuelles. Depuis quelques années, l’attention se centre beaucoup plus sur les images fixes, la photographie et sur les images cinématographiques, les documentaires. Il y a quelque 100000 photographies qui gisent dans les archives militaires françaises au Fort d’Ivry. Il y a de même les photos prises par les appelés. Enfin, il y a les images de l’INA (Institut national de l’audiovisuel). La célèbre émission documentaire «Cinq colonnes à la une» de la télévision traitera de la guerre d’Algérie en 1959. A cela s’ajoutent les archives du cinéma de fiction.
Aux premières origines de la guerre
Cinquante ans après le déclenchement de la guerre en novembre 1954, la première question qu’on peut se poser, c’est comment appeler cette guerre, comment la nommer. On sait que pendant très longtemps elle n’a pas été nommée en France. L’Algérie était considérée comme composée de départements français. Il était difficile de dire qu’il y avait une guerre en Algérie puisque l’Algérie appartenait à la France, une France une et indivisible, une France jacobine. Admettre le principe de la guerre, c’était admettre le principe de la séparation, de la dislocation du territoire national. C’était impensable, c’était quelque chose qui ne pouvait pas se concevoir puisque l’Algérie avait été rattachée à la France avant même la Savoie, qui l’avait été en 1860. Dire qu’il y avait une guerre en Algérie aurait signifié reconnaître qu’il y avait une nation séparée, une nation différente de la nation française. Cela était impensable à cette époque. Il était facile de reconnaître le droit à l’indépendance pour d’autres colonies, comme le Maroc, la Tunisie, l’Indochine, le Sénégal.

Messali Hadj, le père fondateur du nationalisme politique radical algérien
C’est pour cette raison que pendant longtemps on a parlé d’une sorte de rétablissement de l’ordre républicain, «d’opération de police», «de rétablissement de l’ordre», «d’événements». Et tous ceux qui étaient opposés étaient considérés et qualifiés comme des «rebelles», des «hors-la-loi». Il était impossible d’envisager, durant très longtemps, l’existence même d’une guerre. On ne pouvait pas parler d’une guerre en Algérie, car il en découlait que l’Algérie aurait été un territoire séparé de la France. On a trouvé une sorte de compromis avec la formule: «la guerre d’Algérie», avec un d apostrophe. D’ailleurs, le premier livre qui a traité ce thème de cette façon, c’est celui de Jules Roy, paru en 1960 et qui avait pour titre La guerre d’Algérie, aux Editions Julliard. Puis, il a fallu attendre juin 1979 pour que la France, dans le cadre de l’Assemblée nationale, reconnaisse qu’il y avait bien eu une guerre en Algérie et non pas des opérations de police. L’initiative est venue tout d’abord d’associations d’anciens combattants français et cela pour une raison: la majorité des membres de ces associations arrivaient à l’âge de la retraite et il leur fallait une reconnaissance de leur droit à la carte d’ancien combattant [qui implique le versement d’une pension]. Donc la reconnaissance officielle de l’existence d’une guerre en Algérie est liée à ce fait: des anciens combattants revendiquaient des droits sociaux, le droit à la retraite.
Comment on qualifie cette guerre en Algérie
En Algérie, elle est qualifiée de guerre de libération nationale. Et cela puisque l’on considérait que l’Algérie était déjà une nation formée, avant l’arrivée des Français en 1830. Il s’agissait donc de se libérer d’une occupation étrangère et de se réapproprier cette souveraineté perdue par l’arrivée française en 1830.
Les choses, au plan historique, ne sont pas aussi simples, car l’Algérie d’aujourd’hui et de 1954 n’était pas l’Algérie de 1830. Ce fut le colonisateur qui dessina les frontières de l’Algérie, par rapport au Maroc, à la Tunisie et les frontières sahariennes. L’Algérie était en 1830 «membre» de l’Empire ottoman. Elle avait des attributs de souveraineté avec le bey [souverain vassal du sultan ou haut fonctionnaire dans l’Empire ottoman ; le terme de day est aussi utilisé, surtout pour l’Algérie] de Constantine, le bey d’Alger, avec des ambassadeurs qui représentaient des puissances étrangères à Alger et dans d’autres villes. D’ailleurs, la France, lors de la Révolution française, avait demandé de l’argent au day [chef de la Régence] d’Alger et celui-ci avait subventionné la Révolution en 1791-1792 et ce qui avait provoqué un conflit, car le day d’Alger exigeait le remboursement de cette somme et devant la lenteur de la France, il y a eu ce fameux coup d’éventail en 1827 donné au représentant de la France à Alger Deval. Cette agression avait été utilisée comme prétexte pour engager l’opération de débarquement et de conquête militaire d’Algérie en 1830.
A côté de l’expression guerre de libération nationale apparaît aussi celle de révolution algérienne. Car cette guerre a mis en mouvement l’ensemble de la société algérienne. En dehors des déplacements de populations, des migrations indiquées précédemment, il y a eu aussi l’entrée dans l’activité politique d’une partie des femmes et une sorte d’implosion de la société patriarcale. Plus exactement, cette société a subi une crise profonde et des révoltes de générations. Ce sont les jeunes générations qui se sont le plus engagées contre la société coloniale dont ils ne voulaient plus et qui se sont mis au premier rang de cette lutte révolutionnaire.
Ce terme de révolution a été progressivement délaissé au cours des années fin 1970 et 1980 au profit de celui de guerre d’indépendance, qui domine aujourd’hui le vocabulaire politique algérien. Cela renvoie au fait que l’Algérie, par ce combat politique, a en quelque sorte engendré la nation algérienne et s’est séparée de sa métropole coloniale. C’est ce terme-là, issu de la Révolution américaine contre les Britanniques, qui progressivement s’impose comme une réalité historique.
1954: en fait, commence la deuxième guerre d’Algérie
Sur la longue durée, on pourrait parler de deuxième guerre d’Algérie. En effet, la première guerre ne serait-elle pas celle de conquête menée par la France, une terrible guerre de conquête entre 1832 et 1871, avec la résistance de l’émir Abdel Kader entre 1832 et 1847, date de sa reddition, puis sa continuation au travers d’une guerre de résistance, de mouvement, qui fut très importante. Les Algériens n’ont pas accepté facilement la colonisation française. La guerre coloniale dirigée par le maréchal de France Bugeaud, gouverneur d’Algérie entre 1840 et 1847, a été impitoyable, elle a tout détruit sur son passage. Des récits ont été écrits sur cette guerre, parmi lesquels celui de François Maspero, L’honneur perdu de Saint-Arnaud (Seuil, février 2000), celui de Aschraf, historien algérien, Algérie, nation et société, qui a raconté cette première guerre d’Algérie, avec par exemple la terrible bataille de Constantine qui a duré plusieurs mois avant que la ville ne tombe. Il s’agit donc guerre d’Algérie avec le grand soulèvement de Kabylie de 1871. Ce fut le dernier grand soulèvement. La guerre de conquête a donc duré près d’une trentaine d’années et cela pour que la France puisse s’installer en Algérie.
C’est à partir de ce moment-là que commence ce qui sera qualifié d’histoire de l’Algérie française, avec l’installation d’une vaste colonie de peuplement ne venant pas que de France mais du pourtour méditerranéen, de l’Italie, de l’Espagne… Cette histoire de l’Algérie française va faire oublier la première guerre d’Algérie, lorsque la seconde va éclater en novembre 1954.
L’Algérie française va se mettre en place, par étapes entre des années 1850 aux années 1880. Elle va s’établir sur la base de la spoliation des terres. Beaucoup de terres vont changer de mains. Ces terres étaient pour l’essentiel fondées sur une sorte de propriété collective, soit les biens religieux, soit les terres appartenant aux tribus. Elles vont être privatisées et mises sur le marché. Cela va provoquer un appauvrissement de la paysannerie algérienne, même si une fraction de cette paysannerie va composer avec l’administration coloniale. Cette dernière va construire ce que l’on appellera une « aristocratie terrienne algérienne musulmane » qui est et sera proche des Français.
Indépendamment de cette question de la terre – qui est fondamentale car l’identité, le nom des composantes de cette société était liée à ce type de propriété de la terre et perdre la terre revenait à perdre son nom – on ne peut pas comprendre cette Algérie française prendre en compte la colonie de peuplement. Il y a parmi ceux qui viennent de France des républicains de 1848, des communards de 1871, des militants socialistes qui sont chassés, bannis de France, et aussi tout un « petit peuple » de vagabonds, de prostituées conduit de manière plus ou moins forcée en Algérie. Mais à côté, il y avait aussi des paysans paupérisés du Midi de la France et de la Corse. Et, surtout, il y avait toute une population chassée par la misère du pourtour méditerranéen, des Espagnols en particulier qui vont s’établir dans l’Oranie [ville d’Oran]. Et Oran deviendra une grande ville espagnole. Des Italiens, des Siciliens, des Maltais qui s’installeront, par exemple, dans l’est algérien. Tous ces éléments au travers d’un « melting pot » complexe vont constituer cette petite population européenne faite de fonctionnaires, de coiffeurs, de boutiquiers, d’artisans; une population dont le niveau de vie était inférieur à celui existant dans la métropole. Mais elle avait en quelque sorte un avantage: ils possédaient la nationalité française par rapport aux Algériens musulmans qui, eux, en étaient privés. A ces nouveaux Français venus d’Espagne et d’Italie, faits Français par un décret loi de 1889, s’ajoutaient les membres de la communauté juive faits Français par le décret du 24 octobre 1870, dit décret Crémieux [Crémieux a été ministre de la Justice en 1848 et en 1870].
Cette population européenne était organisée, pourrait-on dire, sur un mode pyramidal. Au sommet, il y avait les « Français de France », puis en dessous les nouveaux Français venus d’Espagne ou d’Italie; puis il y avait les nouveaux Français indigènes, c’est-à-dire les juifs d’Algérie; puis, au bas de cette hiérarchie savamment organisée, il y avait les musulmans qui, pour accéder à la nationalité française, devaient renoncer à leur statut personnel, c’est-à-dire à l’Islam et la religion musulmane. Cela était plus que difficile à vivre, ce ne sont que quelques milliers d’Algériens musulmans qui ont franchi le pas.
On assiste à la mise en place de cette Algérie française où règnent à la fois une sorte de passage, de « convivialité », entre ces diverses communautés et une très forte ségrégation. Progressivement, l’Algérie deviendra un mythe. Ce n’est pas la France, puisque la majorité de la population n’a pas les mêmes droits que certains, donc l’Algérie intégrée à la France ne l’est pas complètement. Les Algériens musulmans sont des faux citoyens d’une république assimilationniste. Ce paradoxe va être levé par l’irruption du nationalisme algérien qui va revendiquer en propre la nationalité algérienne.
L’irruption nationaliste massive de 1945 et ses racines
Cela va s’exprimer notamment lors des manifestations de Sétif et de Guelma en mai-juin 1945, c’est une irruption des Algériens sur le devant de la scène politique. Ils réclament la libération de leur leader politique Messali Hadj. La répression massive par les forces militaires et policières françaises de Sétif et Guelma, qui a fait des milliers et des milliers de victimes, marque véritablement le début de la seconde guerre en Algérie.
L’explosion de Sétif montre l’existence d’un nationalisme algérien. Pour comprendre les origines de la guerre d’Algérie, il faut remonter à celle du nationalisme algérien pour en comprendre la ligne de force.
Avant la guerre de 1914, la résistance algérienne s’exprimait au travers d’une sorte de « patriotisme rural », « patriotisme paysan » qui résistait à l’accaparement des terres, à la spoliation. C’est ce « patriotisme rural », qui n’était pas encore le nationalisme politique, qui s’exprime par exemple par un attachement à l’Empire ottoman. Il y avait une attente du Mahadi [le Messie] qui viendra, un jour, libérer la population de la domination étrangère. Une attention très grande est de même portée aux événements se déroulant dans le monde arabe et musulman. L’information passait par le biais des pèlerinages à La Mecque, par la circulation de différents ouvrages, par la présence de prédicateurs en provenance du Moyen-Orient. Le nationalisme algérien, dans sa version classique, moderne, n’existe pas avant 1914.
Il faudra l’impulsion donnée par la Première Guerre mondiale pour qu’arrivent en Algérie les influences qui vont participer à la construction du nationalisme algérien. Pourquoi la guerre du 1914? C’est pendant cette guerre que des dizaines de milliers de paysans algériens sont projetés sur les champs de bataille européens. Ils vont découvrir l’Europe. Ils vont être des soldats coloniaux, ils vont être des travailleurs coloniaux. Certains d’entre eux vont faire l’apprentissage de la solidarité ouvrière, découvrir l’internationalisme, découvrir les luttes sociales… Lorsqu’ils reviendront dans leur pays, leur conscience politique est grande, elle est vive. L’exemple de soldat de cette guerre de 14-18 est la figure, le personne de Messali Hadj. Lorsqu’il revient à Tlemcen après cette guerre, il ne pense plus qu’à une chose: d’une part, repartir en France et, d’autre part, de libérer son pays. En 1918-19, il a entendu parler de l’appel du président Wilson [Thomas Woodrow Wilson, élu président des Etats-Unis en 1912 et réélu en 1916] portant sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Messali Hadj a aussi entendu les appels lancés par les révolutionnaires russes en 1917 et par la suite à l’adresse des peuples colonisés et cela est fort important pour lui. Il a de même eu connaissance de la révolution kémaliste [Mustafa Kemal Atatürk, né en Salonique en 1881, mort à Istanbul en 1938, il prend la tête du mouvement national turc et sera président du comité exécutif de la Grande Assemblée nationale d’Ankara dès avril 1920] en Turquie. De retour à Tlemcen, nourri de ces « bruits », Messali Hadj sera très réceptif à la volonté qui commence à s’exprimer de se libérer de la présence étrangère, du joug colonial. La guerre de 14-18 a été un événement déterminant dans la prise de conscience politique d’un certain nombre de figures et militants du nationalisme politique algérien.
Ce nationalisme algérien va prendre son envol dans les années 1920-1930 et s’exprimer au travers de divers courants. On y trouve le petit-fils d’Abel Kader, on y trouve Messali Hadj, qui représente l’aile gauche, on y trouve Ferhat Abbas ou des représentants du mouvement des oulémas, réformistes religieux algériens. Parmi ces courants, tous ne préconisaient pas l’indépendance de l’Algérie, du moins dans un premier temps. La plupart des courants, à l’exception de celui de Messali Hadj, étaient des courants qui, sur le territoire algérien, proposaient l’égalité des droits. Dans le fond, ils disaient: « Nous n’avons pas la possibilité de pénétrer dans la société française, dans la citoyenneté française. » Le personnage le plus connu en ce domaine est celui de Ferhat Abbas. Il croyait en une France idéale, républicaine. Il voulait opposer cette France à la France coloniale qui ne respectait pas les droits de l’homme et du citoyen. Il appartenait à l’époque à ce courant assimilationniste qui revendiquait la pleine égalité des droits. Ferhat Abbas expliquait dans son ouvrage paru en 1931 qu’il était possible d’être français et musulman à part entière. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, il va plaider pour entrer dans cette cité française. Il sera un grand déçu de la politique française et basculera ensuite dans des positions plus radicales.
Il y avait aussi les religieux qui vont préconiser la réappropriation des traditions religieuses et identitaires avec leurs slogans: « L’arabe est ma langue, l’islam est ma religion, l’Algérie est ma patrie ». Ils vont s’implanter dans les campagnes, entre autres à travers de jeunes « scouts » algériens musulmans. Ils plaident pour un islam centralisé [où la confrérie des oulémas centralise l’activité politico-religieuse].
Il existe aussi le courant du Parti communiste algérien. Généralement on en parle peu. Ils voulaient construire une « Algérie nouvelle », une Algérie « dans le creuset de vingt races » pour reprendre la formule du dirigeant du PCF (Parti communiste français), Maurice Thorez. Autrement dit, une Algérie où pouvaient coexister les Algériens musulmans, les Français d’origine italienne ou espagnole, etc. Ce courant était pour une Algérie séparée, une « Algérie nouvelle », sans être indépendantiste officiellement.
Dans l’entre-deux-guerre, parmi ces courants, un courant va devenir lentement majoritaire, celui porté par Messali Hadj. Il va créer en 1926 l’Etoile nord-africaine, à Paris. Cette Etoile nord-africaine est dissoute par les autorités françaises en 1929 et elle resurgit en 1932. Messali créera plus tard en 1937 le Parti du peuple algérien, puis le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) en 1946. La majorité des militants qui vont faire le 1er novembre 1954 sont issus de ce courant, au fond tous sont issus du courant animé par Messali. Ce sont des hommes qui ont été formés par lui. A un moment ou à un autre de leur vie, ils ont pu rompre avec Messali. Mais celui-ci reste le père du mouvement nationaliste radical algérien. Et c’est en cela que l’étude de ce courant est importante. Il donnera la configuration politique du Front de libération nationale (FLN) qui conduira la lutte d’indépendance entre 1954 et 1962. Le courant messaliste était majoritaire dans la société algérienne musulmane et dans l’immigration algérienne en France.
L’importance du courant messaliste
Ce courant dans les milieux de l’immigration en France entre 1926 et 1930. En Algérie, étant donné la situation coloniale, il était très difficile de pouvoir s’exprimer. Les premiers immigrés algériens en France, qui sont au nombre de 80 000 à 100 000 dans l’entre-deux-guerres, vont prendre conscience, dans leur exil, d’une appartenance commune, à une nation. L’Etoile nord-africaine, qui avait été construite dans un premier temps avec l’aide du Parti communiste français – et qui va se séparer par la suite du PC –, va surtout exister dans les milieux de l’immigration ouvrière. Cette organisation emprunte beaucoup au vocabulaire du communisme de l’époque et à son mode d’organisation politique. L’Etoile préconise « l’appropriation collective des terres », la « confiscation des grandes propriétés ». La structure organisationnelle inclut des cellules, comité central, une direction centrale. Mais les nationalistes algériens ne sont pas d’accord avec les communistes, dans les années 1930 ils se sont séparés et se sont affrontés aux communistes français. Par contre, ils se sont rapprochés, ce qui est fort peu connu, d’autres courants militants, les syndicalistes révolutionnaires, anachistes et le courant trotskiste. Ce sont parmi ces courants politiques en France qu’on trouvera les meilleurs amis du nationalisme politique algérien. On peut citer Fred Zeller, Marceau Pivert [un des animateurs de la gauche socialiste dans les années 1930], Daniel Guérin [un des représentants du courant marxiste libertaire, auteur entre autres d’une anthologie sur l’anarchisme et d’un ouvrage de référence Fascismes et grand capital]. Ces derniers vont connaître Messali, ils vont être très proches des militants algériens. C’est ce que j’ai essayé de restituer dans un petit ouvrage intitulé Révolutionnaires français et nationalistes algériens,où se détachent bien quels ont été les premiers « porteurs de valises » [allusion à celles et ceux qui, de France ou de Suisse ou de Belgique, aidèrent le FLN entre 1954 et 1962]. Ce sont des militants qui appartenaient au courant socialiste, au socialisme révolutionnaire.
En 1937 naît le Parti du peuple algérien (PPA) sous la houlette de Messali Hadj. Le changement: il s’installe en Algérie. Le centre de gravité de la lutte politique se déplace en passant de la France, de l’immigration à l’Algérie. C’est désormais sur le sol algérien même que la lutte nationaliste va prendre de l’ampleur, notamment parmi les jeunes générations. Toutefois, le PPA n’aura pas le temps d’exister véritablement car interviendra la Seconde Guerre mondiale en 1939. Messali Hadj va être arrêté, traduit devant un Tribunal militaire. Il refuse toute collaboration avec le régime du maréchal Pétain et il sera condamné à une peine de bagne par le régime de Vichy. Au cours de la Seconde Guerre mondiale aura de la peine à exister. Certes, d’autres dirigeants du PPA, à la différence de Messali, ont eu la tentation de la collaboration avec Vichy [les forces de la France libre ayant leurs quartiers en Algérie]. Cette position de Messali lui a permis de sortir de la Seconde Guerre mondiale la tête haute et d’avancer ses exigences d’indépendance. En 1943, il rencontre Ferhat Abbas. Ce dernier évolue et change de position. Les deux hommes vont créer une nouvelle organisation qui s’appelle les Amis du manifeste de la liberté (AML) qui va connaître une croissance foudroyante dès 1944. Les AML comptaient quelque 100000 adhérents, ce qui est une force considérable. Cela traduit la radicalité nationaliste de la société algérienne musulmane. Les AML représentent la dernière grande tentative unitaire des différents courants existant dans le mouvement nationaliste politique algérien. Ce sont les AML qui organiseront les manifestations de Sétif en mai-juin 1945. Ces manifestations se font à l’occasion des fêtes de célébration de la victoire en 1945. Les Algériens descendent dans la rue pour exiger la libération de leurs leaders emprisonnés. Ces manifestations s’affronteront à une véritable guerre de représailles. Et là tout bascule. C’est la tendance radicale du nationalisme algérien qui va s’affirmer comme la plus importante sur la scène politique algérienne.
Le tournant de 1945: vers la lutte armée
Après la répression dans l’est constantinois, plus rien n’est comme avant dans l’histoire de l’Algérie française. Un fleuve de sang sépare les Algériens musulmans des Européens. Toutefois, l’élément central est l’arrivée sur la scène politique d’une nouvelle génération. C’est une génération qui ne veut plus entendre parler de compromis politique. Elle veut rompre avec les modalités traditionnelles: manifestations, tracts, etc. La nouvelle génération politique qui arrive veut faire de la lutte armée d’indépendance un principe. En 1946-47, de plus en plus de jeunes se tournent vers la formation la plus radicale: le PPA, animé par Messali Hadj. Et ils rejoignent cette organisation dans la perspective d’une lutte armée. Messali, qui vient d’être libéré en 1946, doit tenir compte à la fois de l’impatience de ces jeunes militants et des options de la nouvelle administration française issue de la Libération qui se remet en place. Messali essaie de composer. Pour cela, il conçoit deux organisations. La première, baptisée Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), est une sorte de vitrine politique légale classique. Elle se bat pour l’obtention de libertés démocratiques en Algérie, pour les « indigènes musulmans algériens », pour l’amélioration de leurs conditions sociales. La seconde: dès 1947, se forme une organisation clandestine, que Messali ne désavoue pas. Elle porte le nom d’Organisation spéciale (OS). C’est une branche armée du mouvement indépendantiste algérien qui est dirigée par deux personnalités importantes: tout d’abord par Hocin Aït Ahmed, puis par Ahmed Ben Bella. Ils seront les deux leaders de cette organisation clandestine. De 1947 à 1950, cette organisation va préparer un millier de militants au sabotage, à la lutte armée. Elle prépare la formation de maquis. Donc, une branche paramilitaire prend consistance dans le nationalisme politique algérien. L’OS est séparée du MTLD.
Le MTLD connaît un succès électoral au « second collège ». Il faut savoir que l’Algérie française qui se met en place après 1945 est une Algérie qui n’a pas tiré les leçons des effets de Sétif et Guelma. C’est une Algérie qui n’avance pas vers des réformes profondes. A partir du Statut de 1947, il y a la mise en place du double collège: le collège réservé aux Européens (le premier) et le second collège réservé aux indigènes musulmans. Dans l’Algérie coloniale s’avère ainsi l’impossibilité de la mise en place d’un système égalitaire, d’une citoyenneté égalitaire. Il faut 8 fois plus de voix pour élire un député au second collège qu’un député européen.
La victoire du MTLD au second collège en octobre 1947 traduit l’adhésion massive des habitants des principales villes aux thèses du MTLD. La plupart des candidats nationalistes battent les candidats de l’administration, appelés les béni-oui-oui.
Les Européens d’Algérie auraient pu s’inquiéter de cette poussée du MTLD. Non seulement on y a pas prêté attention, mais en 1948 les élections seront grossièrement truquées. Les candidats indépendantistes seront simplement arrêtés; et seuls les candidats de l’administration seront élus. Depuis cette époque, l’Algérie n’aura plus d’élections régulières, même selon le Statut de 1947.
C’est ce qui va encourager le courant radical qui fait face aux injustices, aux inégalités juridiques, à l’aggravation des conditions sociales. Messali et Ferhat Abbas vont se retrouver progressivement dépassés par cette nouvelle génération. C’est une génération qui est en syntonie avec le processus montant de décolonisation. Elle avait connaissance de la terrible répression de Madagascar de 1947-48 par la même administration et armée françaises. Elle a face à elle la guerre d’Indochine qui se terminera par la défaite française de Dien-Bien-Phu en 1954. Il y a aussi des craquements au Maroc et en Tunisie, sans mentionner les processus à l’oeuvre dans l’empire britannique. Les paysans, en Tunisie, en 1952-53, résistent de façon armée. On les appelle les fellaghas. Un terme qui sera repris pour qualifier les combattants algériens.
Dans ce climat, ceux qui préconisent le compromis, l’attente sont perçus comme des hommes de la résignation, c’est-à-dire ceux qui ne veulent pas briser le statu quo colonial. Ceux qui prennent le dessus sont ceux qui préconisent – et dès 1949 la victoire de la révolution chinoise a un grand écho – une radicalisation politico-militaire de la lutte, se préparent à la mener. Cette préparation se fera dans des conditions extrêmement difficiles. Elle impliquera des ruptures politiques, des tendances et elle va déboucher sur le « soulèvement » du 1er novembre 1954, date officielle du déclenchement de la guerre d’Algérie.
Benjamin Stora Alencontre 14 - mars - 2012
http://alencontre.org/europe/france/aux-origines-de-la-guerre-dalgerie.html