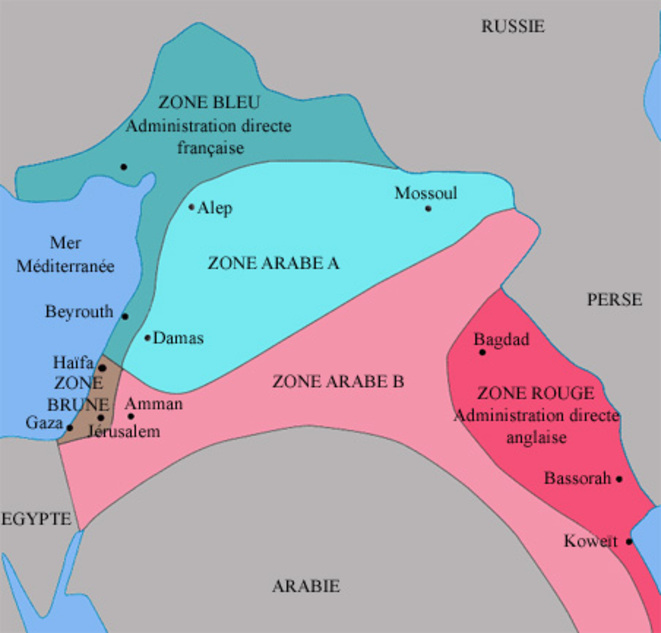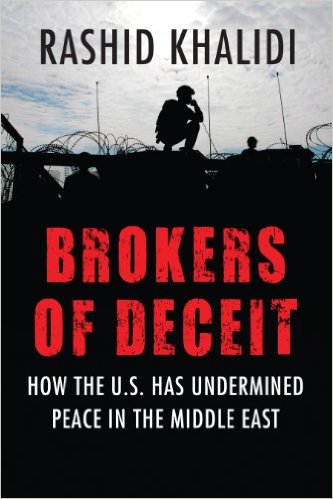Théorie - Page 8
-
L'idée de terre promise n'existe pas dans l'histoire du judaïsme » Politis
-
Histoire : la dette comme instrument de la conquête coloniale de l’Égypte (Essf)
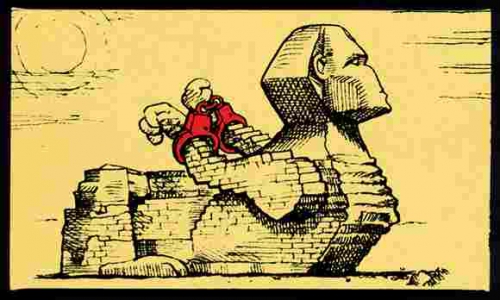
Je dédie cet article à la mémoire de Youssef Darwish (en arabe : يوسف درويش) 1910 - 2006, militant égyptien qui a combattu inlassablement pour la justice et l’internationalisme. Plusieurs fois mis en prison et torturé pour son engagement communiste et pour son combat pour les droits humains (il était juriste), il a poursuivi la lutte jusque la fin de ses jours [1]. En 2005, un peu avant sa mort, il avait pris contact avec le CADTM international car il souhaitait créer un CADTM égyptien.
Succès puis abandon de la tentative de développement autonome de l’Égypte
L’Égypte, bien qu’encore sous tutelle ottomane, entame au cours de la première moitié du XIXe siècle un vaste effort d’industrialisation [2] et de modernisation. George Corm résume l’enjeu de la manière suivante : « C’est évidemment en Égypte que Mohammed Ali fera l’œuvre la plus marquante en créant des manufactures d’État, jetant ainsi les bases d’un capitalisme d’État qui ne manque pas de rappeler l’expérience japonaise du Meiji » [3]. Cet effort d’industrialisation de l’Égypte s’accomplit tout au long de la première moitié du XIXe siècle sans recours à l’endettement extérieur ; ce sont les ressources internes qui sont mobilisées. En 1839-1840, une intervention militaire conjointe de la Grande Bretagne et de la France, suivie un peu plus tard d’une seconde agression réalisée cette fois par la Grande-Bretagne et l’Autriche obligent Mohammed Ali à renoncer au contrôle de la Syrie et de la Palestine, que ces puissances considèrent comme des chasses gardées. (voir plus bas la carte de l’extension de l’Égypte sous Mohamed Ali)

Un tournant radical est pris à partir de la seconde moitié du siècle. Les successeurs de Mohammed Ali adoptent le libre-échange sous la pression du Royaume-Uni, démantèlent des monopoles d’État et recourent massivement aux emprunts extérieurs. C’est le début de la fin. L’ère des dettes égyptiennes commence : les infrastructures de l’Égypte seront abandonnées aux puissances occidentales, aux banquiers européens et aux entrepreneurs peu scrupuleux.
Les banquiers européens veulent prêter massivement hors de l’Europe occidentale
Entre les années 1850 et 1876, les banquiers de Londres, de Paris et d’autres places financières cherchaient activement à placer des sommes considérables d’argent tant en Égypte que dans l’Empire ottoman et dans d’autres continents (en Europe avec l’Empire russe, en Asie dont la Chine en particulier, en Amérique latine) [4]. Plusieurs banques sont créées en Europe afin de canaliser les mouvements financiers entre l’Égypte et les places financières européennes : l’Anglo-Egyptian Bank (fondée en 1864), la Banque franco-égyptienne (fondée en 1870 et dirigée par le frère de Jules Ferry, important membre du gouvernement français) et la Banque austro-égyptienne (créée en 1869). Cette dernière avait été fondée sous les auspices du Kredit Anstalt où les Rothschild de Vienne avaient leurs intérêts. Les grandes banques de Londres étaient aussi particulièrement actives. Les banquiers londoniens se spécialisèrent dans les prêts à long terme et les banquiers français dans les prêts à court terme, plus rémunérateurs, surtout à partir de 1873 quand une crise bancaire a affecté Londres et Vienne.

Réussite apparente et éphémère du développement économique de l’Égypte basé sur l’endettement et le libre-échange
Dans un premier temps, le nouveau modèle fondé sur l’endettement et le libre-échange semblait très bien fonctionner, mais, en réalité, cet apparent succès tenait à des événements extérieurs que ne maîtrisaient aucunement les autorités égyptiennes. En effet, l’Égypte a temporairement tiré profit du conflit entre les États sudistes et les nordistes en Amérique du Nord. La guerre de sécession (1861-1865) de l’autre côté de l’Atlantique provoqua une chute des exportations de coton que réalisaient les États sudistes. Cela fit monter très fortement le prix du coton sur le marché mondial. Les revenus d’exportation de l’Égypte, productrice de coton, explosèrent. Cela amena le gouvernement d’Ismaïl Pacha à accepter encore plus de prêts des banques (britanniques et françaises principalement). Lorsque la guerre de sécession prit fin, les exportations sudistes reprirent et le cours du coton s’effondra. L’Égypte dépendait des devises que lui procurait la vente du coton sur le marché mondial (principalement à l’industrie textile britannique) pour effectuer le remboursement de la dette aux banquiers européens. La diminution des recettes d’exportation créa les premières difficultés de remboursement de la dette égyptienne.
Cela n’empêcha pas les banquiers, en particulier les banquiers anglais, d’organiser l’émission d’emprunts égyptiens à long terme (20 à 30 ans) et les banquiers français d’octroyer de nouveaux crédits, à court terme principalement, car ils donnaient droit à des taux d’intérêts très élevés. L’historien Jean Bouvier décrit cet engouement : « Des organismes de crédit - Banque de Paris et des Pays-Bas, Crédit Lyonnais, Société Générale, Comptoir d’Escompte de Paris, Crédit Foncier – qui avaient jusque-là participé aux “avances” et “emprunts” d’Égypte un peu au hasard des affaires, se mirent à rechercher systématiquement de tels placements et à prospecter les opérations gouvernementales des pays sous-développés. Lorsqu’en avril 1872, le Crédit Lyonnais s’attend à participer, aux côtés des Oppenheim, à une “avance” égyptienne – bons à dix-huit mois, pour 5 millions de livres sterling, à 14 % l’an – son directeur Mazerat confie à un correspondant : “On espère, au moyen de cette grosse avance, mettre la main sur l’emprunt qui doit être émis l’année prochaine.” [5] »
La dette égyptienne atteint un niveau insoutenable
En 1876, la dette égyptienne atteignait 68,5 millions de livres sterling (contre 3 millions en 1863). En moins de 15 ans, les dettes extérieures avaient été multipliées par 23 alors que les revenus augmentaient de 5 fois seulement. Le service de la dette absorbait les deux tiers des revenus de l’État et la moitié des revenus d’exportation.
Les montants empruntés qui sont parvenus réellement à l’Égypte restent très faibles tandis que les montants que les banquiers exigeaient et recevaient en retour étaient très élevés.
Prenons l’emprunt de 1862 : les banquiers européens émettent des titres égyptiens pour une valeur nominale de 3,3 millions de livres sterling, mais ils les ont vendus à 83 % de leur valeur nominale, ce qui fait que l’Égypte ne reçoit que 2,5 millions de livres dont il faut encore déduire la commission prélevée par les banquiers. Le montant que doit rembourser l’Égypte en 30 ans s’élève à près de 8 millions de livres si on prend en compte l’amortissement du capital et le paiement des intérêts.
Autre exemple, l’emprunt de 1873 : les banquiers européens émettent des titres égyptiens pour une valeur nominale de 32 millions de livres et ils les vendent avec un rabais de 30 %. En conséquence, l’Égypte ne reçoit qu’un peu moins de 20 millions de livres. Le montant à rembourser en 30 ans s’élève à 77 millions de livres (intérêt réel de 11 % + amortissement du capital).
On comprend aisément que cet accroissement de la dette et les taux d’intérêts exigés sont intenables. Les conditions financières qui sont imposées par les banquiers rendent insoutenable le remboursement. L’Égypte doit constamment emprunter afin d’être en mesure de poursuivre les paiements dus sur les anciennes dettes.
Sous pression des créanciers, le souverain Ismail Pacha, khédive [6] d’Égypte se met à vendre à partir des années 1870 des infrastructures et à accorder diverses concessions afin d’obtenir des liquidités pour payer la dette. Il doit aussi régulièrement augmenter les impôts pour les mêmes raisons.
Après une petite quinzaine d’années d’endettement externe (1862-1875), la souveraineté égyptienne est aliénée.En 1875, pris à la gorge par les créanciers, l’État égyptien cède au gouvernement du Royaume-Uni ses parts dans la Compagnie du Canal de Suez qui avait été inauguré en 1869 [7]. Le produit de la vente des 176 602 actions Suez que détenait l’Égypte – soit près de la moitié du capital de la Compagnie de Suez – au gouvernement britannique à la fin de novembre 1875 est largement destiné à respecter les échéances de paiement de la dette de décembre 1875 et de janvier 1876 qui étaient particulièrement lourdes. Le gouvernement de Londres devient du même coup créancier direct de l’Égypte : les titres achetés ne permettant pas de toucher de dividendes avant 1894, le gouvernement égyptien s’engageait à payer à l’acheteur pendant cette période un intérêt de 5 % l’an sur les quelque cent millions de francs du prix d’achat.
Selon l’historien Jean Bouvier : « Le khédive disposait encore des chemins de fer « évalués à 300 millions », selon un administrateur du Crédit Lyonnais, et de son droit aux 15 % des bénéfices nets annuels de la Compagnie de Suez. Ayant réglé les échéances de fin d’année grâce aux 100 millions de la vente de ses actions, le khédive fait reconduire en janvier 1876 et début février les « avances » en cours fournies par l’Anglo-Egyptian et le Crédit Foncier, à trois mois, au taux de 14 % l’an. Il offre en garantie sa part de 15 % dans les tantièmes de Suez, les produits de l’octroi de la ville d’Alexandrie et les droits du port. La Société Générale participe à l’affaire, qui porte sur 25 millions de francs. »
En 1876 l’Égypte comme d’autres pays suspend le paiement de la dette
Finalement, malgré les efforts désespérés pour rembourser la dette, l’Égypte est amenée à suspendre le paiement de la dette en 1876. Il est important de souligner qu’au cours de cette même année 1876, d’autres États se sont déclarés en cessation de paiement, il s’agit de l’Empire ottoman, du Pérou (à l’époque, une des principales économies d’Amérique du Sud) et de l’Uruguay. Il faut donc chercher les causes sur le plan international. Une crise bancaire avait éclaté à New-York, à Francfort, Berlin et à Vienne en 1873 et avait progressivement affecté les banquiers de Londres. En conséquence, la volonté de prêter à des pays périphériques s’était fortement réduite, or ces pays avaient constamment besoin d’emprunter pour rembourser les anciennes dettes. De plus, la situation économique s’étant dégradée dans les pays du Nord, les exportations du Sud baissèrent, de même que les revenus d’exportation qui servaient à effectuer les remboursements. Cette crise économique internationale dont l’origine se trouve au Nord a largement provoqué la vague de suspensions de paiements. [8] Dans chaque cas particulier, il faut en plus distinguer certaines spécificités.
Dans le cas de l’Égypte, les banquiers français, moins affectés que les autres par la crise, avaient poursuivi les prêts à l’Égypte en profitant de la situation pour augmenter fortement les taux d’intérêts et en ne prêtant le plus souvent qu’à court terme. En 1876, ils ont accentué la pression sur l’Égypte et en resserrant l’accès au crédit, ont provoqué la suspension de paiement afin de forcer l’Égypte à accepter la création d’une Caisse de la dette contrôlée par le Royaume-Uni et la France. Ils ont réalisé cela en bonne entente avec les banquiers de Londres,
La création de la Caisse de la dette publique sous tutelle britannique et française
Les gouvernements de Londres et de Paris, bien que concurrents, se sont entendus pour soumettre l’Égypte à leur tutelle via la Caisse de la dette. Ils avaient procédé de la même manière dans les années 1840-1850 et à partir de 1898 à l’égard de la Grèce [9], en 1869 à l’égard de la Tunisie [10] et ils ont répété l’opération avec l’Empire ottoman à partir de 1881 [11]. En Grèce et en Tunisie, l’organisme qui a permis aux puissances créancières d’exercer leur tutelle a été nommé la Commission financière internationale ; dans l’Empire ottoman, il s’est agi de l’Administration de la Dette publique ottomane et, en Égypte, la Caisse de la Dette publique créée en 1876 a joué ce rôle [12].
La Caisse de la Dette publique a la mainmise sur une série de revenus de l’État et ce sont les représentants du Royaume-Uni et de la France qui la dirigent. La mise en place de cet organisme a été suivie d’une restructuration de la dette égyptienne, qui a satisfait tous les banquiers concernés car aucune réduction du stock n’a été accordée ; le taux d’intérêt a été fixé à un niveau élevé, 7 %, et les remboursements devaient durer 65 ans. Cela assurait une rente confortable garantie à la fois par la France, le Royaume-Uni et par les revenus de l’État égyptien dans lesquels la Caisse de la Dette publique pouvait puiser.
La priorité donnée à la satisfaction des intérêts des banquiers dans la résolution de la crise de la dette égyptienne de 1876 apparaît très clairement dans une lettre envoyée par Alphonse Mallet, banquier privé et régent de la Banque de France, à William Henry Waddington, ministre français des Affaires étrangères et futur président du Conseil des Ministres. Ce banquier écrit au ministre à la veille du Congrès de Berlin de 1878 au cours duquel va se discuter le sort de l’Empire ottoman (en particulier de ses possessions dans les Balkans et dans la Méditerranée) : « Mon cher ami, ... Si le Congrès se réunit, comme on l’espère, il suffit de combiner un mécanisme international... qui puisse exercer un contrôle efficace sur les agents administratifs du gouvernement, les tribunaux, l’encaissement des recettes et les dépenses. Ce qui a été fait en Égypte sous la pression des intérêts privés, en dehors de toute considération d’ordre public européen tant pour les tribunaux que pour le service de la dette... peut servir de point de départ. » (Lettre du 31 mai 1878. Mémoires et documents, Turquie, n° 119. Archives du Ministère des Affaires étrangères.) [13].
Les enjeux géostratégiques entre grandes puissances européennes
Si la mise en place de la Caisse de la Dette publique et la restructuration de la dette égyptienne qui a suivi satisfaisaient au premier chef les intérêts des banquiers, les intérêts des grandes puissances, dont provenaient les banquiers, étaient également directement en jeu. Le Royaume-Uni était de loin la première puissance européenne et mondiale. Elle considérait qu’elle devait contrôler et dominer entièrement la Méditerranée orientale qui gagnait en importance vu l’existence du Canal de Suez, qui donnait accès directement à la route maritime des Indes (qui faisait partie de son empire) et du reste de l’Asie. Le Royaume-Uni souhaitait marginaliser la France, qui exerçait une influence certaine en Égypte à cause des banques et du Canal de Suez dont la construction avait été financée via la bourse de Paris. Afin d’obtenir de la France qu’elle laisse entièrement la place au profit de l’Angleterre, il fallait primo satisfaire les intérêts des banquiers français (très liés aux autorités françaises, c’est le moins qu’on puisse dire) et secundo lui offrir une compensation dans une autre partie de la Méditerranée. C’est là qu’intervient un accord tacite entre Londres et Paris : l’Égypte reviendra au Royaume-Uni tandis que la Tunisie passera entièrement sous le contrôle de la France. En 1876-1878, le calendrier exact n’est pas encore fixé, mais la perspective est très claire. Il faut ajouter qu’en 1878 le Royaume-Uni a acheté l’île de Chypre à l’Empire ottoman. Chypre est un autre pion dans la domination britannique de la Méditerranée orientale.
L’avenir de la Tunisie et de l’Égypte ne se règle pas seulement entre la France et le Royaume-Uni. L’Allemagne, qui vient d’être unifiée et qui est la principale puissance européenne montante à côté du Royaume-Uni, a son mot à dire. Otto von Bismarck, le chancelier allemand, a été manifestement clair : il a déclaré à maintes reprises, lors de conversations diplomatiques secrètes, que l’Allemagne ne prendrait pas ombrage d’une prise de contrôle de l’Égypte par Londres et d’une prise de contrôle de la Tunisie par la France. En contrepartie, l’Allemagne voulait le champ libre dans d’autres parties du monde. Les dirigeants politiques français étaient d’ailleurs bien conscients des motivations de Bismarck. L’Allemagne avait imposé une défaite militaire humiliante à la France en 1870-1871 et lui avait ravi l’Alsace et la Lorraine. Bismarck, en « offrant » la Tunisie à la France, voulait détourner Paris de l’Alsace et de la Lorraine en lui offrant un prix de consolation. Une très large documentation est disponible à ce sujet.
En somme, le sort réservé à l’Égypte et à la Tunisie préfigure le grand partage de l’Afrique auquel les puissances européennes se livrèrent, quelques années plus tard, lors d’une autre conférence à Berlin tenue en 1885 [14].
L’occupation militaire de l’Égypte à partir de 1882 et sa transformation en protectorat
Dans le cas de l’Égypte et de la Tunisie, la dette a constitué l’arme la plus puissante utilisée par des puissances européennes pour assurer leur domination, en les menant jusqu’à la soumission totale d’États jusque-là indépendants.
Suite à la mise en place de la Caisse de la Dette publique, les banques françaises font le maximum pour obtenir toujours plus de remboursements et de profits en prenant de moins en moins de nouveaux engagements. À partir de 1881, les banques françaises renoncent à octroyer de nouveaux prêts à l’Égypte, elles se contentent d’engranger les remboursements des anciennes dettes restructurées. Quand en janvier 1882 une crise boursière éclate à Paris, les banques françaises ont d’autres préoccupations que l’Égypte.
La Caisse de la Dette publique impose à l’Égypte des mesures d’austérité très impopulaires qui génèrent une rébellion, y compris militaire (le général Ahmed Urabi défend des positions nationalistes et résiste aux diktats des puissances européennes). Le Royaume-Uni et la France prennent prétexte de la rébellion pour envoyer un corps expéditionnaire à Alexandrie en 1882. Finalement, la Grande-Bretagne entre en guerre contre l’armée égyptienne, occupe militairement de manière permanente le pays et le transforme en un protectorat. Sous domination britannique, le développement de l’Égypte sera largement bloqué et soumis aux intérêts de Londres. Comme l’écrivait Rosa Luxemburg en 1913 : « L’économie égyptienne a été engloutie dans une très large mesure par le capital européen. D’immenses étendues de terres, des forces de travail considérables et une masse de produits transférés à l’État sous forme d’impôts ont été finalement transformés en capital européen et accumulés. » [15]
La Caisse de la Dette publique ne sera supprimée qu’en juillet 1940 [16] (voir illustration ci-dessous). L’accord imposé à l’Égypte par le Royaume-Uni en 1940 prolonge la domination financière et coloniale car le Royaume-Uni obtient la poursuite des remboursements d’une dette qui est devenue permanente.
Il faudra le renversement de la monarchie égyptienne en 1952 par de jeunes militaires progressistes dirigés par Gamel Abdel Nasser et la nationalisation du Canal de Suez le 26 juillet 1956 pour que, pendant une période d’une quinzaine d’années, l’Égypte tente à nouveau un développement partiellement autonome [17].
Eric Toussaint
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article37998
Bibliographie
- Anderson, Perry. 1976. L’État absolutiste. Ses origines et ses voies, traduction française 1978, Paris : Maspero, 2 volumes, 203 p. et 409 p.
- BATOU, Jean. L’Égypte de Muhammad Ali. Pouvoir politique et développement économique, 1805-1848. Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 1991, 46ᵉ année, N°2. pp. 401-428, en ligne
- BOUVIER, Jean. 1960. Les intérêts financiers et la question d’Égypte (1875-1876), Revue Historique, 1960, T. 224, Fasc. 1, pp. 75-104.
- CORM, Georges. 1982. L’endettement des pays en voie de développement : origine et mécanisme in Sanchez Arnau, J.-C. coord. 1982. Dette et développement (mécanismes et conséquences de l’endettement du Tiers-monde), Editions Publisud, Paris
- DRIAULT, Edouard et LHÉRITIER, Michel. 1926. Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours, Paris : Presses universitaires de France (PUF), 5 tomes.
- Foreign Affairs, United Kingdom, Treaties. 1940. CONVENTION RELATIVE A L’ABOLITION DE LA CAISSE DE LA DETTE PUBLIQUE EGYPTIENNE. 17 July 1940. London.
- LUXEMBURG, Rosa, 1913, L’Accumulation du capital, Paris : Maspero, Vol. II, 1969.
- MANDEL, Ernest, 1972, Le Troisième âge du capitalisme, Paris : La Passion, 1997, 500 p.
- MARICHAL, Carlos, 1989, A Century of Debt Crises in Latin America, Princeton : Princeton University Press, 283 p.
- Ministère des affaires étrangères de la France. 1876. Décret d’institution de la caisse de la dette publique d’Égypte... et 6 autres décrets relatifs au Trésor et à la dette, Paris, 1876. 30 pages. consulté le 14 mai 2016
- Ministère des affaires étrangères de la France. 1898. Arrangement financier avec la Grèce : travaux de la Commission internationale chargée de la préparation du projet, Paris, 1898, 223 pages.
- REINHARDT, Carmen et ROGOFF, Kenneth, Cette fois, c’est différent. Huit siècles de folie financière, Paris, Pearson, 2010.
- REINHARDT, Carmen M., and SBRANCIA, M. Belen. 2015. The Liquidation of Government Debt. Economic Policy 30, no. 82 : p 291-333
- SACK, Alexander Nahum, 1927, Les effets des transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières, Recueil Sirey, Paris.
- THIVEAUD, Jean-Marie. Un marché en éruption : Alexandrie (1850-1880). Revue d’économie financière, 1994, n°30. Les marchés financiers émergents (II) sous la direction de Olivier Pastré. pp. 273-298.
- Toussaint, Éric. 2004. La Finance contre les peuples. La bourse ou la vie, CADTM-Bruxelles/CETIM-Genève/Syllepse-Paris, 640 p.
- TOUSSAINT, Éric. 2016. « La Grèce indépendante est née avec une dette odieuse »
- TOUSSAINT, Éric. 2016. « Grèce : La poursuite de l’esclavage pour dette de la fin du 19e siècle à la Seconde Guerre mondiale »
- Toussaint, Éric. 2006. Banque mondiale : le coup d’État permanent, Liège-Paris-Genève, CADTM-Syllepse-Cetim, 2006.
- WESSELING, Henri. 1996. Le partage de l’Afrique - 1880-1914, Paris, Denoël (Folio Histoire, 2002 ; 1re édition en néerlandais en 1991), 840 p.
Remerciements
L’auteur remercie pour leur relecture et leurs suggestions : Gilbert Achcar, Mokhtar Ben Afsa, Omar Aziki, Fathi Chamkhi, Alain Gresh, Gus Massiah, Claude Quémar, Patrick Saurin, Dominique Vidal.
L’auteur est entièrement responsable des éventuelles erreurs contenues dans ce travail.
http://cadtm.org/La-dette-comme-instrument-de-la
Lien permanent Catégories : Dette, austérité, Fmi, Documents, Economie, Egypte, Histoire, ThéorieOman 0 commentaire -
Nouveautés sur "Lutte Ouvrière"

-
Islamophobie et orientalisme inversé: Europe et Moyen-Orient

Certains courants de la gauche radicale peinent à articuler la lutte contre l’islamophobie en Europe avec le soutien aux luttes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.
Tandis que d’autres, traversés par le concept « orientaliste », promeuvent l’islam politique comme vecteur d’émancipation. Deux maux dont la gauche doit se défaire, selon Joseph Daher.
La lutte contre l’islamophobie en Europe et pour le changement radical des sociétés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord nécessite encore et toujours des débats au sein de la gauche radicale, car certains ont parfois du mal à combiner les deux objectifs pour différentes raisons, souvent d’ailleurs contradictoires. Dans la première partie de cet article, nous traiterons de la nécessité de la lutte contre l’islamophobie comme objectif central de la lutte pour une société plus égalitaire et plus juste, particulièrement en période de crise économique et de montée du racisme en Europe.
Dans la seconde partie, nous démontrerons que la lutte contre l’islamophobie ne doit en aucun cas laisser la place à un « orientalisme en retour ou inversé » qui traverse certains courants de gauche dans leur analyse du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.
L’islamophobie est tout d’abord le racisme envers la communauté musulmane, les citoyen-ne-s de confession musulmane, pratiquants ou non, simples croyants ou athées, mais portant un prénom musulman. L’islamophobie ne mesure pas la religiosité d’une personne. Elle connu une explosion en Occident après les attentats du 11 septembre 2001. Un nouvel ennemi avait été trouvé et les lois discriminantes à l’encontre des communautés musulmanes en Europe ont connu un boom.
Dans un rapport publié en 2012, intitulé Choix et préjugés - la discrimination à l’égard des musulmans en Europe, Amnesty International s’alarme du climat islamophobe.
De nombreux pays européens (France, Suisse, Autriche...) sont pointés du doigt pour leurs pratiques, encouragées par des partis politiques en quête de voix électorales, ajoute le rapport. Le rédacteur du rapport décrit par exemple le fait que « des femmes musulmanes se voient refuser des emplois et des jeunes filles sont empêchées d’aller en classe simplement parce qu’elles portent des vêtements traditionnels comme le foulard (...). Des hommes peuvent être licenciés pour porter des barbes associées à l’islam ».
La Suisse n’échappe pas à cette atmosphère islamophobe, dont le symbole reste la loi sur l’interdiction de construction de nouveaux minarets votée en 2009.
La gauche radicale, dans la résistance aux intérêts capitalistes qui veulent imposer des mesures d’austérités à travers l’Europe, via l’outil principal de la dette mais également via le racisme et l’islamophobie, ne peut se permettre de reléguer cette question. L’islamophobie, comme le racisme et le communautarisme, est un instrument des classes dirigeantes pour diviser les classes populaires et les détourner de leur réel ennemi : la classe bourgeoise.
Trostky affirmait que même si une démocratie complète est illusoire sous le système capitaliste, le mouvement révolutionnaire ne doit en aucune façon renoncer, même sous l’impérialisme, à la lutte pour les droits démocratiques.
Le combat contre l’islamophobie et le racisme en général et pour le droit à l’exercice de la liberté de conscience est fondamental dans la pensée marxiste.
Dans sa Critique du programme de Gotha du Parti Ouvrier Allemand (1875), Marx expliquait que la liberté privée en matière de croyance et de culte doit être définie uniquement comme rejet de l’ingérence étatique. Il en énonçait ainsi le principe : « Chacun doit pouvoir satisfaire ses besoins religieux et corporels, sans que la police y fourre le nez ». Ce même Marx a défendu l’obtention des droits civiques des juifs de Cologne en 1843 et déclarera que le privilège de la foi est un droit universel de l’homme. Le marxisme classique, celui des fondateurs, n’a d’ailleurs pas requis l’inscription de l’athéisme au programme des mouvements sociaux.
La question du voile ne concerne que les femmes, elles doivent décider par elles-mêmes et en toute indépendance de son port ou non. Le voile imposé ou retiré par la force est un acte réactionnaire et qui va à l’encontre de tout soutien à l’autodétermination des femmes.
Dans cette lutte contre l’islamophobie, nous nous opposons à ceux et celles qui, à gauche, rejettent toute unité d’action avec des groupes ayant une base ou se revendiquant de fondements religieux, en faisant appel à la fameuse phrase de Karl Marx selon laquelle la religion est « l’opium du peuple », sans faire référence à la suite du texte qui explique le réel sens à y donner.
Un certain nombre d’exemples historiques démontrent l’erreur de ce positionnement.
La gauche radicale a collaboré et lutté côte à côte avec les adeptes de la théologie de la libération, qui avaient développé une critique radicale du capitalisme contre les dictatures d’Amérique du Sud. Le parti bolchevique n’hésitait pas à coordonner des luttes avec le Bund, union générale des travailleurs juifs de Pologne, de Lituanie et de Russie, fondée en 1897, qui, malgré son orientation athéiste, anticléricale et fondamentalement socialiste, était basée sur un regroupement communautaire.
Finalement Malcolm X qui, tout en restant fidèle à ses convictions religieuses, particulièrement à la fin de sa vie, évoluait à gauche. Il n’hésita pas à critiquer les dirigeants musulmans dans une interview en 1965, qu’il accusa d’avoir volontairement maintenu les peuples, et les femmes en particulier, dans l’ignorance. Il ajouta aussi que l’état d’avancement d’une société se mesure à la situation faites aux femmes, en déclarant que « plus les femmes sont éduquées et impliquées... plus le peuple entier est actif, lumineux et progressiste ».
L’intervention des forces progressistes et révolutionnaires permet la radicalisation des mouvements de contestation populaire. Elle doit également empêcher toute dérive de confiscation « identitaire » des débats et des dynamiques politiques en inscrivant les luttes dans une perspective humaniste et universelle, sans laisser la place à une forme d’« orientalisme en retour » qui touche certains courants de gauche, en Occident comme au Moyen Orient.
L’« orientalisme en retour » est un concept développé par le marxiste syrien Sadiq Jalal al Azm, en 1980, face à ce qu’il considère comme une ligne révisionniste de la pensée politique arabe, qui a fait surface sous l’effet du processus révolutionnaire iranien après 1979.
La thèse centrale de ce courant, qui trouve à sa source un certain nombre d’intellectuels de gauche et nationalistes déçus, peut se résumer comme suit : « Le salut national tant recherché par les Arabes depuis l’occupation napoléonienne de l’Egypte ne se trouve ni dans le nationalisme laïc (qu’il soit radical, conservateur ou libéral), ni dans le communisme révolutionnaire, le socialisme ou autre, mais dans un retour à l’authenticité de ce qu’ils appellent l’islam politique populaire ».
Ainsi, les mouvements de l’Islam politique ont tendance à promouvoir l’idée que la libération et le développement des pays arabes dépendent en premier lieu de l’affirmation de leur identité islamique, qui serait « permanente » et « éternelle », et non en luttant contre le capitalisme et l’impérialisme. D’autres questions peuvent être également débattues comme la lutte pour les droits des femmes, la lutte contre le communautarisme, le rôle de Etat, etc.
Ce courant a trouvé malheureusement des adeptes dans certains courants de la gauche en Europe également, certes minoritaires mais néanmoins présents.
L’islam politique devient pour cette tendance un agent de modernisation, et la religion islamique est la langue et la culture essentielle des peuples musulmans. Selon cette doctrine, la force motrice de l’histoire en Orient est l’Islam et non, comme en Occident, les intérêts économiques, les luttes de classe et les forces sociopolitiques.
Cette vision considère ainsi les défenseurs de l’Islam politique comme des « anti-impérialistes » ou des « progressistes », et les comparaisons avec les mouvements de la théologie de la libération ont fleuri. Ces considérations sont sans fondement.
La théologie de la libération et les mouvements islamistes ne sont pas de même nature et leurs objectifs sont différents : la théologie de la libération n’est pas tant l’expression d’une identité culturelle – dans le sens de la préservation de soi vis-à-vis d’une domination occidentale « autre », telle que la revendique le mouvement islamiste – elle s’ancre davantage dans un discours du développement et de l’émancipation des subalternes. Elle a principalement mobilisé les pauvres et les exploité-e-s, tandis que les mouvements islamistes ont tendance à cibler les classes moyennes éduquées, considérées comme les principaux agents du changement politique. Les islamistes visent avant tout à islamiser la société, la politique et l’économie, alors que les théologiens de la libération n’ont jamais eu l’intention de christianiser la société, mais plutôt de la changer à partir du point de vue des opprimé-e-s.
Il faut certes reconnaître la composante anti-impérialiste de certains mouvements luttant contre Israël – quoique, mis à part le Hamas et le Hezbollah, il s’agisse d’une posture souvent rhétorique. Et cela ne suffit pas à les caractériser comme anti-impérialistes ou progressistes. L’exemple des Frères musulmans en Egypte est parlant à bien des égards : ils n’ont cessé en effet de répéter leur respect aux accords de Camp David et ont servi d’entremetteur entre le Hamas et l’Etat d’Israël lors de la dernière offensive militaire israélienne contre la bande de Gaza, en novembre 2012.
Les mouvements islamistes n’encouragent en rien les politiques visant à émanciper la société, pas plus qu’ils ne s’opposent aux politiques néolibérales.
Ils les promeuvent au contraire, en réprimant les syndicats. Par ailleurs, les inégalités sociales et la pauvreté ne peuvent en aucun cas être combattues à travers la charité, qui caractérise ces mouvements. La charité les maintient au contraire puisqu’elle ne remet pas en cause le système qui les sous-tend.
En conclusion, il s’agit de s’opposer aux discours islamophobes développés et entretenus par les élites et les médias occidentaux contre les mouvements de l’Islam politique et dénoncer leur répression lorsque c’est le cas dans certains pays. Mais cette position de principe ne doit pas nous empêcher de soutenir et de lutter pour le changement radical dans les sociétés moyen-orientales et nord-africaines, en développant une analyse matérielle des dynamiques sociétales et des partis de l’Islam politique qui s’opposent par différents moyens à la continuation des processus révolutionnaires et au changement radical, comme en Egypte et en Tunisie par exemple.
Ces deux courants orientalistes qui voyaient la religion comme le moteur de l’histoire de la région peuvent revoir leur copie, car les mots d’ordre des révolutions de la région n’ont pas été « l’Islam est la solution », mais bien « la révolution continue est la solution » ou encore « Pain, liberté et indépendance ». Les processus révolutionnaires au Moyen Orient et en Afrique du Nord ont ouvert une nouvelle page de luttes et d’émancipations, non seulement au niveau régional, mais international également.
Joseph Daher
Le Courrier de Genève. Lundi 28 janvier 2013 :
http://www.lecourrier.ch/105465/islamophobie_et_orientalisme_inverse* Chercheur doctorant à la School of Oriental and African Studies (SOAS), Londres.
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article37923
-
Non, antisionisme et antisémitisme ne sont pas synonymes (Ujfp)

Selon Manuel Valls, l’antisionisme est « tout simplement le synonyme de l’antisémitisme et de la haine d’Israël ».
Prononcée le 7 mars lors du dernier dîner annuel du Crif (Conseil représentatif des juifs de France), organisme principalement dédié à la défense des gouvernements israéliens successifs auprès des autorités françaises, cette accusation vise à faire peser un soupçon indistinct d’infamie sur les mouvements de solidarité avec les Palestiniens. Voire à les criminaliser, comme on le constate avec la pénalisation des appels au boycott des produits israéliens en provenance des territoires occupés.
Passons sur le fait qu’il est permis – et même valorisé – dans notre pays d’appeler à la guerre (en Irak, au Darfour, en Syrie, en Libye) mais illicite de protester par un boycott de consommation contre une politique coloniale. Intéressons-nous plutôt aux rapports entre sionisme et antisémitisme, en nous souvenant en premier lieu que la majorité des juifs du monde, et notamment les Français, furent opposés au sionisme jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale et que même alors, la majorité des juifs d’Europe ne choisit pas la Palestine après la shoah. Pas plus que les juifs russes fuyant les pogroms à la fin du XIXe siècle, dont seul 1 % se rendit en « Terre promise ».
Quant aux juifs français engagés dans le soutien au capitaine Dreyfus, tous ne suivirent pas Théodore Herzl, fondateur du sionisme, qui fit de ce procès inique le déclencheur de son projet national. Lorsque Herzl affirmait que l’affaire Dreyfus marquait l’échec du modèle républicain d’intégration des juifs, d’autres voyaient dans le foyer national juif un « piège tendu par l’antisémitisme » [1]. Et c’est dans une logique tout impériale que Lord Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères lui apporta son soutien en novembre 1917, durant la Première Guerre mondiale.
Que l’on puisse sans contradiction être prosioniste et antisémite devrait tomber sous le sens, puisqu’il s’agissait, dès l’origine, de débarrasser l’Europe de ses juifs, projet commun des uns et des autres avant que surgisse la folie hitlérienne. La dimension biblique comptait dans ce soutien, les courants évangéliques anglais de l’époque, comme leurs homologues contemporains aux Etats-Unis, voyant dans le rassemblement des juifs en Palestine l’actualisation du récit de l’ancien testament et le prélude à l’avènement du Messie.
Que l’on puisse sans contradiction être prosioniste et antisémite devrait tomber sous le sens, puisqu’il s’agissait, dès l’origine, de débarrasser l’Europe de ses juifs, projet commun des uns et des autres avant que surgisse la folie hitlérienne. La dimension biblique comptait dans ce soutien, les courants évangéliques anglais de l’époque, comme leurs homologues contemporains aux Etats-Unis, voyant dans le rassemblement des juifs en Palestine l’actualisation du récit de l’ancien testament et le prélude à l’avènement du Messie.
Les plus fervents et les plus radicaux des défenseurs d’Israël en toutes circonstances se recrutent d’ailleurs parmi ces évangéliques américains, lesquels véhiculent les plus classiques des stéréotypes antisémites tout en soutenant les plus durs des colons israéliens. L’avenir qu’ils réservent aux juifs laisse songeur quant aux alliances de l’Etat hébreu : selon l’interprétation évangélique de la Bible, les juifs devront en effet se convertir ou périr lors du Jugement dernier hâté par leur regroupement en Palestine.
On peut certes être antisioniste par haine des juifs, qui pourrait le nier ? Mais on peut n’être pas moins antisémite et un sioniste ardent, ce que notre Premier ministre semble ignorer. Estimer que la création d’Israël fut une décision funeste, y compris pour les juifs, relève de la liberté d’opinion, au même titre que l’opinion contraire. Telles sont, stricto sensu, les significations des mots antisioniste et sioniste. Les deux positions, regards opposés mais également légitimes sur un événement historique, peuvent se nourrir de l’antisémitisme, comme elles peuvent y être totalement étrangères.
Les saisies de terres, destructions de maisons, emprisonnements administratifs, extensions de colonies, voilà ce qui nourrit aujourd’hui la critique d’Israël et de sa politique du fait accompli. Si le sionisme historique est pluriel, sa forme contemporaine est monocolore, largement sous le contrôle des colons. Et l’antisionisme est pour beaucoup une simple opposition à la stratégie d’occupation des territoires palestiniens et aux exactions qui l’accompagnent.
Voilà ce que cherche à masquer le Crif, principal porte-voix du gouvernement israélien en France, désormais détrôné dans ce rôle par le Premier ministre.
RONY BRAUMAN
Ancien président de Médecins sans frontières, professeur associé à l’Institut d’études politiques de Parisjeudi 31 mars 2016 par
-
La gauche radicale après les attentats de Bruxelles (ESSF)

Pierre Rousset
Le silence de la blogosphère anglophone, les non-dits en France Comment faire face
Depuis janvier 2915, les attentats « djihadistes » ont pris en Europe une dimension et une dynamique sans précédent. Pourtant, une grande partie de la gauche radicale anglophone ne veut pas en prendre la mesure. En France, il reste à pousser plus avant la réflexion sur les implications de cette situation nouvelle : comment faire face ?
Les attentats « djihadistes » meurtriers se succèdent en Afrique, au Moyen-Orient et au Maghreb, en Asie comme en Europe ou en Amérique du Nord. Ils doivent être analysés dans leur dimension internationale –, mais aussi dans leurs réalités régionales ou nationales.
Je ne traiterai ici que du cadre européen, depuis janvier 2015 (attaques dans l’agglomération parisienne contre Charlie Hebdo et l’Hyper-Casher) en partant de deux questions : les réactions de la blogosphère anglophone et de la gauche radicale française.
Après l’orage, le silence de la blogosphère anglophone
Après l’attentat contre Charlie Hebdo, la blogosphère anglophone s’est enflammée : des milliers de courriels, des centaines d’articles lapidaires, des assauts furieux, des polémiques revanchardes… Cependant, les attentats qui ont suivi peu après au Danemark (en février) l’on laissé de marbre, ainsi que les véritables massacres de Paris en novembre dernier et de Bruxelles ce mois de mars. Bizarre, vous avez dit bizarre ?
Certes, quelques organisations comme ISO aux Etats-Unis, ont publié des articles et témoignages significatifs sur les récents massacres [1], et des sites progressistes ont couvert ces événements avec constance, comme Open Democracy. Mais d’autres organisations qui suivent pourtant avec attention l’actualité moyen-orientale semblent assez peu concernées.
Quant à la blogosphère, elle est restée indifférente, car il n’y avait plus d’enjeu qui la stimule.
La grande question qui l’agitait en janvier 2015 ne concernait pas l’analyse de la politique terroriste de l’Etat islamique, mais la culpabilité des victimes : Charlie Hebdo accusé d’islamophobie, « les » Français ou « la » gauche française dont, n’est-ce pas, chacun connaît le racisme.
Est-il possible maintenant, après les récents massacres, de reconnaître ce que cet « angle de vue » avait de parochial, de nombrillaire et d’identitaire ? Charlie Hebdo n’était en rien « responsable » des attentats de janvier 2015, il n’était qu’une cible utile. Ils auraient eu lieu même si ce journal n’avait pas existé – comme d’autres avaient eu lieu avant et ont eu lieu après. Pour une certaine gauche radicale, l’arbre de Charlie Hebdo a été utilisé pour cacher la forêt djihadiste.
Il ne s’agit pas ici d’une rationalisation à postériori. C’était déjà évident à l’époque. L’article d’analyse que nous avions écrit alors, François Sabado et moi [2], mentionnait à peine Charlie Hebdo, car il « n’expliquait » rien. J’ai par ailleurs répondu aux accusations portées contre ce journal [3], mais quoi que l’on pense de son orientation éditoriale et de son histoire, le problème de fond n’était pas là.
Une partie de la gauche radicale a voulu croire que l’Etat islamique (ou autres mouvements djihadistes) ne s’attaquait qu’à des « symboles compréhensibles », comme Charlie, les juifs (censés incarner l’Etat d’Israël) ou des églises (les « Croisés » occidentaux). C’était une lecture complaisante, mais aussi totalement illusoire des objectifs de Daesh (je renvoie à l’article que nous avons écrit, François Sabado et moi, après le 13 novembre [4]). La population, indifférenciée (et même non européenne, dans un aéroport international), est tout autant « cible légitime » [5] à ses yeux. L’orientation de l’EI est bien de tuer, blesser, traumatiser le maximum de monde pour aviver les tensions au sein de la population.
Nous vivons dorénavant en Europe sous la menace perpétuelle d’attaques terroristes massives, comme c’est déjà le cas en d’autres régions. Il faut certes en comprendre les causes profondes là-bas (guerres sans fin, ordre néolibéral, régimes dictatoriaux…) et ici (précarisation de la vie, dictature des « marchés », discriminations…), mais aussi prendre la mesure des conséquences. Comment réussir à bloquer la constitution de régimes d’exception, comme en France, quand de tels attentats se succèdent ? Comment réussir à imposer l’accueil des réfugiés, quand la peur du « faux Syrien vrai terroriste » s’installe ? Comment refouler les extrêmes droites quand une extrême droite islamiste leur sert de faire valoir (et réciproquement) ?
La politique de Daesh et ses « objectifs de guerre » pèsent dorénavant de façon majeure sur l’évolution de la situation en Europe – pour le pire. Si l’on ne veut pas être otage des réponses sécuritaires, militaires et liberticides de nos gouvernants, il nous faut leur opposer une autre façon de combattre le djihadisme – mais il faut l’opposer en pratique et pas seulement verbalement.
Prises de positions françaises
Nous avons publié sur ESSF de nombreux communiqués et déclarations, après les attentats de Bruxelles, en quatre lots [6]. Je m’y réfèrerais en indiquant le numéro du « lot ».
Mais commençons par une complainte belge (lot 1) :
« Pourquoi les musulmans ne descendent pas en masse dans la rue pour condamner ? »
Parce que nous sommes en train de conduire les taxis qui ramènent gratuitement la population chez elle depuis hier…
Parce que nous sommes en train de soigner les blessés dans les hôpitaux…
Parce que nous conduisons les ambulances qui filent comme des étoiles sur nos routes pour essayer de sauver ce qu’il reste de vie en nous…
Parce que nous sommes à la réception des hôtels qui accueillent les badauds gratuitement depuis hier…
Parce que nous conduisons les bus, les trams et les métros afin que la vie continue, même blessée…
Parce que nous sommes toujours à la recherche des criminels sous notre habit de policier, d’enquêteur, de magistrat…
Parce que nous pleurons nos disparus, aussi…
Parce que nous ne sommes pas plus épargnés…
Parce que nous sommes doublement, triplement meurtris…
Parce qu’une même croyance a engendré le bourreau et la victime…
Parce que nous sommes groggy, perdus et que nous essayons de comprendre…
Parce que nous avons passé la nuit sur le pas de notre porte à attendre un être qui ne reviendra plus…
Parce que nous comptons nos morts…
Parce que nous sommes en deuil…
Le reste n’est que silence… »
Ismaël Saidi, Belgo-marocain, auteur de la pièce DjihadRetour en France. En règle général, les syndicats (lot 2)
Mouvements et partis condamnent clairement le massacre, ses auteurs et les mesures liberticides ou discriminatoires que nos gouvernants prennent en guise de réponse. Certains n’ont à ce jour rien publié (Solidaires…), d’autres se braquent sur un lapidaire raidissement défensif. Le pompon revient ici à Alternative Libertaire qui se contente de publier sur son site une déclaration d’AL Bruxelles affirmant qu’elle poursuivra son combat (lot 4, comme les suivants). C’est un peu court, au vu des circonstances !
D’autres partis, comme le NPA, condamnent fermement les « attentats ignobles », affirment leur solidarité avec les victimes, dénoncent les buts des terroristes (« créer un engrenage irréversible de terreur et de violence en semant la haine et la peur ») ; mais après ce premier paragraphe, les six suivants sont entièrement tournés contre la politique intérieure et moyen-orientale de nos gouvernants et contre « les serviteurs des banques et des multinationales qui dirigent le monde ». Notre seule possibilité d’action est-elle d’exiger de nos gouvernements un changement radical d’orientation ?
Quant à Ensemble ! (membre du Front de Gauche), elle en reste à des généralités très générales : « S’il est nécessaire de se doter de tous les moyens nécessaires pour assurer la sûreté publique et de prévenir de nouveaux attentats, cela passe par la nécessité de donner tous les moyens nécessaires aux services publics, une lutte résolue contre les inégalités, les discriminations, et non par le rejet des migrants ou la mise en place d’un état d’urgence permanent qui a suscité une stigmatisation des musulmans et une criminalisation des mouvements sociaux. »
Enfin, le Parti de Gauche centre son communiqué sur la seule Syrie, réitérant sa ligne « pro-Poutine » : « Le soutien militaire aux pays et forces qui se battent aujourd’hui contre Daesh sur le terrain doit être apporté par une coalition internationale sous égide de l’ONU. Car c’est dans cette région du monde, et dans le respect du droit international, que doit être éliminée la menace de Daesh. ».
Bien entendu, il ne s’agit encore que de brefs communiqués écrits à chaud. Il faut attendre la parution d’articles plus développés pour mieux fonder la discussion. Ainsi, la déclaration de la LCR-SAP de Belgique (lot 1) peut maintenant être complétée par une analyse de Daniel Tanuro (qui en est l’un des dirigeants) [7]. Notons seulement pour l’instant que la condamnation politique de l’Etat islamique (et non seulement de ses méthodes meurtrières) est aujourd’hui plus générale et plus fondée que par le passé ; mais que la question « comment combattre le djihadisme » est esquivée ou traitée en termes trop généraux.
Entre un présent détestable et des lendemains qui chantent, comment combattre ?
Dans une large mesure, les combats que nous menons déjà font partie de la solution. Ils s’attaquent aux racines sociales de la crise démocratique, visent à reconstruire une alternative solidaire (réellement à gauche) qui permette de rompre le choix mortifère entre hégémonie néolibérale et idéologies de haine, posent la question de la paix et de la sécurité du point de vue des peuples et non plus des puissances, etc. Cependant, outre les rapports de forces, nous nous heurtons à de réelles difficultés, dont :
La crédibilité en ce présent détestable : le « peuple » n’est pas en mesure aujourd’hui de chasser de son sein, par le rejet social, par la fureur collective, les extrêmes droites (non confessionnelles ou religieuses) en particulier djihadistes. Police, armée et services secrets apparaissent alors comme un bien, ou comme un mal nécessaire. Rappelons-nous ce cri du cœur d’une victime soufflée par les explosions à l’aéroport de Bruxelles : « ils sont où ces putains de soldats ! ». Il ne faut pas se payer de mots, mais attaquer là où l’instrumentalisation de la peur par nos gouvernants peut être démontrée.
L’incrédibilité des lendemains qui chantent : il importe évidemment de donner un horizon à nos résistances, un nom à notre alternative, mais personne ne croît (surtout pas nous) que nous marchons à grands pas vers sa réalisation prochaine.
Comment donc mieux combattre ? Je n’ai évidemment pas la prétention d’offrir une réponse clé en main ! Cependant, je pense qu’il y a matière à débat, en partant de deux considérants :
Le djihadisme – ainsi qu’une nébuleuse de courants politico-religieux qui lui sont idéologiquement proches – n’est plus seulement un produit d’importation, ombre portée de la crise irako-syrienne, mais aussi une réalité endogène. Il doit donc être combattu ici et pas seulement là-bas.
Ce combat là-bas et ici doit être mené par les forces progressistes sur leurs propres bases, de concert avec les résistances à l’impérialisme et aux dictatures. Cela nous concerne. Il ne suffit pas de lutter indirectement contre le djihadisme et autre mouvement fondamentaliste (par exemple en dénonçant notre impérialisme). Il nous faut les combattre directement, car ils font dorénavant partie de notre réalité.
Je vais essayer de montrer ce qu’à mon sens cela peut vouloir dire.
« Tous ensemble »
Nous avons dans notre main un atout maître, notamment en France : la brutalité et l’universalité des attaques néolibérales : ordre sécuritaire, destruction du code du travail, etc. Cela donne un fondement objectif très profond à une résistance « Tous ensemble ».
Bien entendu, le « Tous ensemble » peut noyer les exigences propres des plus exploitées ou discriminées, des « sans voix », des « sans pouvoir ». Il faut se prémunir consciemment contre ce risque, mais il faut aussi valoriser le « Tous ensemble » – dans la lutte aussi bien que dans le quotidien.
Comme le note l’Union des Progressistes Juifs de Belgique (lot 3), « Nous ne voudrions pas que, désormais [l]es habitants se replient et se regardent en chiens de faïence, se méfiant les uns des autres. Les attentats ont tué indistinctement. Plus que jamais, il faut mettre en œuvre des politiques qui inventent des dispositifs de rencontres, de dialogues, de mélanges, qui mettent l’accent sur la connaissance des récits singuliers qui composent notre aventure urbaine pour en faire une geste collective. »
« Tous ensemble » exige de notre part que nous militions en tenant compte de toutes les exigences du salariat réellement existant (qui inclut, oh combien, le « précariat ») ou des habitants des quartiers populaires – même quand cela sort de nos routines syndicales ou politiques. Il n’est pas suffisant, par exemple, de lutter contre la violence policière dans les quartiers. Il faut aussi prendre en compte la violence quotidienne des gangs.
« Tous ensemble » exige de notre part de défendre toutes les victimes. Il y a parfois une tendance à hiérarchiser la solidarité ce qui, en pratique, revient à abandonner à leur sort certaines victimes « non prioritaires » ou agressées par un « opprimé oppresseur ». Pour être concret, il faut défendre le juif menacé de mort et pas seulement le (supposé) musulman face à l’islamophobie. Il faut aussi défendre les femmes « arabo-musulmanes » qui refusent l’envoilement que veulent leur imposer les conservateurs islamistes et pas seulement la femme voilée frappée, injuriée, humiliée par le raciste « bien de chez nous ». Il faut combattre l’homophobie où qu’elle s’exprime.
« Tous ensemble » exige de lutter contre tous les racismes, contre toutes les xénophobies, contre la haine de l’Autre. Les racismes ont des histoires et des encrages différents dont il faut tenir compte, mais il n’y a pas de racisme indolore. Le racisme et la xénophobie sont des poisons mortels qui, au bout du compte, rendent impossible une lutte commune et servent à merveille l’ordre dominant qui ne survit que grâce à nos divisions.
Car le « Tous ensemble » n’exige pas seulement la reconnaissance fraternelle de l’Autre, une valorisation de la « mixité », mais aussi des combats communs pour des droits communs : à une vie non précaire, à l’éducation et à la culture, à l’emploi, à la sécurité, à la santé…
Un combat idéologique
Il n’y a pas de profil type des personnes qui, en Europe, rejoignent l’Etat islamique : les origines sociales, géographiques ou (non) religieuses varient, reflétant une crise globale. Evidemment, celui de « nos » djihadistes est plus resserré. Ayant souvent appartenu à des gangs, ayant connu la prison, étant déjà familiers des opérations armées, ils ont les connexions qui leur permettent d’agir sur ce terrain.
Il ne faut pas pour autant sous-estimer le facteur idéologique dans les processus dits de radicalisation de l’islam ou d’islamisation de la radicalité (je trouve l’usage du mot « radical » fort peu approprié !). Des courants salafistes, par exemple, ne conduisent pas nécessairement au djihadisme [8], mais il n’en sont pas moins ultra-réactionnaires . De façon générale, nous assistons à une montée en puissance de courants conservateurs (qui n’est pas propre aux seuls milieux musulmans). Le tout crée un bain idéologique sur lequel le fondamentalisme (l’intégrisme) politique prospère.
Nous combattons l’intégrisme catholique et évangélique protestant (d’extrême droite) sur la base des droits : IVG, mariage pour tous, éducation à la science (contre le créationnisme) et à l’égalité de genre… Il doit en aller de même à l’encontre de l’intégrisme islamique (d’extrême droite lui aussi).
Vu la place qu’occupe la subordination des femmes dans la pensée conservatrice et, en particulier, dans le djihadisme, la défense de leurs droits (comme de ceux des homosexuels) est évidemment un terrain de confrontation pour nous décisif.
Les extrêmes droites sont, de façon générale, à l’offensive en Europe, affichant de nombreux visages identitaires. Ce sont les anciennes et nouvelles extrêmes droites « bien de chez nous », plus ou moins fascisantes, qui sont en position de postuler au pouvoir dans divers pays européens – ou qui influencent déjà les pouvoirs en place. Un danger majeur !
Il ne faut pas pour autant ignorer les conséquences du développement d’extrêmes droites à référence islamiste. Elles s’enracinent en effet dans des milieux populaires où un parti comme le Front national (pour parler de la France) ne peut pénétrer. En ce sens, ils se complètent, construisant de redoutables barrières à tout projet émancipateur, solidaire, réellement à gauche.
Ne pas sacrifier leurs droits (voire leur vie) à notre sécurité
Nos dénonçons sans relâche l’utilisation par nos gouvernants de la peur pour justifier l’imposition de mesures liberticides ici et d’une politique de guerre là-bas. Problème : certaines positions à gauche font preuve d’un cynisme fort peu solidaire. J’en prends deux exemples.
Conforter le salafisme ?
Dans une tribune pour Libération [9], le philosophe et sociologue Raphaël Liogier veut marier (notre) liberté et (notre) sécurité. Il propose, afin de lutter plus efficacement contre le djihadisme armé, de s’appuyer sur les mosquées salafistes (au lieu de les cibler comme le fait le gouvernement). Les milieux salafistes menacés par Daesh pourraient ainsi offrir aux autorités « un véritable réseau d’information au cœur du milieu musulman ».
« Contrairement aux djihadistes, souligne Liogier, ces fondamentalistes sont focalisés sur la vie quotidienne et les mœurs, ils sont complètement dépolitisés. » Donc pas de problème ? Notre universitaire prend Abou Houdeyfa, imam de Brest, comme exemple de représentant des mosquées salafistes avec lesquelles il faut collaborer. La rédaction de Libération note que pour cet imam, « la musique fait naître le mal. ».
Ce n’est pas un hasard si Liogier, pour lever tout ambiguïté, prend Abou Houdeyfa comme exemple de « point d’appui ». Ce dernier a effet provoqué un scandale, après la publication d’une vidéo, sortie en septembre dernier, extraite de l’un de ses cours. Il y explique devant des enfants qu’écouter de la musique est interdit et que « ceux qui l’aiment » sont ceux qui risquent d’« être transformés en singes et porcs » dans l’au-delà. Que ceux qui la consomment sont sur la voie du diable [10].
Sommes-nous indifférents à ce qu’un tel enseignement soit servit à de jeunes enfants ? La criminalisation de la musique n’est-elle pas une violence sociale d’une terrible brutalité – et ce dans toutes les parties du monde. Comment ignorer la richesse des cultures musicales des pays musulmans ? Et quid des femmes ? Liogier reconnaît volontiers l’existence d’un « fondamentalisme extrême des mœurs, celui des femmes intégralement voilées par exemple », mais qu’importe, il n’y a là que choix de vie [11]. Fermer le ban.
Liogier prétend marier efficacité sécuritaire et démocratie. Au final cependant, il affiche une conception étroitement policière du combat contre Daesh, pour laquelle les luttes d’émancipation d’un pan entier de notre société doivent être sacrifiées sans état d’âme [12]. Démocratie pour qui ? Sécurité pour qui ?
Soutenir Poutine et Assad en Syrie ?
Revenons sur la position du Parti de Gauche. A l’occasion des attentats de Bruxelles, il a donc réitéré sa position de fond sur le conflit syrien (mainte fois affirmée par Jean-Luc Mélenchon) : soutien à l’intervention russe et au régime Assad – le Parti communiste de Belgique allant encore plus loin dans l’alignement sur Moscou (lot 3). Comme mentionné plus haut, il explique dans une langue de bois propre aux communiqués diplomatiques, qu’une coalition internationale sous égide de l’ONU doit apporter son soutien « aux pays et forces qui se battent aujourd’hui contre Daesh sur le terrain » (lot 4)– « sur le terrain » signifiant avant tout la Russie et l’armée gouvernementale de Damas.
Le régime Assad est pour une grande part responsable de la crise syrienne et des succès, dans ce pays, de l’Etat islamique. Il a torturé, affamé et tué plus de Syriens que tout autre acteur de cette guerre sans merci –, mais il est vrai qu’il n’envoie pas de commandos kamikazes ensanglanter l’Europe. Alors tant pis pour les victimes « là-bas » de l’une des dictatures les plus sanglantes au monde et de bombardements russes particulièrement meurtriers. Le « sens de l’Etat » (français), la défense de sa stature internationale et la sécurité de nos citoyens « ici » vaut bien aux yeux du PG une épaisse couche de Realpolitik !
Ici et là-bas
Dans toute perspective solidaire (internationaliste), le lien actif entre ici et là-bas s’avère essentiel. Trois suggestions pour le renforcer.
1. Coopérer plus étroitement avec les associations de l’immigration – notamment, en France, de l’immigration maghrébine. Entre janvier et novembre 2015, le mois mars a connu l’attentat du Bardo à Tunis. S’il y a eu une réponse collective de mouvements franco-tunisiens et liés aux migrations méditerranéennes [13], la gauche française ne s’est manifestée qu’en ordre dispersé. Chaque attentat de part et d’autre de la Méditerranée pourrait être l’occasion d’appels et de mobilisations communes, allant au-delà de rassemblements symboliques.
2. Renforcer la solidarité Syrie. Certes, le Collectif « Ni guerre ni état de guerre » existe, mais c’est une coalition contre la politique de l’Etat français à l’étranger comme en France même. Voilà qui est fort bien, mais cela ne remplace pas un mouvement de solidarité spécifique. En effet, tel n’est pas son objet. Le collectif appelle au retrait des forces française des théâtres d’opérations où elles sont déployées, ce qui est très important pour nous et qui aurait des implications effectives dans une partie de l’Afrique, mais fort peu en Irak-Syrie où notre impérialisme ne joue qu’un rôle mineur. Comme le note d’ailleurs « Ni guerre ni état de guerre » dans le communiqué publié après le 22 mars (lot 3), sur les 11 086 effectués par la « coalition occidentale », l’aviation française n’en a effectué « que » 680. Le retrait français ne changerait là-bas pas grand-chose, même s’il avait une portée importante ici.
La solidarité Syrie ne peut se définir seulement en rapport à notre impérialisme et, en terme vagues, à la « coalition occidentale ». Elle doit prendre en compte les acteurs principaux de la guerre qui incluent aussi la Russie, la Turquie, l’Arabie saoudite, le Qatar – voire Israël et l’Egypte –, l’Iran, le Hezbollah… et des fronts multiples, des « guerres dans la guerre »... Elle ne peut agir sans se demander à qui apporter son soutien, à qui le refuser, pour quelle paix mobiliser. Certes, la crise au Moyen-Orient est compliquée ! Mais il faut des accords de base : défendre de concert la résistance kurde et la résistance arabe populaire, progressiste – ce qui n’est possible ni avec des pro-Assad ni avec les forces qui confessionnalisent le conflit, ni avec des pro-Russe ni avec des pro-Américains.
La tâche est difficile, mais peut-on accepter que le niveau de solidarité active avec les peuples de cette région reste si faible ?
3. Internationaliser le rejet des attentats terroristes. Faire en sorte que chaque nouvel attentat soit l’occasion d’une dénonciation internationale de la part des forces progressistes, qu’une solidarité « de peuple à peuple », indépendant des gouvernants, s’affirme par des « solidarités croisées » et des appels communs. Bien entendu, les terrorismes d’Etat font un nombre de victimes plus important que les massacres djihadistes, mais l’un ne justifie pas l’autre. La dénonciation des méfaits impérialistes est déjà intégrée à l’ADN des gauches radicales. En revanche, hors des pays qui vivent depuis de longues années sous la menace fondamentaliste comme le Pakistan, cela n’est pas encore le cas concernant le djihadisme [14].
Il n’est pas question de faire du djihadisme « l’ennemi principal » et de prôner en conséquence l’union nationale ! Mais pas question non plus de faire du djihadisme un « ennemi secondaire », justifiant par là une passivité coupable.
-
Rashid Khalidi: «Les frontières du Moyen-Orient sont brûlantes» (A l'Encontre.ch)
Image de propagande de Daech montrant la destruction de la frontière Sykes-Picot par un bulldozer
Entretien avec Rashid Khalidi
conduit par Joseph ConfavreuxAu-delà des « frontières artificielles » du Moyen-Orient, voulues par les puissances impériales, Daech pourrait-il réussir là où le panarabisme a échoué, en recomposant les cartes du monde arabe ? Entretien avec Rashid Khalidi, successeur d’Edward Saïd.
Cent ans tout juste après les accords secrets Sykes-Picot, au moyen desquels les puissances impériales ont redessiné la carte du Moyen-Orient sur les décombres de l’Empire ottoman, la question des frontières a rarement été aussi brûlante dans la région.
L’organisation de l’État islamique met en scène, dans sa propagande, la destruction de la ligne de démarcation entre l’Irak et la Syrie, deux États qui pourraient bien disparaître dans leurs limites et compositions actuelles. Les Kurdes, déjà largement autonomes en Irak et en Syrie, aspirent de plus en plus ouvertement à un État-nation, inacceptable pour la Turquie. Certains jugent que la lutte contre Daech passera inévitablement par la reconnaissance d’une entité autonome pour les sunnites d’Irak. Quelques rêveurs espèrent encore une confédération des peuples arabes aujourd’hui désunis, bien que celle-ci supposerait une démocratisation profonde d’États rongés par l’autoritarisme et le clientélisme. Quant à la perspective d’un État palestinien viable, elle a rarement paru aussi lointaine…
L’historien américain d’origine palestinienne Rashid Khalidi observe le Moyen-Orient avec le savoir de l’historien et l’inquiétude lucide d’un homme situé entre plusieurs cultures, dans un moment où les adeptes d’une « guerre des civilisations » entre Orient et Occident ne cessent de gagner du terrain.
Il dirige le département d’histoire de l’université Columbia et est le titulaire de la chaire créée pour Edward Saïd en études arabes modernes. Il est notamment l’auteur de Palestine, histoire d’un État introuvable (Actes Sud, 2007), de L’Empire aveuglé. Les États-Unis et le Moyen-Orient (Actes Sud, 2004) et de L’Identité palestinienne (La Fabrique, 2003).
Il était, lundi 14 mars, au MuCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) de Marseille, pour le cycle de conférences Pensées du Monde, consacré cette année à « l’avenir des frontières », dont Mediapart est partenaire.
Quelles sont les conséquences présentes de la manière dont les frontières du Moyen-Orient ont été découpées pendant la Première Guerre mondiale, à l’heure où l’organisation État islamique a axé une partie de sa propagande sur la disparition de ces « frontières artificielles » ?
Rashid Khalidi. Daech a transformé les accords secrets signés voilà un siècle, en 1916, par le Britannique Mark Sykes et le Français François Georges-Picot, en une question politique brûlante et contemporaine, comme on l’a vu dans plusieurs vidéos où l’État islamique mettait en scène la destruction de postes frontaliers entre la Syrie et l’Irak, une démarcation issue de ces accords.
Mais au-delà de l’actualité, liée à l’action de Daech, de cette question des frontières, le fait que les contours des pays du Moyen-Orient aient été créés par des décisions prises par des puissances impériales hante le monde arabe depuis un siècle.
D’autant plus que les exemples de l’Iran ou de la Turquie, qui ont réussi à construire de puissants États-nations en résistant aux volontés impérialistes de diviser leurs territoires – puisque la Grande-Bretagne avait promis aux Arméniens et aux Kurdes un État autonome pendant la Première Guerre mondiale – agit, en creux, comme un rappel constant de la division et de la faiblesse des Arabes.
Le mépris pour la volonté des peuples se trouvant dans ce qui était alors l’Empire ottoman n’a pas seulement nourri l’hostilité nationaliste vis-à-vis des puissances impériales, mais aussi la défiance vis-à-vis des élites arabes séduites par les modèles britannique ou français de démocratie libérale, que ce soit dans le cadre d’une République ou d’une monarchie parlementaire.
Pour la majorité des peuples arabes, la violence du démantèlement de l’Empire ottoman, accompli en fonction des intérêts économiques et des rivalités des puissances impériales, a été considérée comme l’échec des élites arabes libérales et comme une disqualification du modèle démocratique. Cette faillite des idées libérales, couplée à l’hypocrisie de puissances impériales faisant de la devise « liberté, égalité, fraternité » un symbole, tout en se comportant à l’inverse dans le monde arabe, a nourri l’installation, après la Seconde Guerre mondiale, de régimes militaires et autoritaires dans la plupart des pays arabes, après une série de coups d’État, notamment avec le parti Baas en Irak et en Syrie.
La manière dont Daech attaque aujourd’hui les frontières « artificielles » et « impérialistes » du Moyen-Orient est-elle similaire à la dénonciation de ces mêmes frontières véhiculée par les nassériens égyptiens, ou les baasistes d’Irak ou de Syrie, après la Seconde Guerre mondiale ?
La rhétorique n’est pas identique, même si le carburant de l’humiliation est fondamental dans les deux cas. Même quand Daech développe des arguments anti-impérialistes contre les frontières actuelles, ils ne viennent pas du nationalisme arabe tel qu’il a été développé par les nassériens ou les baasistes. En dépit de l’existence, entre 1958 et 1961, d’une République arabe unie faite de l’union entre la Syrie et l’Égypte, les nationalistes arabes n’ont pas réussi à abolir les frontières. En particulier parce que si la règle du « diviser pour mieux régner » a bien été appliquée par les puissances étrangères, plusieurs divisions du monde arabe préexistaient, de longue date, aux accords Sykes-Picot.
Daech peut facilement moquer ces nationalistes qui n’ont pas réussi à unifier le monde arabe et affirme vouloir, et pouvoir, effacer les frontières sur une base religieuse. Mais en dépit de cet objectif affiché, il agit avec un pragmatisme inédit que ne possédaient pas Al-Qaïda ou les talibans. Comme historien, je suis saisi de voir à quel point Daech constitue une alchimie très étrange entre des idées baasistes et des idées islamistes, ou qui utilisent l’islam.
Les gens qui dirigent l’organisation État islamique sont d’anciens cadres de l’Irak de Saddam Hussein que l’idiotie des décisions américaines, après l’intervention de 2003, a jetés dans les bras des extrémistes. Ces gens savent parfaitement gérer un État, avec férocité et brutalité, mais aussi avec efficacité. Ils sont donc soucieux des frontières, même s’ils sont également pris dans des rhétoriques religieuses, voire apocalyptiques.
Cette convergence entre l’idéologie djihadiste et le baasisme, un mouvement à l’origine séculier, date d’avant l’apparition de l’organisation de l’État islamique. Le régime irakien baasiste, affaibli par les mouvements d’opposition, sunnites ou chiites, a choisi, sur le tard et en réponse, de s’islamiser. Il avait symboliquement changé son drapeau pour y intégrer des références religieuses, en dépit de son histoire laïque. Les traumatismes successifs de la guerre avec l’Iran, de la guerre du Golfe, puis de l’occupation américaine après 2003, ont facilité des évolutions profondes de la société et permis ce type de retournements.
Comme historien, je constate que, même si Daech prétend revenir à un islam d’il y a plusieurs siècles, ses membres ne cessent de faire ce qu’ils prétendent rejeter, à savoir des « innovations », des « hérésies », qu’on désigne en arabe par le terme de bid’ah. Rien, dans leur prétendu « État islamique », ne ressemble à ce qui a existé dans d’autres États islamiques à travers l’histoire. La manière dont ils décapitent les gens au nom du Coran montre non seulement qu’ils sont ignorants du texte sacré, mais aussi qu’ils ne sont pas seulement les enfants d’un certain islamisme ou d’un certain baasisme, mais aussi, voire surtout, les enfants du XXIe siècle, capables d’allier la modernité technologique des réseaux sociaux à une propagande de violence, d’horreur et de brutalité qu’on avait déjà pu voir sous le nazisme.
Aux États-Unis, nous avons depuis longtemps des personnes fascinées par les images et les propos ultra violents. Mais il y en a aussi beaucoup au Moyen-Orient, qui se recrutent au sein de ces populations brutalisées par des années de guerre, qui s’avèrent particulièrement réceptives à cette propagande que nous ne faisons que renforcer lorsque nos armées bombardent des populations civiles.
Il faut avoir été bombardé, comme cela m’est arrivé à Beyrouth en 1982, pour comprendre ce que cela provoque sur les esprits et les corps. Depuis 1975 et la guerre du Liban, il y a eu l’Irak, et maintenant la Syrie. Bien sûr, il existe des problèmes endogènes aux sociétés arabes, mais les différentes ingérences et occupations n’ont fait que les aggraver. Al-Qaïda est un produit de la guerre en Afghanistan, et Daech celui de la guerre en Irak.
Comme historien, jugez-vous que le Moyen-Orient du début du XXIe siècle pourrait jouer le rôle des Balkans au début du XXe, et constituer l’étincelle d’un conflit mondial généralisé, notamment si l’Irak et la Syrie s’effondraient encore plus ?
C’est une possibilité. Un nouveau président à la Maison Blanche, les Iraniens, les Turcs, les Saoudiens ou l’État islamique ont les moyens de déclencher un conflit incontrôlable. Mais si l’étincelle de la Première Guerre mondiale a été allumée dans les Balkans, ce sont les grandes puissances qui ont eu, ensuite, la responsabilité de faire la guerre. Aujourd’hui, les grandes puissances ont la responsabilité de vendre des armes et de ne jamais braquer l’Arabie saoudite, dont l’idéologie wahhabite s’est répandue grâce à l’argent du pétrole et constitue le cœur du problème.
Cette haine intolérable envers les chiites, et toutes les autres minorités, est devenue une forme d’orthodoxie sunnite explosive. Notamment car les chiites, que ce soit en Iran ou ailleurs, ne sont pas dénués de puissance. Et que l’Arabie saoudite, qui est une théocratie pétrolière, ne possède pas la légitimité populaire qu’a la République islamique d’Iran, même si beaucoup d’Iraniens revendiquent davantage de liberté et de démocratie. La guerre par procuration que se livrent les Iraniens et les Saoudiens, au Yémen, en Libye ou en Syrie, peut changer d’échelle et de degré, si les puissances occidentales laissent l’idéologie wahhabite s’accroître encore, parce que l’Arabie saoudite est un client auquel on n’ose rien dire.
Pensez-vous que les frontières du Moyen-Orient décidées pendant la Première Guerre mondiale pourraient disparaître ou se transformer ?
Je suis historien et non futurologue, mais je ne suis pas sûr que ces frontières vont s’effacer. Ces frontières sont désormais là depuis un siècle, et de telles lignes, artificielles à l’origine, ont pris de la consistance. L’Irak et la Syrie sont devenus des États-nations, même si on peut envisager aussi leur effondrement et leur démantèlement.
En outre, de telles frontières fixées par les puissances impériales de l’époque existent partout dans le monde, en Asie, en Afrique, et pas seulement dans le monde arabe. Or, je constate qu’à part au Soudan, dans les Balkans et dans l’ancienne Union soviétique, ces lignes dessinées après la Première Guerre mondiale n’ont pas été modifiées. Bien sûr, des changements sur les frontières du Moyen-Orient sont envisageables, notamment du fait des revendications kurdes, des pressions subies par certaines minorités, des guerres civiles en Irak ou en Syrie. Mais en tant qu’historien, je constate qu’il est difficile de modifier des frontières qui existent depuis cent ans.
On voit bien que les Kurdes d’Irak pourront difficilement réintégrer un État irakien centralisé, et que les Kurdes de Syrie ont obtenu une autonomie de fait. Le futur du Moyen-Orient ne passe-t-il pas par des entités territoriales plus autonomes et réduites, peut-être davantage susceptibles de mettre un frein aux spirales de violences communautaires ou religieuses auxquelles on assiste, notamment en Irak et en Syrie ?
Il me semble effectivement impossible d’intégrer les Kurdes d’Irak à un État unitaire. Même chose pour les Kurdes de Syrie. Mais il me paraît aujourd’hui également impossible d’acter la fin certaine des entités irakienne ou syrienne. Une autonomie croissante de certains territoires est sans doute inévitable, mais cela peut s’envisager sans effondrement des pays qui existent actuellement. Il y a un an, on estimait le régime de Damas voué à une défaite historique ; aujourd’hui, alors que la guerre dure depuis cinq ans, ce n’est plus le cas. L’histoire doit laisser sa place aux changements conjoncturels de configuration.
Et à quelles conditions un projet, inverse, d’une confédération arabe élargie serait-il envisageable ?
Cette idée me paraît impossible tant que les peuples arabes auront des gouvernements qui ne représentent pas leurs aspirations. Même s’il existe quelques exceptions, avec des formes de représentativité au Liban, au Maroc, ou en Tunisie bien sûr, la plupart des régimes des pays arabes sont des dictatures qui foulent au pied la volonté des peuples et gèrent les biens de la société pour leur compte personnel, familial ou dynastique. Une union accrue du monde arabe ne saurait se faire sans démocratisation.
Mais il faut rappeler que cette situation bénéficie à d’autres, hors du monde arabe. Ces familles régnantes qui vivent sur le dos de leur société achètent à Paris, Londres ou New York des banques, des bâtiments, des institutions, des chaires d’université, des armes… Dans quel état seraient des grandes compagnies comme Airbus ou Boeing sans les achats massifs des compagnies du Golfe ? Dans quel état seraient les industries d’armement américaines ou européennes sans les conflits du Moyen-Orient ? L’Occident n’a aucun intérêt à voir émerger une grande entité confédérale démocratique dans le monde arabe.
Compte tenu de ce qui se passe aujourd’hui au Moyen-Orient, comment regardez-vous la situation de la Palestine ?
De façon très pénible et comme un symbole supplémentaire de la désunion des Arabes. La puissance actuelle d’Israël fait partie du problème, mais l’essence de celui-ci réside dans le fait que le mouvement national palestinien se trouve dans une période de recul. Les Palestiniens et les Arabes sont dans une situation de faiblesse et de division depuis la Première Guerre mondiale, alors qu’Israël, adossé aux États-Unis, n’a jamais été aussi puissant militairement et politiquement et a presque complètement absorbé la Cisjordanie.
Toutefois, le projet du Grand Israël, de plus en plus raciste et expansionniste, auquel nous assistons, n’existait pas comme tel en 1967. Or, ce projet est de plus en plus difficile à soutenir, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Ce tournant explique les crispations autour de la campagne BDS (Boycott – Désinvestissement – Sanctions). Dans le pays où je vis et enseigne, je constate qu’Israël ne cesse de perdre du soutien, chez les jeunes, dans les universités, parmi les syndicats ou les églises… Tout cela n’existait pas il y a encore vingt ans, et le virage à droite pris par Israël renforce son isolement.
Pourquoi la cause palestinienne a-t-elle reculé dans le monde arabe ? Peut-on imaginer que la Palestine soit intégrée à un projet de monde arabe redécoupé sur d’autres bases et dans d’autres frontières ?
Les guerres incessantes expliquent le recul de la cause palestinienne. Depuis 1975, avec le Liban, puis ensuite avec l’Irak et la Syrie, la guerre ne s’est jamais éteinte au Moyen-Orient. Comment voulez-vous, avec toutes ces guerres civiles, que les gens pensent à la Palestine ? En outre, si les peuples arabes ont soutenu les Palestiniens, les régimes arabes ne les ont jamais vraiment appuyés et, depuis la déclaration Balfour de 1917, ont toujours composé avec la volonté des grandes puissances qui voulaient un État juif en Palestine.
Quant à l’idée d’intégrer la Palestine à une nouvelle entité arabe, elle me semble lointaine. Comment intégrer les Palestiniens dans le chaos syrien ou le système confessionnel qui régit le Liban ? L’histoire montre toutefois que tout est envisageable et que les transformations peuvent être rapides. Pendant la Première Guerre mondiale, les puissances impériales occupaient surtout les côtes du Moyen-Orient, au Liban ou en Palestine, et l’Assemblée de Damas représentait un vaste territoire arabe relativement unifié qui couvrait une surface allant bien au-delà de la Syrie actuelle. Mais les accords signés par Mark Sykes et François Georges-Picot, liés eux-mêmes à l’expansion du chemin de fer pour l’exploitation des ressources de la région, ont bouleversé tout cet équilibre. En dépit de leur caractère étonnamment durable, ils ne sont toutefois pas gravés dans le marbre pour l’éternité. (Article publié par le site Mediapart, le 23 mars 2016)
le 23 - mars - 2016 -
Il y a un siècle, l’impérialisme en débats (Anticapitalisme & Révolution)
Nous semblons loin du temps des colonies. Non parce que les puissances occidentales justifient par les droits de l’homme leurs expéditions militaires (déjà la colonisation…). Mais les rapports de force à travers le monde semblent chamboulés avec le déclin de la France et autres pays d’Europe, la montée des « émergents », la « mondialisation ».Et une guerre entre pays développés, ce spectre qui hantait le début du 19ème siècle, semble aujourd’hui inconcevable. Le concept marxiste d’« impérialisme » forgé alors est-il donc obsolète ? Nous empêche-t-il de penser le monde tel qu’il est ? Nous tentons dans ce dossier, d’un côté, de retrouver le fond des analyses de l’impérialisme au début du 20ème siècle et, d’un autre, d’ausculter quelques grandes lignes d’évolution structurantes de notre époque : l’hégémonie américaine, la puissance nouvelle de la Chine, la mort prétendue de la Françafrique... Car pour agir, il faut comprendre dans quel ordre (et désordre) mondial nous vivons.« L’impérialisme, stade suprême du capitalisme »Quel drôle de titre que celui de l’ouvrage de Lénine en 1916 ! Un accent prophétique, voire apocalyptique. Mais nous étions alors justement en pleine apocalypse : en pleine guerre mondiale. Or ce titre se veut une synthèse de toutes les analyses non seulement de Lénine, mais de tout le courant marxiste révolutionnaire d’avant 1914, dont Rosa Luxemburg, dont le « pape du marxisme » d’alors, Karl Kautsky, sur lequel pourtant Lénine tape dur.
Ces marxistes, dès 1900, avaient tenté de saisir la nouveauté de leur époque (exemple à suivre). Pour eux, le partage du monde en colonies et la marche à la guerre n’étaient pas le résultat d’une politique fortuite, ou de l’aventurisme de quelques secteurs des classes dominantes, mais une forme inévitable du capitalisme moderne. « Stade suprême » du capitalisme, l’impérialisme était même la « phase terminale » d’un système « en putréfaction », désormais profondément parasitaire. Non qu’il allait s’effondrer tout seul. Mais ce nouvel impérialisme, qui entraînait le monde vers une guerre terrifiante, ne faisait décidément plus progresser la société. Il était donc « mûr pour être remplacé par un système qui ferait bien mieux : le socialisme ». Dixit Karl Kautsky, dans sa brochure de 1907 « Socialisme et politique coloniale ».A partir de la fin du 19ème siècle, la libre concurrence capitaliste accouche via l’élimination des entreprises les plus faibles d’oligopoles, des trusts industriels d’un côté et des trusts bancaires de l’autre, qui tendent à fusionner sous la domination du capital financier. S’enchaîne alors l’étape suivante : une interpénétration inédite entre ce capital financier et l’État. Au fond, chacun a profondément besoin de l’autre. Les trusts ont besoin du soutien de l’État et l’État moderne doit s’appuyer sur les forces du capital. Et ça tombe bien : celui-ci est désormais assez riche et puissant pour dominer le personnel politique.Ce capitalisme peut avoir un certain dynamisme, mais il souffre de « disproportions » permanentes (Kautsky toujours…) : le retard, par rapport à l’industrie, de l’agriculture (ce qui provoque une crise de pénurie des matières premières et des biens alimentaires) et de la consommation (qui provoque une crise de surproduction et de sous-consommation, car le capital, exploitant ses travailleurs, ne peut les payer assez pour développer ses marchés de consommation, sauf à menacer le taux de profit). Ces limites internes au développement du capitalisme conduisent les capitalistes à repousser leurs limites géographiques en cherchant dans les pays agraires matières premières et débouchés commerciaux.Les exportations britanniques passent de 13 milliards de francs en 1870 à 35 en 1913, les allemandes de 5 à 25 (les françaises sont alors à 15 milliards). Selon Daniel Cohen[1], les exportations de marchandises sont passées de 5,1 % du PIB mondial en 1850 à 9,8 % en 1888, 11,9 % en 1913. Elles s’effondreront avec la guerre et ne retrouveront leur niveau de 1913... qu’en 1973.L’exportation des capitaux, tendance majeure du nouvel impérialismeMais le capitalisme des pays développés cherche surtout à exporter des capitaux, car il a une difficulté croissante à trouver des placements rentables dans ses bastions déjà industrialisés. Ainsi selon Suzanne Berger[2], à la veille de 1914, « entre le tiers et le quart de la richesse nationale globale [française], en dehors de la terre et de l’argent destiné à la consommation, était placé à l’étranger (…) Les investissements à l’étranger représentaient en 1907 près de 40 % de la richesse nationale des Britanniques. » Des chiffres considérables ! Avec une nuance importante : Grande-Bretagne et France exportent davantage leurs capitaux que l’Allemagne et les États-Unis, parce qu’elles disposent de grands empires, peut-être, mais surtout parce qu’elles sont moins dynamiques sur leur propre sol.Or Luxemburg et Kautsky insistent sur les conséquences profondément réactionnaires, dramatiques autant économiquement que politiquement, de cette expansion capitaliste d’alors. Elle accélère la course aux colonies (déjà en elle-même une insulte à la dignité des peuples) car le capital, quand il exporte non seulement ses produits, mais lui-même, par des investissements fixes, des infrastructures ou des prêts à des États étrangers, a d’autant plus besoin de la protection de son État national. Les capitalistes ont peur que leurs investissements n’aient pas une rentabilité garantie, soient récupérés par les classes dominantes des pays d’accueil (qui pourraient même imiter les Japonais, à leur tour s’industrialiser et devenir de nouveaux concurrents), ou pire encore par des puissances capitalistes rivales. D’où leur aspiration à la mise sous tutelle directe ou indirecte par leur État. Sont ainsi découpés en tranches des continents entiers, non seulement l’Afrique directement colonisée, mais aussi de grands empires en déclin, la Turquie, la Chine.Mais l’exportation des capitaux (à la force des armes) ne pouvait-elle permettre aux « peuples arriérés » de moderniser leurs économies et s’arracher à leur soi-disant « sauvagerie » ? Luxemburg dans L’Accumulation du capital (1912), Kautsky dans de multiples textes, exterminent impitoyablement ces préjugés et espoirs (hypocrites) qui courent jusque dans le mouvement ouvrier, dans des pages terribles sur ce qu’on appellerait aujourd’hui le « développement du sous-développement » sous l’impulsion du capital étranger.La « dette du tiers-monde », déjà…C’est que ces exportations de capitaux ont des caractéristiques assez particulières. Ainsi la France envoyait finalement peu de ses capitaux dans ses colonies : en 1914, 4 milliards de francs sur 45 investis à l’étranger, contre 25 % en Russie ! Et pour faire quoi ? Des investissements « directs » finançaient des capacités de production mais, en l’occurrence, surtout l’extraction de matières premières et des infrastructures de transport. Ces investissements sont fort utiles pour piller les richesses d’un peuple, mais n’élèvent pas la productivité générale du travail local et n’enclenchent pas une dynamique d’industrialisation et de modernisation (même pas des relations sociales, au contraire, vu l’usage d’une main-d’œuvre indigène quasi servile).Plus importants étaient les investissements « de portefeuille », comme des prêts de consortiums bancaires occidentaux à des gouvernements de pays pauvres. Des Etats empruntaient pour moderniser leurs infrastructures et s’armer. Ils exploitaient durement leur population pour rembourser, et le chemin de fer servait moins à donner accès au marché mondial à la paysannerie qu’à la faire exproprier, à développer des cultures d’exportation, ruiner les producteurs locaux submergés par les marchandises des pays industrialisés (et les prêteurs). Le défaut de paiement d’un État faible ouvrait la voie à la colonisation. C’est ainsi qu’en 1881, le défaut du bey de Tunis servit de prétexte à une démonstration de force française et au Traité du Bardo qui transforma le pays en protectorat français.Si l’État endetté était trop puissant pour se laisser dévorer, la dette publique lui servait de toute façon à renforcer l’oppression de son peuple et en même temps garantissait une poule aux œufs d’or pour les créanciers étrangers. C’est ainsi que le tsar se gava d’emprunts contractés à la Bourse de Paris. Les grandes banques françaises placèrent ces emprunts auprès de centaines de milliers de bourgeois et de petit-bourgeois. Chaque mois, le rentier français « tondait les coupons » en allant percevoir à la banque ses dividendes, sueur et sang des moujiks. En favorisant cette perfusion financière, les dirigeants politiques français s’acoquinaient avec les banquiers français et achetaient l’alliance militaire russe.Pour les marxistes, la compréhension de ces phénomènes leur permit de saisir clairement qu’il ne pouvait pas y avoir de « colonisation progressiste », alors même que le mouvement socialiste était très divisé sur cette question, entre une aile droite carrément « social-impérialiste » et une mouvance platement humaniste (comme Jaurès, qui dénonçait les crimes coloniaux mais en appelait parfois à une colonisation juste). Ces déchirures se traduisirent par les ruptures que l’on sait quand éclata la Première Guerre mondiale.1914 : une guerre impérialisteEn 1914, selon Lénine, « le partage du monde est terminé ». C’était une exagération : de gros gâteaux aiguisaient encore les rivalités. Mais les disparités technologiques et militaires étaient telles que les colonisateurs n’avaient eu guère de mal à se tailler des empires en quelques décennies... tant qu’ils ne se heurtaient pas les uns aux autres. Le partage en colonies et en « sphères d’influence » s’était fait sur des rapports de forces politiques et économiques. Or ces forces avaient changé : la France et la Grande-Bretagne, désormais en relatif déclin économique, s’étaient taillées la part du lion par rapport à des challengers devenus plus puissants (les États-Unis) ou plus dynamiques (l’Allemagne, le Japon).Comment envisager alors un nouveau repartage, sinon par la force armée ? Le spectre de la guerre généralisée hantait donc tous les peuples d’Europe. Quand elle éclata, le mouvement socialiste aussi. Une aile révolutionnaire déclara la guerre à la guerre impérialiste, la plupart des directions socialistes se rallièrent à l’union sacrée au nom de la « défense nationale ».La guerre était-elle « absolument » impérialiste ? Il est de bon ton depuis quelques années de nuancer la nuance de la nuance et de déplorer comme véritable « raison » de la guerre un enchaînement malheureux de malentendus et d’aveuglements[3].Mais les dirigeants marxistes de l’époque ne prétendirent jamais que la guerre avait été simplement commanditée par les financiers et les marchands de canons, ni perpétrée pour le seul repartage des colonies africaines. Pour faire une théorie utile de leur époque, il fallait bien saisir les évolutions essentielles, radicalement nouvelles et terriblement dangereuses, de leur époque, sans se jouer de mots ni garder des habitudes de pensée héritées de l’époque précédente. En analysant la guerre comme « impérialiste » (de pillage, de partage du monde au profit des capitalistes), ils pensaient ce qu’avait proclamé la résolution de Bâle de 1912, qui avait fait l’unanimité du congrès de l’Internationale socialiste : « la guerre à venir sera faite pour les profits des capitalistes et l’orgueil des dynasties ».Les cliques aristocratiques en Allemagne, en Autriche-Hongrie, en Russie, avaient leurs propres motivations (précipiter leur peuple dans la guerre pour consolider le trône). Ce qui n’empêcha pas la République française de pousser à la roue elle aussi ! Or, la symbiose grandissante de l’État et du capital financier joua à plein : des secteurs importants du capitalisme exigeaient le soutien militaire de leurs États pour étendre leurs sphères d’intérêt, réciproquement les sommets des États exigeaient le soutien des milieux financiers pour mener leur diplomatie agressive. Ils s’étaient liés les uns aux autres pour le pire et le pire. Les enjeux dépassaient les colonies, africaines par exemple, pas si rentables d’ailleurs : aux portes des grandes puissances, toute l’Europe centrale et l’empire ottoman étaient en décomposition. Qui allait s’y tailler des sphères d’influence telles qu’il prendrait un ascendant décisif sur ses rivaux ?Surtout, la guerre devint mondiale et totale. Plus elle durait et coûtait, plus les enjeux grimpaient pour les gouvernements. Ruinés financièrement, l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne comptaient bien, pour se relever, se payer sur la bête, dévorer les restes de l’empire turc, extorquer des réparations aux vaincus, et payer les sacrifices de leurs populations par du poison nationaliste plutôt que par des réformes sociales. L’impérialisme fit la guerre, la guerre le lui a bien rendu. Ses conséquences (et les buts de guerre des puissances) seraient fatalement bien plus impérialistes encore que ses causes.La querelle de l’« ultra-impérialisme »Il était donc impensable qu’il puisse y avoir une « bonne issue » à la guerre, une paix « sans vainqueurs ni vaincus », une paix durable entre les puissances. C’est pourtant l’idée que caressait avec de plus en plus d’insistance Karl Kautsky et bien d’autres au sein des courants de la social-démocratie qui se redécouvraient pacifistes et se désolidarisaient de leurs camarades, partisans de la « guerre jusqu’à la victoire ». Kautsky formula ainsi son idée dans L’impérialisme et la Guerre, en septembre 1914 : « L’impérialisme est-il la forme finale de la politique capitaliste mondiale ? (…) La classe capitaliste ne se suicidera pas. L’effort pour conquérir des régions agraires et réduire en esclavage leur population est trop vital pour le capitalisme pour rendre possible une opposition sérieuse de quelque groupe capitaliste que ce soit. » Mais : « Il y a un autre aspect dans l’impérialisme. L’effort de la colonisation a amené des conflits profonds entre les groupes capitalistes et a amené la guerre mondiale depuis longtemps prophétisée. Cette phase de l’impérialisme est-elle nécessaire pour la continuation du capitalisme ? (…) D’un point de vue purement économique, il n’est pas impossible que le capitalisme soit sur le point d’entrer dans une nouvelle phase, marquée par le transfert des méthodes de cartels à la politique internationale, une sorte d’ultra-impérialisme. »Kautsky ne parlait pas (pour l’instant en tout cas) d’une nouvelle phase de l’histoire du capitalisme qui eût été « non impérialiste », mais d’une nouvelle phase (pacifique, mais tout de même exploiteuse du reste du monde) de l’impérialisme lui-même. Sur la base de cette hypothèse, il rejeta toute politique révolutionnaire contre la guerre, pour lui aventuriste, pour proposer un programme de paix « démocratique » qui puisse rallier des secteurs de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie. D’où la colère de Lénine contre le « renégat » : « cet ultra-impérialisme est une ultra niaiserie » et une « mystification petite bourgeoise » !L’ultra-impérialisme américainLes traités « de paix » (allemand de Brest-Litovsk puis allié de Versailles) lui donnèrent raison. Il y avait pourtant une exception, apparente mais de taille : à la Maison Blanche. Le président Wilson présenta un programme de paix en « quatorze points » : ni annexions ni réparations, droit des nations à disposer d’elles-mêmes, Société des Nations, liberté des mers et du commerce... Le plus grand impérialisme ne proposait-il pas ainsi un ordre mondial « ultra-impérialiste » ? Une entente entre les puissances, non pour cesser de piller les pays pauvres, mais pour renoncer aux empires économiques exclusifs et à la guerre ?Cet « idéalisme wilsonien » était en fait un réalisme politique propre à l’impérialisme américain, tellement fort économiquement, et inexpugnable dans son île-continent, qu’il avait intérêt à promouvoir l’idée d’un autre type « d’empire », sans colonies et libre-échangiste (mais pas sans respect des dettes, car il ne renonça pas aux milliards de dollars de créances sur ses « alliés »). Comme le notera plus tard avec humour Léon Trotski, « l’impérialisme américain a toujours un peuple à libérer. C’est sa profession. »[4] Les gouvernements américains échouèrent cependant à imposer ce nouvel ordre mondial. Il arriva au contraire ce qu’on sait : la Dépression de 1929, la dislocation des relations économiques internationales, puis la Deuxième Guerre mondiale.Après 1945 : un monde nouveauPourtant, un certain trouble s’éveille en nous : l’« ultra niaiserie » ne se serait-elle pas finalement réalisée après 1945 ? Ne serait-ce pas l’ordre impérialiste dans lequel nous vivons encore aujourd’hui ? Les rivalités économiques entre les divers pays capitalistes n’ont certes pas disparu, et suscitent souvent tensions et coups tordus. Mais la guerre, ce n’est plus entre les pays développés, c’est pour les pauvres depuis longtemps et, semble-t-il, pour longtemps.Mais alors, pourquoi une hypothèse absurde en 1918 avait-elle pris corps en 1945 ? L’argumentation de Lénine contre Kautsky pourrait paradoxalement nous mettre sur la piste. Ainsi, dans la préface à la brochure de Boukharine L’Economie mondiale et l’impérialisme, en décembre 1915, il écrit :« Il n’y a pas trace de marxisme dans ce désir de tourner le dos à la réalité de l’impérialisme et de s’évader en rêve vers un «ultra-impérialisme» dont on ignore s’il est réalisable ou non (…) Peut-on cependant contester qu’il soit possible de «concevoir» abstraitement une phase nouvelle du capitalisme après l’impérialisme, à savoir l’ultra impérialisme ? Non (…) Seulement dans la pratique, cela signifie devenir un opportuniste, qui nie les tâches aiguës de l’actualité au nom de rêveries sur des tâches futures sans acuité (…) Il ne fait pas de doute que le développement va dans le sens d’un seul et unique trust mondial (…) Mais ce développement s’opère dans des circonstances, sur un rythme, avec des contradictions, des conflits et des bouleversements tels (et non seulement économiques, tant s’en faut, mais aussi politiques, nationaux, etc.) que, sans aucun doute, avant qu’on n’en arrive à un tel trust mondial (…), l’impérialisme devra inévitablement sauter et le capitalisme se transformera en son contraire. »L’hypothèse de Kautsky supposait des « bouleversements » extraordinaires. Qui eurent lieu. Car pour le coup il y eut bien une « époque de guerres et de révolutions », qui nulle part ne déboucha sur le socialisme (sinon des grimaces de socialisme, staliniennes ou social-démocrates). En 1945, les impérialismes japonais et allemand étaient écrasés, la France et la Grande-Bretagne plus ruinées qu’en 1918. Face aux révolutions coloniales, au « péril rouge » et au bloc soviétique, les puissances impérialistes n’avaient pas d’autre choix que de serrer les rangs et d’accepter l’hégémonie américaine, qui instaura ce que le trotskyste argentin Claudio Katz appelle un « ordre impérialiste collectif »[5], conflictuel mais coopératif, par les accords financiers et monétaires de Bretton Woods, le plan Marshall, son parapluie militaire, la protection des flux financiers par leurs marchés et le dollar, énergétiques par leur force armée.Ensuite s’engagea ou se confirma une mutation économique profonde. Pour les marxistes, ce sont les limites internes du capitalisme dans ses bases nationales développées qui avaient engendré les conflits inter-impérialistes. Marx n’en avait pas moins noté à propos du développement du capitalisme : « potentiellement illimité ». Mais à travers tant de crises et de souffrances...L’essor de la mécanisation et de la taylorisation, l’industrialisation de l’agriculture, le développement d’une consommation de masse, le nouveau rôle de l’État au sein de l’économie capitaliste, toutes ces mutations qui ont émergé à travers la crise de 1929 puis la « guerre totale » ont donné un nouveau souffle au capitalisme pendant quelques décennies. Le capitalisme des Trente Glorieuses a été beaucoup moins internationalisé que dans la période précédente, plus centré sur les pays déjà développés.Le pillage des richesses du « tiers-monde » n’avait pas cessé pour autant. Il fallait garantir des rentes néocoloniales, payer à bas prix les matières premières (ce n’est d’ailleurs qu’après la Deuxième Guerre mondiale que les pays développés commencèrent à importer vraiment leur énergie !). Toute cette période, faite de paix inter-impérialiste, de guerre froide et de guerres chaudes contre des pays pauvres, fut marquée par la fine pensée que l’on prête au secrétaire d’État américain Kissinger, dans les années 1970 : « les Américains ont compris qu’il est plus funny de botter le cul des Arabes de temps en temps que de faire des économies d’essence. » Après 1945, l’impérialisme américain eut toujours un peuple à bombarder… Ce fut en quelque sorte sa profession.« Ultra » pour les Vietnamiens, les Algériens, les Africains, les Irakiens, les Chiliens... les impérialismes le furent dans le sens le plus banal du terme après 1945.Yann Cézarddans la revue L'Anticapitaliste n° 273 (février 2016)------[1] La Mondialisation et ses ennemis, Grasset, 2004.[2] Notre première mondialisation. Leçons d’un échec oublié, Seuil/La République des idées, 2003.[3] Les Somnambules (2014) de Christopher Clark sont un modèle (par ailleurs passionnant) du genre.[4] Europe et Amérique, 1924.[5] Dans un livre très intéressant, Sous l’Empire du capital (l’impérialisme aujourd’hui), M Editeur, Québec, 2014. -
Réflexions sur le nationalisme arabe, la gauche et l’islam(Orient 21)

Itinéraire de Joseph Samaha
Dans le Liban des années 1990 et 2000, Joseph Samaha était une figure intellectuelle influente. À l’occasion du neuvième anniversaire de son décès, As-Safir vient de publier un entretien avec Nicolas Dot-Pouillard, effectué en 2006, dont voici la traduction. Si le contexte politique a changé depuis cette époque, il n’est pas inutile de relire les propos d’un intellectuel de gauche libanais préoccupé par la « question nationale » et attentif au devenir de l’islam politique.
Joseph Samaha est décédé d’une crise cardiaque le 25 février 2007 à Londres. Intellectuel de gauche, ancien militant de l’Organisation d’action communiste au Liban (OACL), se réclamant également de l’héritage du président égyptien Gamal Abdel Nasser, il dialoguait avec l’islam politique. Dans le Liban des années 1990 et 2000, Joseph Samaha était une figure intellectuelle influente, et sa plume était connue dans l’ensemble du monde arabe. Ancien rédacteur en chef du quotidien As-Safir, il fondait, à l’été 2006, en pleine guerre israélienne contre le Liban, le journal Al-Akhbar.
Le quotidien As-Safir vient de publier un entretien que nous avions eu avec lui le 17 février 2006. Le contexte politique a changé depuis l’époque de cet interview : la guerre israélienne sur le Liban est passée par là, Joseph Samaha n’avait pas encore fondé le quotidien Al-Akhbar. Bien plus, ses propos résonnent étrangement, si ce n’est avec un certain décalage : les soulèvements arabes de 2011 étaient à venir, la crise syrienne n’avait pas encore séparé les Frères musulmans et le Hezbollah — auxquels Joseph Samaha fait souvent référence. La confessionnalisation du politique n’avait pas atteint le degré actuel. Mais il n’est pas inutile d’offrir aux lecteurs la parole d’un intellectuel de gauche libanais d’abord préoccupé par la « question nationale » et la « question sociale », et attentif, à l’époque, au devenir d’un islam politique qu’il perçoit comme tout à la fois pluriel et hégémonique.
Nicolas Dot-Pouillard.
******************************************************************
1967-1995, parcours politique
J’ai d’abord été très influencé par le courant nassérien, mais j’ai eu comme un passage à vide entre 1968 et 1969, en raison de la défaite arabe de juin 1967 face à Israël. Nous avons tous été sous le choc ; c’est une période que je préfère oublier. J’étais jeune, dans la vingtaine. À partir de 1969, j’étais surtout en relation avec un courant de pensée qui n’a malheureusement pas eu beaucoup d’influence dans la gauche arabe, qui était représenté par deux penseurs syriens, Yassin Hafez et Elias Morqos1. Ces deux penseurs ont essayé d’élaborer une lecture marxiste de Nasser, ou une lecture marxisante du nationalisme arabe. Cela s’inscrivait dans un débat plus large, avec trois autres grands courants, à l’époque. Premièrement, le courant des partis communistes traditionnels dans le monde arabe, les prosoviétiques. Deuxièmement, avec les courants nationalistes arabes du parti Baas. Troisièmement, avec les mouvements d’extrême gauche, ce que l’on nommait les « nouvelles gauches », particulièrement celles qui s’appuyaient sur la résistance palestinienne, avec toutes les transformations du Mouvement des nationalistes arabes (MNA)2, la naissance du Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP) et du Front démocratique (FDLP) en 1967 et 1969, mais aussi celle de l’Organisation d’action communiste au Liban (OACL).
Ce sont Yassin Hafez et Elias Morqos qui m’ont le plus influencé. Il y avait de petits groupuscules autour d’eux, au Liban, en Irak, en Syrie, avec un courant politique qui n’a malheureusement pas réussi à s’élargir : le Parti révolutionnaire arabe des travailleurs. J’étais dans cette mouvance jusqu’en 1972. Nous étions jeunes, le Liban était en pleine ébullition, il y avait le mouvement ouvrier, le mouvement des paysans, le mouvement étudiant, les universités bougeaient beaucoup.
Puis, en 1972, je suis devenu membre de l’OACL qui était à la lisière des nouvelles gauches radicales et du nationalisme arabe. J’ai intégré la direction de cette organisation jusqu’en 1980, comme membre de son bureau politique. Mais j’avais une position critique sur la stratégie, la tactique, la manière de diriger. J’ai plusieurs fois été menacé d’exclusion par la direction. Et en 1980, j’ai été effectivement expulsé de l’OACL, notamment après une série d’articles critiquant non seulement l’organisation, mais aussi Walid Joumblatt3 et la stratégie générale du mouvement national libanais. Je me sentais toujours de gauche, mais j’essayais d’élaborer une certaine critique de la pratique de la gauche libanaise. À un certain moment, Walid Joumblatt a suggéré qu’on écrive un programme pour un nouveau Parti socialiste qui ne soit pas le Parti socialiste progressiste (PSP), un parti plus large, mais cela a échoué.
Mes désaccords politiques avec les uns et les autres n’ont jamais affecté mes relations personnelles : j’ai continué à travailler avec Fawaz Traboulsi4, j’ai toujours discuté avec Walid Joumblatt.
Puis il y a eu l’invasion israélienne de 1982. Je suis resté deux ans après 1982 à Beyrouth, ensuite j’ai quitté pour un temps le Liban pour la France. Cela a été une expérience profonde, sur le plan intellectuel et politique : j’ai lancé, avec d’autres, un hebdomadaire qui était en un sens proche de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Nous l’avions nommé « le Septième jour » (al-Yom al-sabi’)5. Cette période du milieu des années 1980 était difficile, il y avait l’occupation israélienne du Sud-Liban, mais aussi la guerre des camps entre les Palestiniens et le mouvement chiite Amal. De fait, notre journal était assez critique envers la politique syrienne au Liban, et pour cette raison, je ne pouvais pas revenir à Beyrouth.
Je suis donc resté onze ans à Paris jusqu’à mon retour au Liban en1995. Si j’ai pu le faire, c’est que les Syriens n’avaient plus de veto sur ma personne. Il y avait un contexte nouveau : les accords d’Oslo. J’étais très critique envers les accords, cela a aidé. J’ai écrit plusieurs pamphlets : sur le conflit israélo-arabe, sur le « système Rafiq Hariri »6 et la reconstruction « post-Taëf »7, envers lesquels j’ai toujours été critique.
L’islam politique et le sens de l’histoire
Je ne suis plus membre d’un parti politique : la position que j’ai choisie est celle d’un homme de gauche indépendant qui essaie, par le biais du journalisme, de l’éditorial, de la prise de position publique, d’élaborer des idées et des pistes qui à mon avis sont de gauche, mais très liées à la question nationale dans le sens où il ne suffit pas de se dire de gauche, où la gauche doit considérer que ce qui prime dans cette région, c’est l’ingérence étrangère et le devoir de s’y opposer. Et donc, plus la gauche quitte ce champ de bataille, plus elle abandonne la question nationale, plus d’autres, notamment les islamistes, viennent occuper ce terrain et gagner en influence.
Prenons deux organisations islamistes qui sont devenues, au fur et à mesure des années, emblématiques non seulement de l’islam politique, mais aussi de la résistance à Israël. En tant qu’homme de gauche attaché à la question nationale, je pense qu’ils vont, politiquement, dans le bon sens. Le Hezbollah plus que le Hamas ; mais le Hezbollah et le Hamas quand même. Nous pouvons ne pas être d’accord avec leur idéologie religieuse, désapprouver certains aspects de leur stratégie, de leur tactique, et même les slogans qu’ils portent. Mais si on regarde honnêtement la situation, si on fait un véritable état des lieux dans le monde arabe, on voit que les Arabes ont une grande attente d’un courant national, ou patriotique. Et après la défaite du courant nationaliste arabe, nous sommes nombreux à avoir cru, à un certain moment, que la gauche pouvait remplir ce vide. Mais elle ne l’a pas fait. Ce sont graduellement les islamistes qui ont rempli ce vide, avec toutes les transformations qu’ils ont connues, notamment dans les années 1990, et ce dans une conjoncture complètement transformée : fin de l’Union soviétique, fin de la guerre d’Afghanistan, politique américaine conquérante.
Les islamistes ont parfois hérité des anciens cadres qui venaient du mouvement de gauche et du mouvement nationaliste arabe ; je pense par exemple à Mounir Chafiq8, un intellectuel palestinien de la gauche du Fatah passé à l’islam politique, et je me demande : est- ce qu’il fait de l’entrisme ou est-ce qu’il est réellement convaincu de ce que qu’il dit ? Mais qu’importe, il a réussi, avec d’autres, à assurer la continuation d’un certain discours national, en Palestine, avec tous les changements qu’a connus le Hamas, au cours des années 1990, et au Liban avec le Hezbollah.
Il me semble que c’est ce courant islamiste qui a repris le discours de la libération nationale, le seul qui puisse véritablement faire bouger les masses arabes. Pour le moment, aucun autre courant n’a réussi à le faire, ni la gauche, ni les démocrates, ni les libéraux, malheureusement. Les islamistes, au Liban et en Palestine, ont enfin bénéficié d’un certain cadre démocratique, pluraliste, en négociant avec d’autres courants politiques ; je pense que cela leur a profité, et a participé aussi de leurs évolutions respectives. La démocratie doit profiter à ces courants. Chaque fois que l’occasion s’est présentée, de Nasser à un autocrate comme Saddam Hussein, les Arabes ont dit ce qu’ils voulaient vraiment : une politique qui réponde aux menaces qu’ils sentent, à cette hégémonie américaine et à cette politique de plus en plus expansionniste. En Palestine par exemple.
Nationalisme arabe, gauche et islam politique
J’ai eu des sentiments ambivalents en janvier 2006, lorsque le Hamas a gagné les élections législatives en Palestine. J’ai ressenti une certaine peur, mais au fond, j’étais satisfait que le Hamas ait gagné. Car il suffit de regarder ce que Mahmoud Abbas et la direction du Fatah ont fait du mouvement, du Fatah, de l’Autorité nationale palestinienne (ANP) : historiquement, c’est une catastrophe. Or, du simple point de vue de la question nationale, le Hamas a réussi à battre le Fatah et à porter un message nationaliste contre les renoncements de l’Autorité.
Au Liban, le cadre est différent : le discours de la gauche a été complètement éliminé par l’hégémonie du Hezbollah. Mais le Hezbollah a su lui aussi s’ouvrir et intégrer des idées qui venaient d’autres courants. C’est sa grande force. Je connais bien le Hezbollah, je connais bien ses cadres et ses dirigeants. Chaque fois que je discute avec eux, j’ai l’impression que ce sont de vrais nationalistes. Et paradoxalement, si je compare avec le passé, je me dis aussi parfois que la matière première de ce mouvement, de ses cadres, de sa direction, aurait pu être, à une autre époque, celle d’un grand mouvement patriotique et progressiste.
Il faut enfin comprendre les césures au sein du mouvement islamique. Les Frères musulmans au Koweït n’ont rien à voir avec les Frères musulmans en Irak, en Égypte, au Soudan ou en Algérie. Il n’y a pas un seul islam politique. Mais l’islam politique qui m’intéresse, c’est celui qui porte le message nationaliste autrefois porté par les nationalistes arabes et la gauche. Au fond, c’est le nationalisme arabe qui s’exprime par le biais de l’islam, idéologie désormais dominante, hégémonique. Il faut voir les contradictions : peut être qu’il y a un discours assez rétrograde, qui peut être considéré comme réactionnaire, mais le fond est progressiste et va dans une direction que je ne peux pas désapprouver.
Ceci dit, je n’aime pas les compromis idéologiques. Il faut bien comprendre ce que je dis : je considère que certains courants politiques islamistes portent le discours de libération nationale. Mais je ne crois pas non plus qu’on puisse fabriquer, comme cela, un mélange entre le nationalisme arabe, la gauche et l’islam politique. Je n’aime pas ces compromis idéologiques. Je peux être, moi, nationaliste arabe et de gauche, et parler d’un parti politique comme le Hamas : je dis dans ce cas ce que je retiens de positif et de négatif dans leur expérience. Mais pas jusqu’à prôner un mélange idéologique qui peut aussi donner n’importe quoi. Ma préoccupation est double : arabe et anti-impérialiste. Dans ce cadre, j’ai toujours un peu peur du référent purement islamique, qui ne mène à rien. La solidarité islamique, je n’y crois pas.
Prenons la période de Nasser, par exemple : le critère d’alliance était anti-impérialiste, pas culturel ou religieux. On était avec l’Inde contre le Pakistan, avec la Grèce contre la Turquie. Tout simplement parce que la Turquie et le Pakistan étaient clairement dans le camp impérialiste. L’approche qui consiste à dire : « nous, les Arabes, quels sont nos intérêts nationaux ? » est différente de : « nous, les musulmans… ». De nombreux pays arabes ont été alliés de l’Union soviétique en tant qu’Arabes, même si l’URSS représentait un modèle de société éloigné de nos aspirations. Mais, de fait, c’était l’allié des Arabes, dans un certain rapport de force mondial et international. Je ne comprend pas ces Arabes qui sont allés en Afghanistan se battre contre les Soviétiques : ils n’avaient rien à faire là-bas. Le cheikh Abdallah Al-Azzam9 était à deux pas d’Israël, et il est parti se battre au Pakistan et en Afghanistan. Une chose est de dire : « je défends les partis islamistes qui portent la cause nationale arabe », une autre est d’affirmer : « je soutiens les partis islamistes parce qu’ils sont musulmans. »
Je vois donc les choses de manière très pragmatique et réaliste. Dans la conjoncture actuelle, nous sommes dans une phase historique ou l’islam domine et va dominer la vie politique et culturelle. C’est un fait, et cela va durer des années et des années. L’islam politique est encore dans sa phase montante. Nous n’en sommes peut-être qu’au début. Yassin Hafez disait : « vous ne pourrez jamais faire l’économie de l’islam, les Arabes ne pourront jamais faire l’économie de l’islam. » Il avait raison.
La crise intellectuelle du monde arabe
Je ne crois pas à une révolution intellectuelle profonde dans l’islam, tout simplement parce que je crois pas à une révolution intellectuelle profonde, actuellement, dans le monde arabe. La crise intellectuelle frappe tout le monde. Du point de vue intellectuel, je suis pessimiste. Tout est allé déclinant. Cela vaut pour l’islam politique : je pense sincèrement que Djamal Al-Din Al-Afghani était bien meilleur que Mohammed Abdouh10, que Mohammed Abdouh était bien meilleur que Rachid Rida et que Hassan Al-Banna11, qui étaient meilleurs que Sayyid Qutb. À la fin, nous arrivons à Ayman Al-Zawahiri et à Abou Moussab Al-Zarkaoui12 ! La crise que vit l’islam est la crise de la pensée à un niveau plus général. Elle n’est pas réservée aux islamistes et elle est structurelle. Par exemple, les libéraux arabes n’ont rien à faire avec les libéraux égyptiens d’hier : pour le courant libéral, on descend historiquement de Taha Hussein à Ayman Nour13, chez les islamistes, de Al-Afghani à Al-Zawahiri. Cela vaut aussi pour la gauche et les nationalistes arabes : il y a une crise profonde dans ces courants.
Je ne dis pas que le paysage est complètement négatif. Quelque chose se passe dans certains milieux des Frères musulmans. Ils font un travail sur eux- mêmes. Dans le Hezbollah, clairement, ce travail est à l’œuvre. Dans la pensée chiite en général, il y a les écrits de Mohammed Hussein Fadlallah14, qui sont intéressants. Il y a peut-être, dans la mouvance proche des Frères musulmans, une personne comme le cheikh égyptien Youssef Al-Qardawi. On peut voir en lui un cheikh intégriste, profondément rétrograde ; mais, d’un autre point de vue, il est avancé, car il se situe à des années-lumières de certains religieux.
Parmi les Frères musulmans syriens, les choses ont un peu bougé ces dernières années : les deux ou trois derniers documents qu’ils ont rédigés étaient assez modernes. Le cheikh Rachid Ghannouchi15, le leader du mouvement Ennahda en Tunisie essaie de faire quelque chose d’intéressant, en termes de renouvellement intellectuel, de dialogue avec les laïcs. Rachid Ghannouchi était baasiste dans le passé. Il connaît la Syrie, il a une certaine sensibilité à la question arabe, une vision islamiste qui n’est pas étriquée. Mounir Chafiq essaye de développer un point de vue intéressant, Fahmi Howeidi16 également.
Mais tout cela est très épars. La région est si crispée. Je ne sais pas si on pourra opérer cette révolution culturelle nécessaire à l’intérieur de l’islam, si on reste dans l’état actuel des choses. Parce qu’il n’y a pas de classe sociale qui porte un projet historique. En cela, je reste assez marxiste.
Quelle « collectivité politique » ?
Si je choisis une étiquette, je suis à ma manière nassérien. Et de gauche. J’ai écrit plusieurs articles sur ma vision de l’expérience de Nasser, et j’ai toujours dit que, au moins, dans les grands courants de pensée, dans le monde arabe, parmi les islamistes, les libéraux, les marxistes et le courant nationaliste — le Baas notamment —, Nasser est le seul, de par son pragmatisme et son expérience, qui a pu au moins poser les bonnes questions. Le nassérisme n’est pas forcément une pensée, comme le baasisme ou le marxisme, mais c’est une expérience pratique, affective même, qui a profondément modifié le monde arabe à l’époque. Il a modifié la manière dont les Arabes se percevaient face à l’Occident. Il a obtenu des réponses plus ou moins bonnes, d’ailleurs — nous avons vu ce qui s’est passé ultérieurement en Égypte —, mais au moins, si on discute de ces grands courants dans l’histoire contemporaine du monde arabe, il est le plus proche de ce qu’il faut faire en termes d’indépendance et de contenu social. Quand je dis que je suis nassérien, c’est une manière de dire que je ne suis pas baasiste : car si nous n’arrivons pas à faire la différence entre Nasser et le Baas, nous n’arriverons jamais à comprendre ce qu’était l’expérience de Nasser dans le monde arabe.
Comment, à partir de ces questions qui ont été posées sous Nasser, penser certaines questions contemporaines qui se posent à nous ? Que voudrait dire aujourd’hui un grand mouvement de libération nationale dans le monde arabe ? Chez Nasser, c’était, dans une certaine mesure, la combinaison de trois choses : l’achat d’armes à la Tchécoslovaquie (1955), la nationalisation de la compagnie du canal de Suez (1956), et la construction du haut-barrage d’Assouan entré en service dans les années 1960. Ce fut une expérience possible au sein d’un certain ordre du monde, d’un rapport de force mondial différent que celui que nous vivons actuellement. L’idée d’un rôle important de l’État dans l’économie, celle d’un développement attentif aux intérêts des classes populaires, tout cela est complètement sorti du viseur de tout le monde, des islamistes, des libéraux, des démocrates, et même de la gauche arabe. Cette gauche parle de démocratie, de droits humains, mais la problématique du développement, la question de l’État, est sortie de son viseur. Tous ces courants, quels qu’ils soient, s’inscrivent quelque part dans la reconnaissance d’un monde unipolaire, homogène, et d’une mondialisation uniquement conçue comme libérale, économiquement parlant. Quel pourrait être le contenu social d’un mouvement de libération nationale arabe actuellement ? Je ne sais pas, car le rapport de force est très dégradé.
Ce n’est pas un hasard s’il y a une dérive, dans le monde arabe, vers un contenu culturel. Lorsque je parle des Arabes, j’aimerais en parler en termes politiques, de collectivité politique. Mais désormais c’est juste une marque culturelle, comme l’islam. Parce que l’ensemble des courants politiques dans le monde arabe sont incapables de donner un contenu politique, économique et social à leur programme. Donc, nous vivons une période de repli identitaire, en tant qu’Arabes et en tant que musulmans. Nous sommes Arabes ou nous sommes musulmans, mais jamais dans un sens politique, stratégique et économique. Juste en termes de culture. Dans le monde arabe, de la Tunisie jusqu’au Liban, il n’y a de commun que la culture. Nous avons effectivement les mêmes écrivains, les mêmes films, les mêmes sensibilités culturelles, avec les nouveaux médias, notamment télévisés. Mais ça s’arrête là. La culture, l’identité, la religion, sont les thématiques qui priment à présent. 4 mars 2016
http://orientxxi.info/magazine/reflexions-sur-le-nationalisme-arabe-la-gauche-et-l-islam,1226
-
1916-2016 : cent ans de manœuvres françaises au Moyen-Orient (1/2) A&R
La Première Guerre mondiale était encore loin d’être terminée que, déjà, les impérialismes britannique et français anticipaient la fin, et le partage, de l’Empire ottoman. En mai 1916, les diplomates Mark Sykes et François Picot, représentant respectivement les gouvernements du Royaume-Uni et de la République française, se sont mis d’accord sur une réorganisation du Proche et du Moyen-Orient. Les frontières que nous connaissons aujourd’hui en sont presque directement issues. De même que la crise qui sévit dans la région.1920-1946 : le mandat libano-syrienDes accords de 1916, puis de la conférence de San Remo en 1920, découle la création des États actuels. Les uns sont sous mandats britanniques : l’Irak, le Koweït, la Transjordanie (actuelle Jordanie) et la péninsule arabique sont confiés dans les années 1920 et 1930 à des rois, émirs et sultans locaux (comme Fayçal en Irak ou la famille Al Saoud qui fonde l’État portant son nom). La Palestine est ouverte à la colonisation sioniste. Les autres territoires forment le « mandat libano-syrien » français. La Turquie et l’Arménie sont créées. Le peuple kurde, privé d’État, est éclaté entre l’Irak, la Syrie, la Turquie et la Perse (l’actuel Iran).En 1924, la France crée la Compagnie française des pétroles (CFP), dont l’État est actionnaire à 35 %, afin de cogérer avec les occupants britanniques, et au terme d’un difficile compromis, les ressources pétrolières autrefois exploitées par l’Empire ottoman[1]. L’occupation n’est pas un long fleuve tranquille. Dès 1925, le mouvement indépendantiste fait ses premières armes, avec une insurrection populaire contre les exactions de l’armée d’occupation. Celle-ci enregistre des défaites et met deux ans à venir à bout de la « révolution syrienne », au prix de plus de 2 000 morts côté français et 10 000 côté syrien. Le camp insurgé, lui, fait face en revanche à ses premières divisions entre nationalistes et Druzes[2].
Lorsque le Liban et la Syrie prennent leur indépendance en 1946, c’est avec à leur tête des politiciens et militaires choisis, et souvent formés, par Paris, avec pour mandat la défense des intérêts français, menacés par la concurrence nord-américaine d’une part et soviétique de l’autre. Cet affaiblissement du vieil impérialisme est utilisé par les nationalistes qui veulent aller plus loin que l’indépendance formelle à laquelle leur pays a accédé.Des années 1950 aux années 1970 : les reculs de l'impérialisme français...et les limites du nationalisme arabeEn 1956, le nationaliste arabe Nasser prend le pouvoir en Égypte et nationalise le canal de Suez, dont près de la moitié appartient à des actionnaires britanniques et français. Les deux pays, ainsi que l’État d’Israël, attaquent l’Égypte. L’enjeu n’est évidemment pas tant d’indemniser les actionnaires, que de garder la main sur l’un des plus importants points de passage du pétrole en direction de l’Europe et, plus encore, d’affaiblir le mouvement anticolonialiste et tiers-mondiste. Pour la France, l’Égypte est avant tout le meilleur allié du Front de libération nationale (FLN) algérien, dont elle accueille le siège et à qui elle donne la parole à la tribune de l’ONU.Mais la résistance populaire égyptienne est déterminée. Pour les États-Unis, soutenir cette aventure guerrière de leurs alliés, ce serait donc faire définitivement basculer tout le mouvement nationaliste du côté du bloc de l’Est. Il est plus que temps de faire comprendre aux vieux impérialismes européens qu’ils ne sont plus les puissances d’avant-guerre. À l’ONU, Washington vote donc aux côtés de Moscou et de l’Égypte pour condamner l’agression et exiger le retrait des troupes.Deux ans après la débâcle de Diên Biên Phu et l’indépendance de l’Indochine, cette humiliation est une nouvelle grande victoire pour les anticolonialistes du monde entier.Porté par ce succès au retentissement planétaire, Nasser poursuit sa politique nationaliste socialisante, qui consiste non pas à mettre fin au capitalisme et à l’exploitation, mais à mieux partager les bénéfices de cette exploitation entre les classes possédantes locales et celles des pays impérialistes. Et s’il est poussé par les classes populaires à mener une politique plus redistributive, il n’a de cesse de freiner et même de réprimer toute velléité d’auto-organisation ou de contestation qui échapperait au contrôle de L’État.Logiquement, donc, la création de la « République arabe unie » (RAU), en 1958, se fait par en haut, par un accord entre gouvernements et sans le concours des travailleurs et des travailleuses. Cette éphémère tentative de mettre fin au découpage arbitraire de Sykes-Picot (même s’il ne concernait pas l’Égypte) est un échec. De 1958 à 1961, l’Égypte et la Syrie, deux pays qui n’ont pas de frontière commune, forment certes un seul et même État. Mais ce rapprochement ne met pas fin à l’existence de bourgeoisies nationales ayant des intérêts propres et il ne sert nullement à améliorer le quotidien des classes populaires. Tout au plus est-il vu comme une tentative d’assujettissement de la Syrie par Égypte.Deux ans après la fin de la RAU, en 1963, le « Parti de la résurrection arabe et socialiste », ou Baas, arrive au pouvoir en Syrie. D’inspiration nassérienne, mais sans Nasser, il se développe dans d’autres pays arabes, notamment en Irak où il prend le pouvoir en 1968. En 1970, en Syrie, Hafez el-Assad s’empare du pouvoir par la force. Neuf ans plus tard, en Irak, le Premier ministre Saddam Hussein fait de même. Ce dernier avance alors l’idée d’une fusion syro-irakienne, deux États qui contrairement à ceux qui composaient la RAU possèdent bien une frontière commune. Vue comme une tentative d’absorption, cette fusion est refusée par Assad. En 1980, les deux États sont au bord de la guerre.Finalement, le dirigeant irakien renonce et tourne son regard vers un autre voisin, l’Iran où les religieux chiites, sous la direction de l’ayatollah Khomeiny, viennent de proclamer une république islamique.Les années 1980 : les zigzags français face à « l'islam politique »et à l'axe Damas-TéhéranLa révolution iranienne de 1979 est sans doute le tournant le plus important de la fin du XXème siècle au Moyen-Orient. Pour la première fois, des religieux, portés par une révolution ouvrière et populaire, prennent et exercent le pouvoir. Certes, des mouvements religieux existent déjà depuis longtemps. La monarchie saoudienne s’appuie depuis sa naissance sur le clergé wahhabite[3], mais la famille royale est distincte de ce clergé. Le mouvement des Frères musulmans existe en Égypte depuis 1925 et il s’est diffusé dans une grande partie du monde arabe, mais il ne souhaite qu’incarner un contre-pouvoir afin de limiter les dérives « anti-islamiques » de la société, non gouverner.L’émergence des mouvements religieux prétendant au pouvoir est donc une nouveauté au début des années 1980. Elle s’explique d’une part par l’échec du mouvement ouvrier, stalinien ou social-démocrate, incapable de prendre son indépendance par rapport aux bourgeoisies dites « progressistes », et d’autre part, par celui des mouvements national-progressistes, justement menés par ces bourgeoisies qui n’ont pas vocation à rompre avec le capitalisme.L’impérialisme français, comme tous les autres, appréhende difficilement l’émergence de ce nouveau courant politique. Pour les États-Unis, la réponse est de soutenir à fond le clergé wahhabite, qui organise l’envoi de « djihadistes » en Afghanistan pour y combattre l’intervention soviétique[4]. L’appui à l’Arabie saoudite et aux combattants sunnites, fussent-ils les plus intégristes, est censé faire reculer le leadership de l’Iran chiite dans le monde musulman[5].La France, elle, tente difficilement de maintenir sa présence en Iran, arguant de sa relative neutralité pendant la révolution de 1979 et de l’accueil en exil de Khomeiny en 1978. Mais l’annulation d’importants contrats[6] et la solidarité avec les États-Unis lors de la prise d’otages de leur ambassade à Téhéran poussent Paris à refroidir et même à suspendre ses relations avec la République islamique.La crise de l’impérialisme français est aussi aggravée par la guerre civile qui touche le Liban, son dernier pré-carré, de 1975 à 1990. Le 4 septembre 1981, l’ambassadeur de France à Beyrouth est assassiné. Tout indique que l’attentat a été commandité par Damas, qui tente de déloger la France de sa position et de son rôle de « médiateur ».Le 23 octobre 1983, deux attentats frappent les casques bleus stationnés à Beyrouth. Le premier vise le quartier général des États-Unis au Liban. Le second touche le « poste Drakkar », immeuble où se trouve le 1er régiment de chasseurs parachutistes de l’armée française. 239 soldats américains et 58 soldats français trouvent la mort. Les attentats sont revendiqués par l’Organisation du djihad islamique (OJI)[7], groupe chiite lié à l’Iran et matrice du futur Hezbollah.C’est à cette époque que se forge l’axe Damas-Téhéran, encore actif aujourd’hui. L’Iran est alors en pleine guerre contre l’Irak et souffre d’un grand isolement international : les États-Unis comme l’URSS, l’Arabie saoudite comme l’Organisation de libération de la Palestine d’Arafat, soutiennent Saddam Hussein. Seule la Syrie, qui a failli entrer en guerre contre Bagdad quelque temps plus tôt, soutient la République islamique.Le Liban est un autre terrain d’entente pour les deux pays. On y trouve une importante communauté chiite, dont beaucoup de membres, marginalisés dans l’État libanais, sont prêts à suivre le modèle iranien. La création de l’OJI, puis du Amal islamique[8] et enfin du Hezbollah en 1985, marque le début de la coopération irano-syrienne.Tout au long des années 1980, l’axe Damas-Téhéran, via les forces libanaises qu’il parraine, multiplie les attaques contre les intérêts français et nord-américains, sur le sol libanais mais aussi à Paris. Du 7 décembre 1985 au 17 septembre 1986, quatorze attentats touchent la capitale française, faisant quatorze morts et plus de trois cents blessés. Organisés par le Hezbollah, ils ont pour but de faire cesser la livraison d’armes françaises à l’Irak. Mais cette agressivité n’empêche pas le maintien de relations importantes et l’organisation de négociations.Quand, en février 1982, Hafez el-Assad fait massacrer au moins 20 000 personnes à Hama, dans l’ouest de la Syrie, pour écraser une insurrection dirigée par les Frères musulmans, la France refuse de condamner la répression. L’écrasement d’un mouvement religieux avec lequel elle n’a jamais eu de rapports significatifs ne vaut pas que la France se brouille davantage encore avec la Syrie.Mitterrand, bien conscient de la nécessité de faire avec elle pour maintenir son emprise au Liban, se rend même à Damas en novembre 1984, un an après la mort des casques bleus. L’Iran reçoit en toute discrétion des armes françaises (et américaines) et les relations diplomatiques entre Paris et Téhéran reprennent totalement en 1988. En 1988, la compagnie Total est autorisée à participer à un consortium avec la Syrian Petroleum Company.En Irak, les mouvements pro-Iran deviennent des alliés de Washington alors que l’Occident se retourne contre Saddam Hussein[9]. En 1990 et 1991, la France prend sa part dans la première guerre du Golfe, sous l’égide de George Bush père.Difficile, sans doute, de trouver une cohérence à la politique moyen-orientale française des années 1980. Et pour cause ! Concurrencé de toutes parts sur ses anciens terrains protégés, l’impérialisme hexagonal doit avancer à tâtons pour maintenir tant bien que mal ses intérêts.Jean-Baptiste Pelé--------[1] En 1954, la CFP entreprend de raffiner elle-même du pétrole. Elle crée pour cela la filiale dont elle porte aujourd'hui le nom : Total.[2] Minorité religieuse, sous-branche du chiisme, principalement présente au Liban et en Syrie.[3] Mouvance très réactionnaire de l'islam sunnite.[4] C'est de ce même « djihadisme » que se réclament aujourd'hui al-Qaeda et Daesh. Il date bien des années 1980 et non des origines profondes de l'islam.[5] Le sunnisme est la branche d'environ 80 % des musulmans du monde, contre 10 à 15 % pour le chiisme ; ce dernier est ultra-majoritaire en Iran et représente la première communauté religieuse en Irak, au Liban et en Syrie.[6] Un contentieux portant sur plus d'un milliard de dollars oppose notamment la France à l'Iran concernant le développement d'un programme nucléaire en Iran. Ce programme, établi en 1974, sous le règne du Shah, avait alors toute l'approbation de l'Occident.[7] Organisation libanaise, à ne pas confondre avec ses homonymes égyptien ou palestinien.[8] Scission pro-iranienne d'Amal, parti libanais chiite fondé en 1974 par Moussa Sadr.[9] Massoud Barzani, président du Kurdistan irakien depus 2005 et Jalal Talabani, président de l'Irak de 2005 à 2014, ont ainsi accédé au pouvoir dans l'Irak sous occupation états-unienne, après avoir dirigé (en concurrence l'un avec l'autre) la résistance kurde contre Saddam Hussein durant les années 1980 et 1990. Leurs nominations respectives sont le fruit d'un compromis entre Washington et Téhéran.Note: Ce texte est issu d'un des courants du NPA: "Anticapitalisme et révolution"