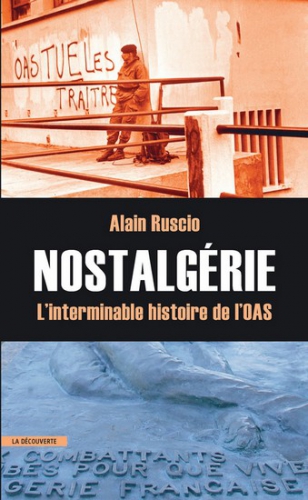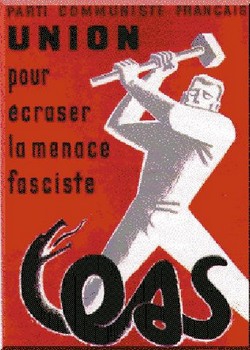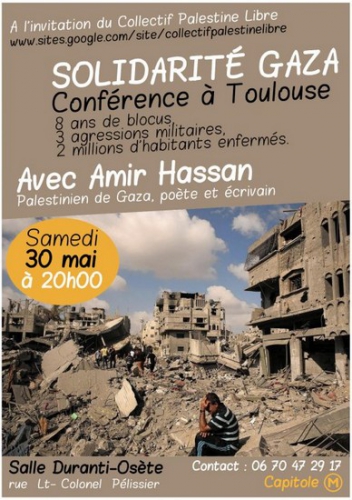Une des principales différences entre la Tunisie et les autres pays de la région arabe tient à l’existence de l’UGTT.
Mieux connaître cette organisation est d’autant plus nécessaire que l’UGTT fait souvent l’objet de jugements et affirmations péremptoires. D’où le parti pris de l’auteure : « Pour sortir de l’incantation, il nous faut délaisser quelque peu le monde des spéculations et redescendre sur terre en choisissant à cet effet un objet d’observation : l’UGTT elle-même » (p 12).
Pour tenter d’y parvenir Hèla Yousfi s’est appuyée non seulement sur des sources écrites, mais avant tout sur plusieurs dizaines de témoignages de militant-e-s. Ceux-ci sont en général membres de l’UGTT et appartiennent à différents secteurs et régions de cette organisation. Son livre permet une déconstruction des discours ne prenant en compte que certaines des multiples facettes de l’UGTT. Il débouche sur la vision d’une organisation multidimensionnelle, à la recherche permanente d’un équilibre instable entre ses aspects contradictoires.
Chercher à rendre compte en quelques pages d’un ouvrage en comportant 250 pages, nécessite de faire des choix laissant nécessairement dans l’ombre certains aspects. A chacun-e de compléter en lisant directement l’ouvrage.
La présentation qui en est faite ci-dessous est constituée de deux grandes parties que chacun-e pourra lire dans l’ordre qui le convient le mieux :
* L’une est avant tout historique ;
* L’autre cherche à présenter le caractère contradictoire de certaines des facettes de l’UGTT. Elle est surtout basée sur le début du livre et le dernier chapitre.
A propos de l’histoire de l’UGTT
L’UGTT avant l’Indépendance
Depuis sa fondation en 1946, l’UGTT ne s’est pas contenté d’une seule fonction revendicative mais s’est toujours simultanément « nettement engagée dans l’action politique » pour l’Indépendance, où elle a joué un rôle de premier plan (p11).
L’UGTT entre 1956 et 2011
Pendant toute cette période ont existé au sein de l’UGTT :
* d’une part « un courant de soumission au pouvoir pouvant aller jusqu’à la quasi-intégration dans l’appareil d’Etat »,
* d’autre part « un courant de résistance au pouvoir » contrôlant certaines structures intermédiaires et « qui prend le dessus en temps de crise » (p 56).
Cette dualité a rendu possible « aux différents mouvements sociaux, malgré la proximité que la bureaucratie syndicale a entretenu avec le parti unique, de régulièrement trouver un appui structurel et politique auprès de l’UGTT ».
La permanence de cet équilibre instable explique en grande partie pourquoi les crises internes de l’UGTT n’ont pas débouché sur de réelles scissions.
Du 17 décembre 2010 au 14 janvier 2011
Ce chapitre est étayé par un grand nombre d’entretiens généralement réalisés en janvier et février 2011. Il ressort de ce ceux-ci les éléments suivants :
* « le mouvement protestataire est à ses débuts complètement spontané et sans leadership » (p 62),
* « l’UGTT a accueilli et protégé le mouvement » (pp 62-64),
* les syndicalistes ont « encadré » le mouvement (pp 65-70).
Le soulèvement du bassin minier en 2008 est vu comme une « répétition générale » de celui de 2010-2011 (pp 77-79).
L’auteure se livre ensuite à une analyse fouillée des débats ayant traversé l’UGTT pendant cette période (pp 79-97). Si nombre de syndicalistes « se sont empressés de rejoindre le mouvement populaire, les bureaux régionaux et le Bureau exécutif ont adopté une attitude attentiste, voire hostile au soutien du soulèvement » en se démarquant clairement des slogans dénonçant le pouvoir. (p81)
La « tendance radicale » de l’UGTT anticipe sur le fait que :
* d’une part la « tendance réformiste » représentée par le Bureau exécutif « allait éviter la confrontation avec le pouvoir » et rechercher un compromis avec lui,
* d’autre part que si il existe « la pression nécessaire » pour faire basculer les rapports de forces en faveur du peuple, « la centrale finira par se plier aux revendications populaires » (p90).
Progressivement, une série de structures intermédiaires de l’UGTT s’émancipent de la direction centrale. Elles appellent notamment à la grève sans son accord préalable et sans respecter l’obligation légale d’un préavis de 10 jours (p86). Pour tenter de sauvegarder sa « capacité de dialogue avec le pouvoir », le Bureau exécutif n’a pas d’autre choix que de couvrir « toutes les décisions prises à une échelle locale et/ou régionale » (pp88-89).
Après des dizaines d’années d’omnipotence de la direction centrale de l’UGTT, on assiste à la préfiguration de nouvelles relations entre celle-ci et les structures intermédiaires (p98).
Du 14 janvier 2011 aux élections d’octobre 2011
Le 17 janvier, la direction de l’UGTT désigne trois représentants au gouvernement. Celui-ci est présidé par l’ancien Premier ministre de Ben Ali (p 102), ce qui provoque la colère de la population et de la base de l’UGTT.
Soucieuse de « préserver le consensus et de protéger l’unité de l’organisation » (p107), l’UGTT « fait volte-face » (p106) : elle fait démissionner ses trois ministres dès le lendemain, et soutient désormais les mobilisations (pp102, 106 et 108).
Simultanément, l’UGTT joue un rôle clé dans la mise en place d’un « Conseil national de protection de la révolution (CNPR) » (pp102, 110-112). Le CNPR s’appuie sur des comités locaux dans tout le territoire tunisien dans lesquels certains militants voient le possible embryon d’un « parlement représentatif des forces révolutionnaires » (p116).
Mais le CNPR ne se transforme pas en un pouvoir alternatif : contestant la légitimité démocratique du gouvernement, c’est néanmoins à ce dernier que le CNPR demande de lui reconnaître légalement un pouvoir décisionnel. Mais « le gouvernement s’oppose vivement à cette demande et ne veut concéder au CNPR qu’un rôle consultatif » (p111).
Le 27 février, l’ancien Premier ministre de Ben Ali quitte enfin le pouvoir. Son remplaçant, Beji Caïd Essebsi, crée une « Haute instance » qui « a pour objectif de dépasser l’opposition entre le CNPR et le gouvernement » (p113) :
* La Haute instance n’a qu’un pouvoir consultatif et propositionnel en matière de loi électorale et d’organisation des élections.
* « Le gouvernement reste ainsi le seul pouvoir exécutif et décisionnel ».
Aux côtés de l’UGTT, sont représentées dans la « Haute instance » les principales organisations politiques et associatives du pays (p103). Ne revendiquant pas le pouvoir pour elle-même, l’UGTT joue néanmoins « un rôle politique de premier plan » (p103) consistant à « construire des consensus entre les différentes forces politiques et sociales » (p 105).
Dans les témoignages recueillis, le rôle de l’UGTT était auparavant souvent présenté comme celui d’un « pouvoir » ou d’un « contre-pouvoir » (p108). L’accent est désormais mis sur la notion « d’autonomie » ou de « distance égale de tous les partis politiques et surtout du pouvoir, (...) de force d’équilibre, de superviseur qui contrôle l’action du gouvernement » (pp 108-109).
Pour certains militants, la perception de l’UGTT a évolué « d’un acteur clé de la révolution à celle d’un acteur central du maintien du régime politique et économique » (p116).
Au final, la direction de l’UGTT a poursuivi simultanément ou successivement de multiples objectifs parfois contradictoires (pp118-119) :
* assurer simultanément la démocratisation du pays et la continuité des institutions,
* refuser un choc frontal avec le pouvoir en place dans le but de conserver son propre pouvoir de négociation avec celui-ci,
* utiliser sa proximité avec les mouvements sociaux pour faire pression sur le gouvernement et les grands choix politiques,
* ne pas jouer pour autant un rôle de parti politique mais favoriser la négociation et la construction de consensus entre les différentes forces politiques et sociales.
Depuis son origine, le rôle syndical de l’UGTT a toujours été entremêlé avec son rôle politique (p141).
Du temps de la dictature, l’UGTT était même « le seul espace où les opposants politiques pouvaient s’exprimer » (p142). C’est notamment pour cette raison que la plupart des militants estimaient que l’UGTT devait s’interdire « d’entrer dans la bataille politicienne, car il y a toutes les tendances politiques au sein de l’UGTT, et que cela pourrait être dangereux » (p143).
La grande différence depuis 2011 est que désormais les partis politiques « n’ont en principe plus besoin de l’espace syndical pour exister » (p145).
Les principaux enjeux du congrès national de décembre 2011
L’héritage de la période passée comporte notamment :
* la compromission du Bureau exécutif avec le régime de Ben Ali au sujet de laquelle le Secrétaire général sortant fera une autocritique lors du congrès (pp167-168),
* la corruption et le clientélisme interne (pp153-155, 171-172),
* une tradition de votes dans les congrès reposant non pas sur les programmes mais sur des alliances entre réseaux sectoriels ou régionaux et courants politiques (170-171).
La volonté d’un grand nombre de militant-e-s de l’UGTT est de remettre en cause le caractère hiérarchisé et centralisé de la centrale syndicale, se traduisant par le pouvoir hégémonique du Secrétaire général et du Bureau exécutif. C’est notamment sur ce dernier que repose le droit de signer le préavis de 10 jours rendant légale une grève, ainsi que la nomination des permanents syndicaux (pp 151-152). Cette préoccupation prend appui sur « l’épisode révolutionnaire qui a poussé certaines Unions régionales et Fédérations à prendre leurs décisions de manière autonome sans attendre l’approbation du BE » (p155).
En sens inverse, deux mois après la victoire électorale d’Ennahdha, « le contexte de crise politique et les différentes campagnes qui ont pris l’UGTT pour cible ont renforcé les réactions les plus défensives afin de préserver l’organisation au dépens des impératifs de restructuration interne et/ou les défis socio-économiques » (p184).
A l’intersection de ces deux préoccupations, il avait été décidé dans la foulée dans la foulée du 14 janvier que le non-renouvellement du mandat des membres du BE qui s’étaient compromis avec le pouvoir de Ben Ali s’opèrerait en douceur. Il suffisait pour cela de ne pas remettre en cause les dispositions statutaires interdisant plus de deux mandats successifs au BE (article 10), contrairement à ce que cherchait à faire le BE sortant juste un an auparavant (pp 131-138, 155, 172-173, 179). (1)
En final, un peu moins d’un an après le 14 janvier 2011, "deux préoccupations majeures animent la plupart des congressistes interviewés :
* Quel rôle l’UGTT doit-elle jouer dans la transition politique et quelle place doit-elle occuper dans le nouveau champ politique et syndical post-électoral ?
* Sera-t-elle capable de faire évoluer ses structures, ses formes historiques de lutte pour s’adapter aux nouvelles réalités économiques et soutenir la processus démocratique dans le pays ?" (p152).
Un des enjeux politiques est le refus que l’UGTT soit « instrumentalisée » par les partis politiques. « Même si notre mission est autant politique que sociale, on doit rester à égale distance de tous les partis politiques » expliquent nombre de syndicalistes (pp159-162 et 169). Parmi les défis organisationnels à relever figurent l’implantation dans le secteur privé (p156), la participation des femmes dans les instances de décision (p157-158) et la faible syndicalisation des jeunes (p158).
Les principales décisions du congrès de décembre 2011
Le congrès a été polarisé par l’élection du Bureau exécutif (pp 175-178).
La principale différence avec le passé a été que la volonté politique de maintenir l’unité de la centrale a été « omniprésente » dans la constitution des listes en compétition. Elle l’a emporté sur « les considérations régionalistes et clientélistes qui avaient souvent pris le pas sur les autres enjeux » dans les congrès précédents (p178).
Aucun membre du nouveau BE ne représente un courant politique en tant que tel. (2)
Dans la continuité avec le passé figurent :
* le poids prépondérant du BE sortant sur le déroulement du congrès (p181),
* l’élection de la liste reposant sur le consensus entre le plus grand nombre de régions, de secteurs et de sensibilités politiques,
* la présence dans cette liste de trois des quatre membres du BE sortant ayant le droit de se représenter,
* la consécration du « pouvoir des grands secteurs de la fonction publique au sein de l’UGTT, et notamment l’Enseignement et la Santé » (p179),
* le fait qu’aucune femme n’ait élue élue au BE (pp157-158, 178, 180).
L’UGTT face au pouvoir islamiste (2012-2013)
Ennahdha, qui commence à diriger le gouvernement au moment même où se tient le congrès de l’UGTT, se lance dès la mi-février 2012 dans une attaque frontale contre la centrale syndicale. Cherchant à « coopter les différents réseaux de l’ancien régime au niveau de l’appareil étatique » (p216), Ennahdha se retrouve par ailleurs en concurrence directe sur ce terrain avec Nidaa Tounes que Beji Caïd Essebsi met en place au premier semestre 2012 dans le but de revenir au pouvoir lors des élections suivantes.
Face à cette « bipolarisation de la vie politique et les polémiques visant l’UGTT, sa direction n’a pas voulu participer à la mise en place d’une alternative politique aux deux pôles dominants. En revanche, elle a lancé le 18 juin 2012 une ’’initiative politique’’ visant à recréer un consensus entre les forces politiques, le gouvernement et la société civile pour s’entendre sur les grandes questions suscitant des divergences » (p217).
Le rôle de « médiateur politique » (p218) que cherche à jouer la direction de l’UGTT contribue à « reléguer la question sociale au second plan » (p204).
Au deuxième semestre 2012, la tentative de l’UGTT de trouver une solution consensuelle échoue, et l’offensive des hommes de main islamistes continue de plus belle avec notamment :
* l’attaque du siège national de l’UGTT le 4 décembre 2012 (p188),
* l’assassinat d’un premier dirigeant du Front populaire le 6 février 2013, puis d’un second le 25 juillet qui plonge la Tunisie « dans une crise politique grave ouvrant la voie à une nouvelle période de contestation de la légitimité des institutions » (p219).
Dans ce cadre, « l’UGTT multiplie les rencontres pour chercher une issue à la crise.
Elle ne se présente plus exclusivement comme une plateforme de dialogue mais comme une force de proposition ». En compagnie de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme, l’Ordre national des avocats et le syndicat patronal (UTICA), l’UGTT lance le 25 octobre un cadre de dialogue national auquel participent 21 des partis représentés à l’Assemblée. Un consensus se dégage entre les participants au dialogue pour le remplacement du gouvernement en place par un gouvernement provisoire ne dépendant pas des différents partis. Chargé de gérer les affaires courantes, celui-ci doit avant tout faire voter par l’Assemblée la nouvelle Constitution, puis organiser des élections législatives et présidentielles (pp 220-231).
* En acceptant de démissionner du gouvernement, Ennahdha a évité d’en être éjecté durablement comme en Egypte.
* Nidaa Tounès de son côté estime avoir toutes les chances de parvenir au pouvoir après les élections prévues en 2014.
* L’UGTT a « renforcé sa place d’acteur incontournable du champ politique tunisien » (p231).
Mais « le fait que le dialogue national ait concentré le débat exclusivement sur les enjeux politiques » entraine un clivage « qui traverse toutes les structures de l’UGTT autour de la place à accorder aux questions sociales ». La distance se creuse d’après l’auteure entre :
* « les partisans d’une action limitée, négociée à petits pas, faisant reculer progressivement le pouvoir politique sans pour autant le renverser »,
* « ceux qui, parce que la crise économique s’approfondit, parce qu’ils ont confiance dans le mouvement social, parce qu’ils croient de moins en moins qu’on peut négocier avec le pouvoir en place, veulent une attitude plus ferme qui peut mener à des actes de rupture » (p232).
Le caractère contradictoire de chacune des facettes de l’UGTT
Pour des raisons qui sont explicitées dans en note (3), je me suis autorisé à ajouter entre parenthèses le terme « revendicatif » à celui de « syndical » dans deux des extraits présentés dans le sous-paragraphe qui suit.
Rôle revendicatif et rôle politique
« L’UGTT ne mobilise pas les syndicalistes seulement pour la défense de leurs intérêts professionnels. Elle a toujours été et continue à être le lieu d’une action politique beaucoup plus large qui vise à articuler revendications socio-économiques, et libertés politiques individuelles et collectives » (p 233).
Cette double fonction remonte à l’époque coloniale où l’UGTT était « nettement engagée dans l’action politique » pour l’Indépendance (p11).
Après celle-ci, l’UGTT a été de plus pendant plus d’un demi-siècle « le seul espace d’action collective organisée en Tunisie qui a réussi tant bien que mal à résister aux tentatives du régime autoritaire de réduire à néant toute résistance dans le pays ». (p 16)
Pour ces raisons, « l’UGTT est à la fois, et de manière indissociable, un mouvement syndical (revendicatif) et une organisation qui prétend à une mission politique et nationale » (pp 233-234).
« Par moments ce sont les considérations politiques nationales qui s’expriment, et à d’autres moments, c’est l’aspect syndical (revendicatif) qui est mis en avant » (p234).
Pour une partie au moins de ses membres, l’UGTT doit jouer un rôle de « contre-pouvoir » (p16) mais « ne vise pas la prise de pouvoir » (p11).
En final, l’UGTT se comporte « ni comme une force politique destinée à prendre le pouvoir, ni comme un syndicat révolutionnaire capable de remettre radicalement en cause les choix économiques et sociaux adoptés par les élites au pouvoir. L’ampleur de son action politique lui échappe parfois, mais elle a montré qu’elle n’est pas et ne veut pas devenir un parti politique » (p235).
Entre résistance et soumission
Il a toujours existé dans l’UGTT « un courant de soumission au pouvoir pouvant aller jusqu’à la quasi-intégration dans l’appareil d’Etat », mais simultanément on y a toujours trouvé « un courant de résistance au pouvoir qui prend le dessus en temps de crise ». (p15)
Dans ce cadre, l’UGTT a été avant 2011 à la fois « un refuge pour les mouvements sociaux, un espace de résistance (...) contre l’hégémonie exercée par le parti unique » et « un lieu de négociation permanente de l’équilibre tant politique que social ». (p 16)
Entre affrontement et volonté de négociation
« Tantôt ce sont des réactions offensives qui s’expriment et qui vont jusqu’à l’affrontement et parfois c’est la logique de médiations et de négociation qui l’emporte » (p234).
L’action de l’UGTT repose sur « sa capacité à construire des compromis entre les défenseurs d’une rupture radicale avec l’ancien régime et les partisans d’une orientation réformatrice » (p235).
« L’UGTT, en arrachant quelques concessions de la classe dirigeante au profit du mouvement protestataire, évite le risque d’un affrontement directe entre les anciennes et les nouvelles forces politiques et neutralise, selon les plus critiques, le potentiel d’une rupture radicale avec le régime » (p235).
L’UGTT revendique une identité de « »force d’équilibre« entendue dans le sens d’une force à la fois de pression et de négociation » dont une des constantes est « le refus de l’affrontement direct avec le gouvernement » (p235).
« Dès lors, il n’est pas étonnant de voir l’UGTT affirmer de plus en plus nettement que seules des solutions consensuelles entre les différentes forces politiques et sociales peuvent sortir le pays de la crise » (p235).
« L’UGTT affirme sa défense des revendications sociales, mais sans jamais oublier de faire pression pour établir un calendrier électoral » (p234). « Sa proximité des mouvements sociaux lui donne les moyens d’exercer une pression sur les choix électoraux et les grandes décisions politique » (p235).
« Dialogue national » et base sociale de l’UGTT
Pendant le deuxième semestre 2013, l’UGTT a joué un rôle décisif dans la mise en place d’une structure de dialogue incluant notamment le syndicat patronal.
« L’UGT, qui accepte de faire un un front uni avec le patronat pour pouvoir trouver un équilibre négocié avec les différentes forces politiques et sociales, prend le risque de voir sa capacité d’action sociale s’affaiblir. Pire encore, elle se montre disposée comme par le passé à accepter une nouvelle vague de libéralisation économique proposée par les bailleurs de fonds moyennant des augmentations salariales dérisoires pour ses membres » (p237).
Pour l’auteure le risque existe pour l’UGTT de se couper de forces attendant « une attitude plus ferme de la part de l’UGTT ». Celles-ci estiment qu’avec l’approfondissement de la crise économique, il est « de moins en moins possible de négocier avec les élites économiques et politiques en place » et placent leur confiance dans les mouvements sociaux (p238).
Entre mode pyramidal de décision et système de pressions sur la direction
* Aux lendemains de l’Indépendance, un « rapport organique » existait entre l’Etat et l’UGTT : le Président Bourguiba pouvait changer les secrétaires généraux, « les appeler aux commandes et les renvoyer comme il le fait pour ses ministres » (p37). Ce type de fonctionnement a été calqué par la direction nationale de l’UGTT sur les structures intermédiaires. Il se traduit par l’hégémonie du Bureau exécutif et du secrétaire général sur l’ensemble de l’organisation (p152).
* Tout un système de pression sur la direction s’est mis en place pour faire contrepoids à la concentration du pouvoir entre les mains de la direction centrale de l’UGTT.
Il s’est notamment affirmé à partir de 2008 dans le cadre de la lutte bassin minier. Il a fini par imposer sa volonté dans les semaines qui ont précédé le 14 janvier.
Dans le chapitre centré sur ces deux épisodes, le mot « pression » revient à très nombreuses reprises dans les entretiens réalisés.
Lors de la lutte du bassin minier, « les syndicalistes ont (...) fait pression sur les instances régionales de l’UGTT pour intervenir dans la libération des prisonniers ». « Nous avons fait pression sur le Bureau exécutif pour intervenir auprès du gouverneur » (p69). « Les syndicalistes de base ont imposé, grâce à leur pression, à certaines Unions régionales (...) ou à des secteurs (...) de soutenir le mouvement du bassin minier » (p77). A Redeyef, « il y a eu un changement grâce à la pression syndicale à l’intérieur des syndicats de base et aussi grâce à la pression qui vient de l’étranger, des délégations étrangères. Cette pression qui vient de l’intérieur et de l’extérieur a permis enfin de changer la position officielle de la direction syndicale... » (p78). Le secrétaire général Jrad « qui n’a pas l’habitude de céder a enfin cédé pour éviter l’implosion de l’UGTT (...) sous la pression intérieure » (p79).
« Nous faisions des rassemblements devant l’UGTT pour faire pression, et le Bureau régional a négocié avec le gouverneur pour les prisonniers » (p82).
Il en va de même après le 17 décembre 2010. Hélà Yousfi écrit à ce propos : « Cette pression engendre une crise au sein de l’organisation qui a pour résultat immédiat une rupture dans les circuits de décision formels classiques et une transgression de la hiérarchie syndicale », comme par exemple l’accord préalable du Bureau exécutif pour qu’une grève soit légale (p86).
« Ce genre de décision n’aurait pas eu lieu » si préalablement « les structures de base et intermédiaires n’avaient pas fait pression » (p87) explique une militante.
La direction de la centrale agit de façon comparable.. mais dans le sens inverse : elle « exerce une pression forte sur toutes les structures de manière à réduire leur souffle militant » (p87).
« Cette dynamique de pression/négociation (...) a largement influencé aussi bien l’issue du mouvement de Redeyef en 2008 que celui de Sidi Bouzid ... » (p90).
« Généralement quand la direction de la centrale voit que les différentes structures régionales et sectorielles adoptent (des) revendications, il y a une sorte de pression qui s’exerce sur le Bureau exécutif qui va finalement les adopter » (p94). « Sous la pression de ses structures, elle est obligée de suivre le mouvement » (p95).
Entre clientélisme et résistance à la direction
* Le clientélisme en vigueur au niveau de l’Etat avant 2011 avait trouvé son prolongement au sein de l’UGTT. « Le cadre syndical détaché auprès de la Centrale échappait aux contraintes du travail et accédait à un statut social qui lui procurait une certaine reconnaissance. Il devait alors agir en fonction de ce que le Bureau exécutif attendait de lui ». « Ce détachement pouvait être retiré au cours du mandat si le cadre décevait ou entrait en conflit avec la direction » (p153). Plusieurs témoignages figurant dans le livre donnent des exemples d’avantages matériels attribués aux permanents syndicaux (pp 153-155).
* Au sein de l’UGTT, ont toujours existé des militant-e-s refusant de prêter allégeance à la direction. Cette situation s’est notamment exprimée par l’opposition à la suppression de l’article 10 des statuts interdisant plus de deux mandats successifs au Bureau exécutif.
Cette volonté s’est accentuée lors du processus ayant précédé le 14 janvier 2011. « L’épisode révolutionnaire qui a poussé certaines Unions régionales et Fédérations à prendre leurs décisions de manière autonome sans attendre l’approbation du Bureau exécutif constitue un précédent intéressant qui préfigure de nouvelles relations entre les structures intermédiaires et et la direction central pouvant neutraliser la dérive hégémonique du Bureau exécutif » (p155).
Entre attachement formel aux règles et arrangements de couloirs
* « Tout est conçu au Congrès pour qu’aucun manquement à la procédure démocratique ne soit possible. Cette démocratie formelle et pointilleuse est la garantie d’une légitimité, rend incontestables les décisions prises par le Congrès et assure une marge de crédibilité au Bureau exécutif » (p173).
* Mais simultanément « les votes ne sont pas orientés par les programmes proposés mais plutôt par les tractations politiques et les alliances » (pp 170-171). « Tous les moyens sont bons, de la cooptation des délégués moyennant des privilèges, à la manipulation des adhésions pour conquérir le pouvoir » (p171).
Entre syndicalisation massive des femmes, et masculinité des structures
« Si les femmes sont bien présentes à hauteur de 47 % dans les structures de base et dans les luttes syndicales, elles demeurent absentes des postes de direction syndicale. En effet, le fait de devenir membre du BE est verrouillé par des conditions de nombre de mandats antérieurs réalisés aux différents niveaux (local, régional, fédéral) de l’organisation. Une condition qui réduit le nombre de femmes éligibles et empêche leur arrivée au niveau de la direction centrale » (p157).
Un débat est en cours qui pourrait déboucher sur un système de quotas au sein de l’UGTT, y compris au Bureau exécutif.
Multiplicité des forces centrifuges et maintien d’un cadre collectif
Une des explications proposée au fait que l’UGTT est parvenue à ne pas exploser en vol malgré les multiples contradictions qui la traverse est la volonté partagée de construire des consensus internes sur la base des rapports de forces existant à un moment donné :
« L’UGTT, par sa composition et sa sociologie, a toujours été tributaire d’un équilibre souvent précaire entre des intérêts sectoriels, de considérations régionales et des enjeux politiques. De ce fait, ce n’est pas tant le clivage idéologique ou partisan qui oriente les décisions de la Centrale que sa capacité à construire des consensus entre des groupes aux intérêts divergents ». « C’est grâce à l’institutionnalisation du consensus comme mécanisme privilégié de régulation du conflit que l’UGTT a pu maintenir sa cohésion interne tout en conservant son pouvoir. Dès lors, les tergiversations et les tensions qui ont marqué la trajectoire de l’UGTT prennent tout leur sens » (p236).
Notes :
1. Note AB : Un responsable intermédiaire de l’UGTT me confie à l’époque « Le secrétaire général reste en place jusqu’au prochain congrès, mais nous l’avons mis sous camisole ».
2. Note AB : Les membres du nouveau BE ont des affinités politiques diverses, actuelles ou passées, réelles ou supposées. Seule une minorité d’entre eux est actuellement membre d’un parti politique, mais aucun d’entre eux ne représente celui-ci en tant que tel.
Jilani Hammami, dirigeant connu du PCOT n’ayant plus de responsabilités syndicales depuis des années, revendiquait une place dans le nouveau BE au nom de son parti (p176). Il a été écarté de la liste en situation de l’emporter. Hfaiedh Hfaiedh, pourtant tête de liste du même parti aux législatives deux mois plus tôt, a par contre été inclus sans aucun problème en tant que secrétaire général du syndicat de l’enseignement primaire.
3. Note AB : Pour moi, le fait que l’UGTT ne se limite pas à la seule action revendicative ne constitue pas réellement une spécificité tunisienne. Nombreux sont les syndicalistes de part le monde qui considèrent qu’ils sont chargés d’une « double besogne » : la défense des intérêts immédiats des travailleurs ET « la transformation sociale ».
Ce débat traverse périodiquement le syndicalisme depuis ses origines. Il se conjugue avec celui, tout aussi passionné, de savoir si cette deuxième dimension doit s’effectuer graduellement au sein du capitalisme, ou dans le cadre d’une rupture avec celui-ci.