Professeur des universités, historien et spécialiste du monde arabo-musulman, Jean-Pierre Filiu est l'un des meilleurs experts de la Syrie. “Nous sommes à Alep dans une situation de surenchère milicienne”, estime-t-il. “Désormais, le dernier mot revient sur place à des milices qui n'obéissent à personne.”
Révolutions Arabes - Page 54
-
Jean-Pierre Filiu (Télérama)
-
Flux et reflux de la vague révolutionnaire (NPA)
L’explosion socio-politique qui a été appelée « Printemps arabe » a été une réaction en chaîne sur trois mois reprenant partout dans la région, les mots d’ordre de liberté, justice sociale et dignité.
L’immolation par le feu de Mohamed Bouazizi le 17 décembre 2010 à Sidi Bouzid en Tunisie, et le soulèvement qui a suivi, ont obtenu la fuite du dictateur Ben Ali le 14 janvier 2011. Les manifestations qui ont commencé le 25 janvier en Égypte ont abouti au départ de Moubarak le 11 février . Des mouvements de masse se sont levés en Libye, au Yémen, à Bahreïn, au Maroc, en Jordanie. Le 15 mars 2011, le peuple syrien entrait à son tour en insurrection.
Les dictateurs étaient chassés en Tunisie, en Égypte, bientôt en Libye (octobre 2011) et plus tard au Yémen (2013), mais dans ces deux derniers pays au prix de la transformation du soulèvement en insurrection armée et de l’installation du chaos, comme en Syrie où Bachar a réussi de justesse à sauver son régime. La répression sanglante avec l’aide de l’Arabie saoudite est venue à bout du soulèvement à Bahreïn, tandis qu’en Jordanie, au Maroc et à Oman, les pouvoirs ont pris le dessus en combinant répression, petites ouvertures et légitimité encore partielle de ces monarchies.
L’ancien et le nouveau
Ces soulèvements ont surpris le monde, pourtant leurs combustibles s’accumulaient les années précédentes : la grande vague néolibérale mondiale qui détruit les tissus sociaux, combinée dans cette région au népotisme et à l’accaparement de tous les pouvoirs par des clans familiaux, quelle que soit la forme des régimes politiques. Cela alors qu’une jeunesse très nombreuse et massivement scolarisée est privée de toute perspective : ni emplois stables ni libertés.
Des prémices s’étaient manifestées, en particulier en Tunisie et en Égypte : le soulèvement du bassin minier de Gafsa dans le sud tunisien en 2008 ; les grèves du textile (Mahalla 2006) et des impôts fonciers (2007) en Égypte. Particulièrement en Tunisie, des traditions de syndicalisme, d’actions communes entre courants politiques existaient, et ont pu servir de point d’appui à certains moments.
Mais pour l’essentiel les soulèvements de la région ont inventé de nouvelles formes d’action et d’auto-organisation dans l’occupation des places publiques, qui ont ensuite été réinvesties par des mouvements sociaux dans le monde entier. Ces expériences n’ont cependant pas été jusqu’à créer des formes de double pouvoir durables pour la gestion de la société, sauf en Syrie.
Ici, la dynamique des affrontements et la formation de zones libérées du régime s’est traduite par des expériences de comités locaux et coordinations régionales, qui ont concentré la haine de l’appareil totalitaire de Bachar el-Assad. Mais elles n’ont pas réussi à se centraliser, laissant la représentation à l’étranger de l’opposition syrienne à des coalitions de forces non légitimes sur le terrain.Résistance de la contre-révolution
Les divers foyers de la contre-révolution : régimes locaux, puissances régionales ou mondiales, mouvements politico-religieux, se sont rapidement réorganisés pour désorienter, récupérer ou écraser les soulèvements populaires, marquant des points très importants. En Tunisie, le nouveau pouvoir a d’abord été repris par des notables de l’ancien régime, qui, face aux coup de boutoir du mouvement de masse, a dû accorder des droits démocratiques importants. En Égypte, l’armée a également été forcée par les mobilisations populaires à se mettre provisoirement en retrait. Dans ces deux pays, les premières élections entre fin 2011 et juin 2012 ont donné la première place aux courants de l’islam politique déjà très implantés dans la population, s’appuyant sur la religiosité de la population et des réseaux d’entraide, et jouissant du prestige d’avoir été longtemps réprimés.
Ces courants ont cependant commencé à accaparer les pouvoirs et tenté d’imposer des mesures réactionnaires, contre les droits des femmes, etc. tout en cherchant de bonnes relations avec les institutions internationales, et prétendant poursuivre une orientation néolibérale. La répression des mouvements sociaux et partis politiques de gauche par la police et par les attentats (comme les assassinats des députés du Front Populaire Chokri Belaid et Mohamed Brahmi en Tunisie) a provoqué de nouveau d’immenses mouvements de colère sans alternative politique nouvelle.
La réaction au pouvoir
Les anciens régimes ont alors trouvé l’espace pour reprendre le pouvoir. En Égypte sous couvert de répudier le Président de la République Frères musulmans Mohamed Morsi à la demande du mouvement populaire, le maréchal Sissi a mené un véritable coup d’État, qui en quelques mois, a supprimé toutes les libertés et abouti maintenant à une situation pire que celle sous Moubarak. En Tunisie, les islamistes d’Ennahdha effrayés du sort réservé à leurs cousins égyptiens, ont passé un pacte avec les notables de l’ancien régime qui a débouché sur la mise en place de gouvernements réactionnaires et néolibéraux. Leur politique a été en partie freinée par un mouvement populaire plus fort qu’ailleurs, en particulier du fait de la puissance de l’UGTT, la seule centrale syndicale réellement existante en Tunisie.
En Libye, en Syrie, au Yémen, les situations sont devenues de plus en plus chaotiques et les guerres dominent les mouvements sociaux avec la radicalisation des courants confessionnels des diverses tendances de l’islam, dans lesquels s’insèrent cyniquement les appareils d’État des dictatures.Une vague qui n’est pas terminée
Mais la contestation des pouvoirs installés a continué de produire ses effets, jusqu’au Soudan, à Oman, en Irak, au Liban. Même l’Arabie saoudite n’a pas été épargnée. En revanche, l’Algérie, marquée par la terrible guerre civile entre État et islamistes dans les années 1990-2000, n’a pas suivi ce mouvement, même si les contestations ne sont pas absentes.
Malgré l’importance des revers subis par les mouvements populaires, il est difficile de mettre fin à une vague de fond rassemblant la jeunesse, le prolétariat urbain mais aussi une bonne partie des classes moyennes, et surtout les couches populaires de régions marginalisées, surexploitées et polluées, qui convergent dans les revendications communes de la liberté, l’emploi, la dignité et la souveraineté nationale, qu’aucune répression ne peut totalement étouffer.
Jacques Babel Jeudi 22 décembre 2016
-
Désunion arabe face aux changements climatiques (Anti-k)
Le Maroc a abrité du 7 au 18 novembre 2016 la vingt-deuxième conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Pourquoi les pays arabes ont-ils été si peu nombreux à y participer ? Reportage dans les couloirs de la « zone bleue » du village de la COP22, réservée aux officiels.
Le 15 novembre, à Marrakech, dix-huit chefs d’État arabes manquaient à l’appel lors de la photo de la cérémonie d’ouverture du sommet des chefs d’État et de gouvernement de la 22e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP22) |1|. Seuls les émirs du Qatar et du Koweït accompagnaient le roi Mohammed VI lors de cette photo. L’infréquentable Omar Al-Bachir, président du Soudan, avait été placé bien loin des trois autres chefs d’État arabes. Si les présidents africains étaient présents en force, et Israël aussi — une partie de la société civile marocaine s’est indignée, mais cette présence a été passée sous silence par les représentants des vingt-deux pays arabes — les dignitaires de la région MENA (Moyen-Orient Afrique du Nord) avaient en effet préféré faire l’impasse sur cette COP en terre marocaine. Leur absence remarquée est le résultat de facteurs conjoncturels et structurels.
Une COP plus africaine qu’arabe
Tout d’abord, le Maroc avait choisi de faire de ce sommet une « COP africaine ». Le royaume chérifien paie donc en quelque sorte son désengagement continu de la scène arabe, même si le roi Mohammed VI s’est excusé de ne pas avoir voulu abriter le sommet ordinaire de la Ligue arabe en février dernier. Une décision surprenante, justifiée dans un communiqué fustigeant l’inertie des pays arabes : « Ce sommet ne sera qu’une occasion d’adopter des résolutions ordinaires et de prononcer des discours qui ne feront que donner une fausse impression d’unité et de solidarité entre les États du monde arabe », affirmait en février le ministère des affaires étrangères. Le sommet a été déplacé en catastrophe en Mauritanie, et ce désistement a laissé des traces.
Les absences des pays arabes à la COP22 sont aussi emblématiques du peu d’intérêt accordé par les décideurs des pays de la région à la question des changements climatiques. Pourtant, la région MENA figure parmi les zones les plus menacées dans le monde par le réchauffement climatique, la désertification et le stress hydrique |2|. La région est même une illustration de l’injustice climatique, dans la mesure où les 22 pays de la région demeurent de faibles émetteurs de gaz à effet de serre (GES) dans le monde, avec seulement 4,2 % des émissions globales. Une inégalité régionale s’y ajoute : 85 % de ces émissions sont produites par les six pays membres du Conseil de coopération des pays du Golfe (CCG).
À l’ombre de l’Arabie saoudite
L’Arabie saoudite est pourtant chef de file et porte-parole du groupe arabe auprès de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CNUCUCC) depuis deux décennies, mandatée par la Ligue arabe. « L’ironie c’est que le ministre du pétrole est toujours présent lors des sommets », regrette un délégué d’un pays arabe |3|.
Le rôle de Riyad est décrié par les acteurs de la société civile régionale. À l’instar d’autres pays producteurs d’énergies fossiles, le royaume a en effet joué un rôle de blocage lors des négociations de l’accord de Paris sur le climat qui a suivi les conclusions de la COP21. Le royaume saoudien s’est longtemps opposé à la réduction de l’utilisation des énergies fossiles — une position partagée avec les grands producteurs de pétrole d’Amérique latine et d’Afrique — et a notamment bloqué la mention, dans l’accord de Paris, de l’objectif de limitation à 1,5 °C de la hausse des températures. Le groupe arabe avait porté une mention sur ce sujet, qui n’a pas été retenue dans l’accord final.
La présidence du groupe arabe ne fait plus l’unanimité aujourd’hui. « La position arabe demeure peu visible dans les espaces de la COP. La coopération et les consultations entre les pays sont faibles durant les sommets », regrette un membre de la délégation jordanienne. Même sentiment dans la délégation libanaise : « Au sein du groupe, nous avons certes moins de divergences qu’auparavant. Par le passé, nous avions des différences sur les réponses majeures (la transition vers le renouvelable, le financement de la transition énergétique, l’objectif 1,5 C °), mais depuis l’accord de Paris ces questions ont été résolues. Maintenant, nous devons avoir une coordination de nos positions », exige Vahakn Kabakian, chef de la délégation libanaise.
Le manque de consultation préalable inquiète également plusieurs délégations arabes. « L’Arabie saoudite ne doit pas se contenter de nous informer sur ce qui s’est passé lors des négociations. Nous devons nous concerter sur les propositions communes. La situation est inconcevable », déplore le responsable libanais.
Sous influence climato-sceptique
Ces divergences de points de vue et d’approches entre les pays arabes se sont manifestées lors des négociations pour l’accord de Paris en 2015. L’Arabie saoudite avait joué un rôle de blocage pour en retarder l’adoption par le groupe arabe. « Une bonne partie de ce groupe est composé de pays membres de l’Organisation des pays producteurs de pétrole (OPEP). Cette année à Marrakech, les Saoudiens ont encore une fois bloqué des négociations, déjà très lentes », regrette Safa’Al-Jayoussi, coordinatrice de Climate Action Network (CAN) pour le monde arabe.
Le manque de visibilité et d’actions de ces pays lors des sommets sur le climat est fréquemment expliqué par ce rôle joué par le royaume saoudien. « Depuis le démarrage du processus de négociation sur le climat, la délégation saoudienne était présidée par Dr Mohamed Al-Sabban. Ce climatosceptique avait la réputation d’être un acteur de blocage pour l’avancement des négociations », rappelle Wael Hmaidan, directeur de CAN-International |4|. Le remplacement de ce diplomate saoudien à partir de 2015 aura permis à l’Arabie saoudite de modifier légèrement ses positions au sujet des négociations climatiques.
Dans les rangs de la délégation saoudienne présente à Marrakech, une lecture conservatrice de l’accord de Paris est toujours prédominante. Ayman Shasly est conseiller au ministère saoudien de l’énergie et membre de l’équipe des négociateurs : « L’accord de Paris permet une adaptation selon le niveau de développement de chaque pays. Les pays n’ont aucun engagement pour fournir des efforts en matière d’énergies fossiles. Tous les engagements restent volontaires », indique-t-il. D’autres pays arabes prennent leurs distances avec cette stratégie.
Faible ratification de l’Accord de Paris
À une journée de la fin du sommet, Safa’ Al-Jayoussi était déçue par la faible présence arabe lors de cette COP. « La participation arabe était plus importante lors de la COP21 », compare-t-elle. Pourtant son réseau a appelé durant des mois à « une présence forte pour soutenir la présidence marocaine », en vain : seuls quelques ministres de l’environnement ont fait le déplacement. « Le nouveau président libanais devait participer à ce sommet, mais il a été retenu par des engagements urgents liés à la formation du nouveau gouvernement », explique pour sa part le chef de la délégation libanaise.
Cette présence plus que discrète est à l’image de la faible mobilisation pour la signature de l’accord de Paris parmi les pays membres de La Ligue arabe. Sur les vingt-deux pays, seuls trois – l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Maroc — ont déposé leur signature auprès de la CNUCUCC. Quatre pays ont lancé le processus de ratification au niveau national : l’Égypte, l’Algérie, la Tunisie et le Liban. « Nos pays sont venus à la COP22 peu préparés. Ils ont été surpris par le rythme rapide des ratifications. Au final, ils étaient frustrés de ne pas pouvoir participer à la négociation, car ils ne font pas encore partie de l’accord », observe Safa’Al-Jayoussi.
En ordre dispersé
À la « zone bleue » de la COP22, les pavillons des pays arabes n’avaient pas tous la même visibilité et le même positionnement. Le Maroc, pays hôte, confirmait son orientation africaine à la recherche d’opportunités d’affaires dans ce continent. La Tunisie, également présente dans le pavillon africain, s’est contentée d’une présence symbolique et d’un pavillon modeste. L’Algérie pour sa part avait choisi de ne pas avoir de pavillon, réduisant sa présence au strict minimum. Au final, c’est le pavillon du CCG qui aura été le lieu de rassemblement de ces délégations. Cet espace organisait quelques rares moments d’échanges entre les pays de la région sur leurs stratégies d’adaptation face aux changements climatiques. Très peu suivies par les délégués des pays, les présentations des programmes nationaux n’ont pas apporté une réponse régionale aux défis posés par le changement climatique.
Tous ces facteurs mènent les pays arabes à des stratégies isolées. Comme le Maroc, l’Égypte se positionne comme un acteur-clé dans le groupe des pays africains. C’est d’ailleurs le ministre égyptien de l’environnement, Khaled Fahmy, qui en assure la présidence. Le Liban, le Maroc et la Tunisie font partie du Climate Vulnerable Forum, qui défend des positions davantage progressistes que le groupe arabe. Même les Émirats arabes unis (EAU), l’un des principaux alliés du royaume commence à s’émanciper -– légèrement — de la tutelle du grand frère saoudien. Sur le pavillon du CCG, les Émirats Arabes Unis ont choisi de faire cavalier seul, ayant choisi de disposer de leur propre pavillon. L’émirat exprimait ainsi sa forte mobilisation face aux changements climatiques. Ces réponses nationales rendent difficiles toutes coordinations régionales.
L’endettement comme perspective
Ces multiples positionnements n’ont pas été faciles à gérer pour des pays comme le Maroc. « Bien que le Maroc ait pris part aux COP depuis 1995, il est difficile d’identifier une stratégie autonome du pays ou une position politique claire sur le sujet. En absence de vision claire, ‘’nos ‘’ négociateurs sont perdus entre vingt groupes de négociations », explique Jawad Moustakbal, membre de l’Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (Attac) Maroc. Ces stratégies solitaires affaiblissent la position commune, laissant le champ libre à l’Arabie saoudite. « Notre principal handicap est que le groupe arabe est présidé par un pays pétrolier et climatosceptique, tranche Al-Jayoussi. « Nous aurions espéré une déclaration commune des pays arabes, une initiative de soutien à la présidence marocaine de cette année, or nos représentants brillent par leur discrétion ».
L’unique initiative à dimension régionale a finalement été l’œuvre de la Banque mondiale. Le vaisseau amiral des politiques néolibérales dans les pays en développement promet aux pays de la région MENA des recettes déjà mises en œuvre pour d’autres problématiques, notamment la réduction de la pauvreté. Ainsi, cette institution annonce, entre autres, qu’elle portera de 18 à 30 % la part de ses prêts en appui à l’action climatique |5|. À défaut d’une réponse régionale des gouvernements arabes, les peuples du Maghreb et du Machrek ont pour perspective de devoir s’endetter dans les décennies à venir pour financer une difficile adaptation aux changements climatiques.
Source : Orient XXI
Notes
|1| Retrouvez notre dossier complet « COP22 Des paroles aux actes ».
|2| Pour une radioscopie complète des conséquences des changements climatiques sur la région, voir Climate Projections and Extreme Climate Indices for the Arab Region, UN Economic and Social for Western Africa (ESCWA), 2015.
|3| Plusieurs des interviewés ont requis l’anonymat.
|4| Wael Hmaidan, « The Wind of Change Hitting the Arab Region ? », in A Region Heating Up : Climate Change Activism in the Middle East and North Africa, Perspectives n° 9 (août 2016), fondation Heinrich Böll.
|5| Un nouveau plan d’appui à la lutte contre le changement climatique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 15 novembre 2016.
CADTM – 19 décembre par Salaheddine Lemaizi
Auteur.e
 Salaheddine Lemaizi membre d’ATTAC CADTM Maroc et Comité des études et de plaidoyer du CADTM Afrique.
Salaheddine Lemaizi membre d’ATTAC CADTM Maroc et Comité des études et de plaidoyer du CADTM Afrique.Autres articles en français de Salaheddine Lemaizi
- Pauvreté en Afrique, les non-dits de la Banque mondiale
- J’ai vu une petite victoire sociale
- Les échecs de la privatisation de la santé au Maroc
- Finance islamique, principes et limites
- Grèce, Espagne et Tunisie : d’autres politiques de santé sont possibles
- Le Forum parlementaire mondial contre « le système dette »
- « MarocAfric » ou l’investissement marocain en Afrique subsaharienne
- Austérité et ajustement au Maroc. Le gouvernement garde la « Ligne » du FMI et le citoyen paie le prix
- Pauvreté en Afrique, les non-dits de la Banque mondiale
-
Tragédie d’Alep, attentat de Berlin, un monde capitaliste en décomposition (Anti-k)

Perspectives révolutionnaires et campagne présidentielle
La tragédie d’Alep suscite, à travers le monde, émotion et révolte non seulement contre les bourreaux du peuple syrien mais aussi contre leurs complices qui s’indignent, cyniques et impuissants, pour mieux faire oublier tant leur abandon du peuple syrien que leurs propres crimes en Irak, à Mossoul, en Afghanistan ou au Yémen. L’odieux attentat terroriste de Berlin revendiqué par l’Etat islamique ne fait que souligner le terrible enchaînement de violences barbares qu’engendre l’offensive libérale et impérialiste des classes dominantes de par le monde.
Cette tragédie s’inscrit au centre des négociations entre les grandes puissances alors que se dessine une nouvelle politique des USA sous la houlette de la réaction alliant milliardaires et généraux.
« Je pense qu’avec la libération d’Alep, on dira que la situation a changé, pas seulement pour la Syrie, pas seulement pour la région, mais pour le monde entier, il y aura un avant et un après la libération d’Alep » a pu déclarer avec cynisme le dictateur sanglant de Syrie. Avec brutalité, il exprime une réalité politique tant dans la situation au Moyen-Orient que dans les rapports internationaux.
Les USA devenus incapables d’assumer leur prétention à maintenir l’ordre mondial sont contraints de composer avec les ambitions impérialistes de la Russie, de l’Iran et autres Turquie ou Arabie saoudite…
Ils encouragent la montée des forces réactionnaires comme ils l’ont fait dans le passé en portant une lourde responsabilité dans la formation d’Al Qaïda. Trump sera l’homme de cette politique des USA concentrés sur la défense de leurs propres intérêts, de ceux de Goldman Sachs and Co.
La mondialisation libérale et impérialiste rentre dans une nouvelle phase où la lutte pour le maintien des profits et éviter un nouveau krach, une faillite généralisée, s’exacerbe tant au niveau national qu’international.
Les bourgeoisies n’ont pas d’autre réponse à leur faillite qu’une fuite en avant qui ne peut qu’aggraver les tensions tant économiques et sociales que militaires et internationales.
Cette offensive provoque à travers le monde de multiples réactions et révoltes, de nouveaux affrontements se préparent à travers lesquels le mouvement ouvrier est appelé à connaître un nouvel essor. Nous n’en connaissons ni les rythmes ni les étapes, mais cette possibilité est inscrite dans le développement des luttes de classes. Elle porte la seule réponse à la banqueroute des classes capitalistes. Nous voulons nous donner les moyens d’y être acteurs en faisant vivre une perspective pour ces mobilisations et ces luttes qui permette d’inverser le cours des choses.
Sur ce chemin, il n’y a pas de raccourcis ni de voie détournée. Ce qui est à l’ordre du jour est de rassembler les forces en vue de ces affrontements qui posent la question de leur issue révolutionnaire pour en finir avec la domination des classes capitalistes.
« Crise de la représentation politique » ou nécessité d’un parti des travailleurs ?
Un nouveau discours politique se développe jusqu’à la caricature, contre « la caste », la corruption des dites élites, antisystème… Ni droite ni gauche, ni bourgeoisie ni prolétariat, ce nouveau populisme serait porté par les classes populaires.
« Ils ne nous représentent pas » devient y compris au sein de la gauche radicale le mot d’ordre du jour. La « crise de la représentation politique » serait un des facteurs déterminants de la situation actuelle y compris du point de vue des luttes des travailleurs. Cette formule, même si elle peut exprimer une part du mécontentement, est fourre-tout et mélange la censure de la démocratie qu’impose la finance en se soumettant les Etats par le biais de la dette publique et le rejet de la mondialisation et des partis institutionnels voués à la défense des intérêts des classes dominantes, leur corruption comme leurs mensonges ou le recours à la violence d’Etat pour imposer leur politique. S’interrogeant sur cette question, notre camarade Ugo Paletha écrit dans un article intitulé Vers l’autoritarisme ? Crise de la démocratie libérale et politique d’émancipation : « Malheureusement, cette crise d’hégémonie est trop souvent ramenée par les commentateurs politiques, et par certains segments de la gauche radicale, à une disjonction entre l’offre et la demande électorales, autrement dit à la version simpliste d’une crise de représentation politique. Il arrive même qu’elle soit perçue comme le symptôme d’une corruption des élites politiques, recodant ainsi sur un plan moral – donc dépolitisant – la crise politique à laquelle nous faisons face.
Ces interprétations sommaires mais répandues de la crise de la démocratie libérale ont donné une force certaine au récit populiste (au sens de Laclau, diffusé notamment par Podemos et ses principales figures politiques et intellectuelles, Pablo Iglesias et Iñigo Errejon. Ces derniers, comme le Parti de gauche (PG) et Jean-Luc Mélenchon en France, ont bâti leur discours politique dans la période récente sur l’idée simple – et juste à un tel niveau de généralité – qu’ « ils [les membres de l’élite politique] ne nous représentent pas ».
Mais ce slogan – et l’imaginaire qui lui est associé – charrient trop souvent une solution illusoire : l’émergence de nouveaux leaders, plus moraux, et de figures charismatiques mieux capables, non simplement d’incarner le peuple, mais à travers eux de le construire comme acteur politique en s’érigeant au-dessus des mouvements sociaux et des organisations politiques […] L’un des défauts essentiels de la démarche défendue par ces courants, dans leur diversité, est qu’elle repose sur une fausse évidence : l’exercice du pouvoir politique permettant seul d’impulser un changement social d’ampleur, les institutions politiques – et partant les élections – constitueraient le champ de bataille central pour la gauche radicale, et plus profondément l’unique locus de la politique d’émancipation. Pablo Iglesias a d’ailleurs affirmé dans un discours récent : « Nous avons appris à Madrid et à Valence que les choses se changent à partir des institutions. Cette idiotie que nous disions quand nous étions d’extrême gauche, que les choses changent dans la rue et non dans les institutions, c’est un mensonge ».[…] Cette conception relève de ce que Marx nommait l’« illusion politique », reposant sur une série de fausses équivalences entre le pouvoir politique, le pouvoir d’État et le pouvoir tout court. » Oui, et c’est bien cette question qu’il nous faut discuter. Pour le mouvement ouvrier, la question n’est pas celle d’être mieux représenté dans le cadre des institutions mais bien de se donner un instrument politique pour préparer l’affrontement avec les classes dominantes, la conquête du pouvoir par les travailleurs eux-mêmes, la population.
L’écume et la vague de fond
Nous avons besoin de nous dégager des effets de mode, analyses superficielles, qui confondent l’écume avec le mouvement de fond. Une première remarque s’impose, du point de vue des classes exploitées, du mouvement ouvrier, cette dite « crise de la représentation » n’est pas vraiment une nouveauté. Elle a commencé avec la faillite de la social-démocratie en 1914 puis la soumission des partis communistes à la bureaucratie stalinienne avant que les partis communistes ne réintègrent après la deuxième guerre mondiale le giron des institutions bourgeoises. Faire semblant de redécouvrir le monde n’est pas une bonne façon de faire sauf si on cherche à être une nouvelle représentation politique dans le cadre de ces institutions, la politique de Podemos ou de Mélenchon, c’est à dire recommencer une histoire qui s’est avérée une impasse dramatique.
La montée des forces réactionnaires n’est pas liée à une simple question de représentation mais bien à la crise globale du capitalisme mondialisé, à l’impuissance du système politique institutionnel dit démocratique dans les pays riches à contenir le mécontentement, les inquiétudes, les souffrances qui touchent des fractions de plus en plus larges de la population.
La globalité de la crise condamne à l’impuissance, au mieux, des forces politiques qui ne s’attaquent pas à la racine des problèmes, la politique des classes dominantes et de leurs Etats, la logique capitaliste du profit et de la concurrence.
A la fin de cette année 2016, le basculement du monde dans l’instabilité et dans des tensions exacerbées exige des réponses démocratiques et révolutionnaires. Encore moins que par le passé, il n’est possible de replâtrer le système. Une vision stratégique claire seule permet d’avoir une boussole à travers les différents moments de l’actualité ou les mille aspects des luttes de classes.
Le lien entre nos tâches quotidiennes et la perspective du pouvoir ne peut se faire que si nous disons clairement et sans ambiguïté l’enjeu de notre combat, non seulement dans notre programme mais y compris dans notre agitation en trouvant les formules pour populariser l’idée d’un pouvoir démocratique des travailleurs.
La tragédie d’une révolution écrasée n’est pas la fin du processus ouvert en 2011
La montée des idées réactionnaires loin de nous pousser à chercher des positions de replis, des formules qui permettraient d’éventuelles alliances avec des forces réformistes sous couvert de faire face au recul, nous encourage au contraire à travailler collectivement à élaborer nos analyses et explications qui fondent notre démarche révolutionnaire. Les forces réactionnaires ont le terrain libre non pas parce que les travailleurs ne seraient pas « représentés » mais bien parce qu’il n’y a pas de mouvement significatif capable de formuler une politique pour les mobilisations en vue de luttes politiques, d’affrontements pour en finir avec le pouvoir des classes dominantes.
A partir de 2011, dans les premières années du NPA fondé au tout début de la crise qui s’est développée depuis, notre compréhension de la période s’articulait autour d’une idée essentielle : la vague révolutionnaire qui balaye le monde arabe souligne le fait que les conditions objectives d’une nouvelle période révolutionnaire mûrissent.
Ces révolutions s’inscrivent dans une évolution globale du monde qui fonde et légitime une stratégie révolutionnaire.
Les bouleversements opérés par la mondialisation libérale et impérialiste ont mûri les conditions objectives pour une transformation révolutionnaire de la société en mettant en concurrence les travailleurs à l’échelle de la planète, en prolétarisant des millions de paysans, en ouvrant les frontières, en développant comme jamais les relations internationales, les transports, les nouvelles technologies. En portant les contradictions mêmes du capitalisme à un niveau d’exacerbation jamais atteint au point que le décalage entre les progrès scientifiques, techniques et la dégradation sociale pour le plus grand nombre, le creusement des inégalités, la paupérisation sont devenus insoutenables.
Ce sont ces contradictions qui ont engendré la première vague révolutionnaire de la nouvelle période.
Un mouvement irréversible a été engagé, il connaîtra des hauts et des bas, des victoires et des défaites, de lentes accumulations de forces puis de brusques accélérations, des explosions mais notre stratégie doit toute entière s’inscrire dans cette nouvelle période de guerres et de révolution.
La catastrophe financière est imminente, la discussion sur les moyens de la conjurer est au cœur du débat à l’échelle nationale et internationale. L’étape que vient de franchir la crise économique et financière a des influences politiques qui créent une période d’instabilité politique, d’usure, de discrédit des partis institutionnels qui entraîne une évolution rapide des consciences.
La question de la dette n’a pas de solution dans le cadre des rapports de classe du capitalisme, la dette publique s’inscrit dans le fonctionnement à crédit du capitalisme qui doit anticiper en permanence les profits non encore réalisés ou qui ne se réaliseront… pas. Le gonflement de la bulle financière accroît sans limite cette logique de l’économie d’endettement tant public que privé. Tous les partis sont confrontés à ce problème qui les ruine à court terme.
La question sociale s’impose comme la question politique clé en lien avec la question de la démocratie.
« Non à l’austérité », « annulation de la dette », « aux peuples de décider », deviennent des mots d’ordre quasi universels.
La crise écologique, par sa globalité, remet en cause l’ensemble du système et fait de la circulation des capitaux un facteur écologique de première importance. Elle donne au besoin d’une gouvernance mondiale, à celui d’une planification démocratique un contenu évident autant il est vrai qu’il n’y a pas de réponse locale ou partielle à la crise écologique planétaire.
Le principal facteur de stabilité des vieilles bourgeoisies impérialistes, les surprofits impérialistes, est sapé par une terrible concurrence internationale avec son corollaire, la mise en concurrence des travailleurs à l’échelle internationale : crise de la domination de la bourgeoisie qui nourrit le populisme mais aussi émergence d’une nouvelle classe ouvrière internationale porteuse de la transformation révolutionnaire de la société.
La réponse des classes dominantes et des grandes puissances à l’émergence encore incertaine de ces exigences dans le monde arabe a été la répression dont la tragédie d’Alep marque le sinistre et sanglant apogée alors que le djihadisme poursuit ses exactions barbares.
Les forces réactionnaires ont pu briser cette première vague de la révolution, elles n’en sont pas pour autant venues à bout. Les exigences de la révolution ne sont pas, elles, brisées, elles gagnent du terrain, se répandent.
A l’opposé des confusions sur « la nouvelle représentation », la nécessité d’une démocratie révolutionnaire
La déferlante réactionnaire ne doit pas nous enfermer dans l’instant. Elle est la seule politique d’une classe en faillite incapable d’offrir d’autres perspectives aux peuples que l’égoïsme national, l’obscurantisme religieux, la mystique nationale et la haine de l’autre pour leur imposer la régression sociale, démocratique, la guerre en permanence.
Toute notre politique doit être fondée sur l’idée qu’à l’opposé, les travailleur-e-s, et la jeunesse, les classes exploitées vont chercher les moyens de se défendre, les armes pour se battre.
La perspective révolutionnaire va progressivement, à travers les expériences quotidiennes, gagner les consciences.
C’est cette expérience qui construit le lien concret et pratique entre notre activité quotidienne, les luttes d’aujourd’hui et la lutte pour le pouvoir demain.
La révolution n’est pas un saut qualitatif à partir de rien mais bien un bouleversement, une rupture, conséquence de l’accumulation de contre-pouvoirs locaux gagnés dans les syndicats, les associations, les institutions elles-mêmes. L’agitation, l’activité révolutionnaire n’est pas une simple dénonciation ou incantation mais la lutte pied à pied pour gagner des positions, la lutte pour des micropouvoirs démocratiques et révolutionnaires, accumulation primitive de forces révolutionnaires, de matériels explosifs en vue de la conquête du pouvoir. La révolution est bien un processus, celui de la révolution en permanence.
La bataille pour la candidature de Philippe Poutou, vers un parti des travailleurs…
Ces dernières années, le NPA a connu des doutes, des hésitations à assumer une politique de parti pour la transformation révolutionnaire de la société s’adressant à l’ensemble de la classe ouvrière, de la jeunesse. Il en a été fortement affaibli.
Nous donner maintenant les moyens d’être présents dans la campagne présidentielle autour de Philippe Poutou, ouvrier candidat, est une étape importante pour surmonter nos difficultés en défendant une politique et un vote de classe, contre leur système, en rupture avec lui. En rupture aussi avec celles et ceux qui dénoncent les élites pour mieux rester dans le cadre institutionnel et y enfermer le mécontentement.
C’est une bataille importante pour contribuer à ce que l’ensemble du mouvement révolutionnaire sorte des politiques d’auto affirmation pour rassembler, unir ses forces pour faire face aux tempêtes à venir.
Le mouvement anticapitaliste et révolutionnaire est devant une nouvelle étape. Depuis l’effondrement de l’ex-URSS, il y a près de 30 ans, l’extrême gauche, pour l’essentiel le mouvement trotskyste, n’a pas réussi à répondre aux nouvelles possibilités ni aux nouveaux besoins nés de la fin du stalinisme et de la transformation de la social-démocratie en social-libéralisme. Aujourd’hui ces évolutions laissent un champ de ruines, des militantEs désemparés, démoralisés pour beaucoup. Nous n’avons pas encore réussi à opérer notre révolution culturelle, un saut qualitatif de groupes opposants à la social-démocratie et au stalinisme en un petit parti ouvrier et populaire, que ce soit Lutte ouvrière et l’appel à un parti des travailleurs après 1995, Voix des travailleurs et la politique d’unité des révolutionnaires de 1997 à 2000, la LCR avec la fondation du NPA, aujourd’hui le NPA lui-même.
Lutte ouvrière s’enferre dans un repli sur soi contraire à l’orientation qui avait permis à LO de jouer un rôle essentiel dans le développement du mouvement révolutionnaire au sein de la classe ouvrière. Ce repli s’exprime de façon caricaturale dans l’analyse de La Russie de Poutine que fait LO. Dans un article intitulé Décembre 1991 : la fin de l’URSS, pas des idées communistes, publié le 14 décembre dernier, Lutte ouvrière revient sur l’effondrement de l’URSS et sur le régime de Poutine. « Arrivé à la tête de la Russie en 2000, Poutine se donna pour tâche de rétablir la «verticale du pouvoir», dans l’intérêt de la bureaucratie dans son ensemble. Il imposa que les affairistes se soumettent à l’État et paient leurs impôts, tout en permettant leurs pillages, avec comme perspective la réintégration de la Russie dans le marché mondial.
Mais le capitalisme en crise n’est plus capable de progrès depuis longtemps déjà. Il est incapable de se substituer efficacement à l’économie et aux rapports sociaux hérités des soixante-dix ans d’existence de l’URSS, si ce n’est pour permettre à une minorité de s’enrichir.
La fin de l’URSS a marqué une étape décisive dans le processus réactionnaire dont le stalinisme avait été l’incarnation sanglante, et il n’y a pas lieu de se réjouir de l’évolution en cours. La perspective d’une future Union socialiste mondiale des travailleurs reste la seule qui permettra à l’humanité de reprendre sa marche en avant. » Quelle est la place de la Russie aujourd’hui dans le monde libéral et impérialiste ? Continuité de la bureaucratie ? Continuité de l’Etat ? De l’Etat ouvrier ? Le lecteur ne saura pas. Cette analyse fermée et métaphysique est l’expression de la fermeture de LO elle-même.
Pourtant, la nouvelle époque dans laquelle nous entrons demande un dépassement de l’extrême-gauche, rendu nécessaire mais aussi possible par le basculement du monde dans une crise globale sans précédent qui crée les conditions objectives de cette mue, l’exige et la rend possible.
Cette question s’était déjà posée après la fin de l’URSS, à partir de 1995 après qu’Arlette Laguiller a rassemblé plus de 5 % des voix à l’élection présidentielle et le mouvement de novembre-décembre 95 puis quand, ensemble la LCR et LO ont obtenu 5 députés au Parlement européen. En 2002, l’extrême gauche réalisait plus de 10 % des voix à l’élection présidentielle.
Rien de significatif n’est sorti de cette période. Conditions objectives ?
Non, ou du moins pas seulement, mais l’incapacité de l’extrême-gauche à surmonter ses divisions. Il ne s’agit pas d’une question psychologique, ou morale, de sectarisme, mais bien d’une question politique de fond : les conceptions de construction par en haut, d’auto construction dans laquelle le programme est plus un instrument de délimitation, de clivage qu’un instrument d’intervention et de regroupement.
Rompre avec ces conceptions n’est pas abdiquer d’une fermeté stratégique, bien au contraire. Les idées ne servent pas à cliver sinon ce sont des formules dogmatiques, elles servent à agir, à unir pour agir.
Nous rééditons en annexe de cet article un texte de 1997 rédigé par Voix des travailleurs, groupe constitué par les militantEs excluEs de LO à ce moment-là, qui illustre notre propos en revenant sur l’histoire de la façon dont la construction d’un parti s’est posé pour le mouvement ouvrier. Nous voulions opposer la réalité aux mythes.
Un parti de la classe ouvrière participe d’un processus d’auto-organisation dans lequel sont acteurs groupes, tendances, militantEs, un processus créateur qui suscite initiatives, cimenté par une même conscience révolutionnaire, socialiste et de classe.
Le parti est une sorte de melting-pot à travers lequel il se transforme lui-même, évolue, se renforce, élabore sa politique à travers une confrontation permanente tant entre les différents courants qui s’y retrouvent qu’avec les autres forces du mouvement ouvrier.
C’est notre capacité à rassembler toutes nos forces qui peut nous permettre de surmonter nos actuelles difficultés. Cette capacité ne renvoie pas à des qualités morales, individuelles mais bien à une question de stratégie, la compréhension de la nouvelle période, les tâches qui en résultent, les changements qu’elle implique et la volonté de construire un parti révolutionnaire et démocratique sur des bases de classe.
Démocratie Révolutionnaire, Par Yvan Lemaitre
-
Dossier: Révolutions et contre-révolutions dans la région arabe 2011-2016 (NPA)
Il y a six ans débutait en Tunisie un processus révolutionnaire secouant la plupart des États d’Afrique du Nord, du Proche et du Moyen-Orient.
Dans un mouvement cumulatif début 2011, des soulèvements de masse remettaient en cause des régimes politiques d’origine très diverses (républiques nationalistes pro ou anti-occidentales, monarchies absolues ouvertement réactionnaires ou se voulant modernistes). Un dictateur après l’autre était conspué avec une haine commune, contre la confiscation de l’État et l’arbitraire, contre la corruption et le chômage généralisés. Et dans plusieurs d’entre eux, face à la répression sanglante, des manifestations immenses scandaient le slogan « Ash-shab yurid isqat an-Nizam ! » « Le peuple veut la chute du régime ! »… D’hier à aujourd’hui, ce dossier revient sur quelques éléments d’un processus essentiel.
- Flux et reflux de la vague révolutionnaire
- Les jeux des grandes et moyennes puissances
- Le rôle de l’Iran dans la tragédie syrienne
- La dimension kurde du conflit syrien
Lien permanent Catégories : Berbères, Kurdes...(minorités nationales), Documents, NPAOman 0 commentaire -
La chute d’Alep Est : nos destins sont liés… par J. Daher (Anti-k)
Pour rappel, Alep-Est subissait un siège depuis juillet 2016 et les populations civiles manquaient de nourriture, d’eau, de médicaments et d’autres produits de première nécessité. Avant la conquête totale des quartiers libérés d’Alep Est, environ 50 000 personnes avaient fui, en majorité vers les zones contrôlées par le régime et une minorité, plusieurs milliers, vers les quartiers de Sheikh Maqsoud, sous la direction des forces kurdes du PYD. Selon certaines sources, le régime aurait d’ailleurs ordonné aux forces armées kurdes du PYD, les YPG, de quitter son bastion de Sheikh Maqsoud avant la fin de l’année[1]. Les hommes âgés entre 18 et 45 ans fuyant vers les zones sous le contrôle du régime étaient séparés du reste des civiles pour être interrogé par les services sécurités d’Assad. Pour certains, leurs sorts sont encore inconnus ; beaucoup craignent des exécutions sommaires ou des incarcérations arbitraires dans les geôles du régime, tandis qu’une majorité des nouveaux jeunes arrivants étaient mobilisés par l’armée du régime pour combattre contre l’opposition armée, pour certains contre leurs anciens camarades…
La victoire des forces pro-régime provoque un nouveau déplacement forcé de populations, entre 50 000 et 80 000 personnes, en grande majorité des civils, suite à un accord entre l’opposition armée et le régime. Le transfert forcé de population se finissait, à l’heure où nous écrivons, et avait été retardé par des milices pro-iraniennes qui ont attaqué les premiers convois, tandis que d’autres milices pro-régime attaquaient et volaient des civils fuyant les régions Est de la ville. Des combattants liés au groupe jihadiste de Jund Al-Aqsa,[2] allié de Fateh al-Sham (ex Jabhat al-Nusra), ont aussi brulé les bus devant évacuer les blessés de deux villes habités par des populations syriennes, Kefraya et Fuaa, de confessions chiites dans la province d’Alep, bloquant temporairement le départ des civils d’Alep Est, qui pour nombre d’entre eux ont condamné cet acte sur les réseaux sociaux.
Les forces armées de l’opposition étaient composées d’entre 7 000 et 10 000 combattants, dont environ quelques centaines de djihadistes (de Jabhat Fateh al-Sham), les estimations allant de 250 à 700[3], et non la majorité comme certains journalistes l’ont affirmé.
Les groupes d’oppositions armées principales étaient composés de brigades locales, en grande majorité liés à l’Armée Syrienne Libre et de quelques groupes à dénominations islamiques mais qui ne sont ni salafistes ni djihadistes. Les différents groupes avaient formé un commandement unifié sous le nom de « l’armée d’Alep » pour défendre les quartiers sous leurs contrôles, tout en continuant à être minés par des divisions. Cela ne signifie nullement que ces groupes n’ont pas commis de crimes. Pour ma part, j’ai condamné systématiquement leurs bombardements contre les civils des régions sous le contrôle des forces du régime et des quartiers kurdes de Sheikh Maqsoud, et autres exactions.
D’ailleurs certaines brigades islamiques et de l’ASL affilié au gouvernement turc, dépendant de son assistance politique et militaire, avaient quitté le front d’Alep, assiégé depuis juillet, pour participer à l’intervention turque en Syrie depuis l’été contre Daech, mais surtout contre les forces kurdes du PYD.
Des milliers de soldats des forces armées d’opposition syrienne ont dès lors été détournés du front d’Alep pour les intérêts du gouvernement turc au détriment des syriens.
Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est en effet resté silencieux sur les événements d’Alep, tandis que son premier ministre déclarait qu’il ne voyait pas d’objection à la présence d’Assad dans une période de transition. Erdogan, a en en fait conclu un accord avec les dirigeants russes et iraniens qui peut être résumé de la manière suivante : Alep pour ces derniers et Jarablus et autres régions frontalières pour le premier.
La priorité sur le terrain est en effet donnée à la lutte contre l’autonomie et à la prévention de toute expansion des forces kurdes du PYD au nord-est de la Syrie.
La Turquie a d’ailleurs émis le 22 novembre un mandat d’arrêt contre le leader du PYD, Saleh Muslim, tout en continuant la répression tout azimut menée contre les représentants et membres du HDP en Turquie. L’intervention militaire turque a d’ailleurs causé la mort de nombreux civils, arabes et kurdes, en Syrie, notamment à la suite de bombardements de son aviation. Ces derniers jours, la ville d’al-Bab, proche de la frontière turque et occupée par Daech, a par exemple été bombardé par l’aviation militaire turque, provoquant la mort d’au moins 47 civils (bilan qui risque de s’alourdir car des personnes sont toujours portées disparus[4]).
Les ministres des affaires étrangères et de la défense de l’Iran, de la Turquie et de la Russie se sont d’ailleurs rencontrés le 20 décembre pour discuter du futur de la Syrie.
À l’issue de cette conférence, les trois puissances ont adopté une déclaration commune visant à mettre fin au conflit en Syrie, par laquelle ils s’engagent à œuvrer à la mise en place d’un cessez-le-feu dans l’ensemble du pays, et que la priorité aujourd’hui en Syrie doit être de lutter contre le terrorisme et non d’aller vers un changement de régime à Damas. Dans les nombreuses manifestations populaires ces dernières semaines en solidarité avec Alep à travers les zones libérées en Syrie, les populations locales exprimaient également leur ras-le-bol des divisions entre les groupes de l’opposition armée et exigeaient leur unification sous un seul leadership.
Alep Est, un symbole d’une alternative démocratique et inclusive…
Revenons sur la chute d’Alep Est et sur l’alternative démocratique que la ville a pu représenter. Les quartiers d’Alep Est ont été libérés par des forces de l’opposition armée venant de la province d’Alep à la fin de l’été 2012. En mars 2013, le conseil local d’Alep, constitué de civils élus démocratiquement par les populations locales, a vu le jour, remplaçant le conseil révolutionnaire transitoire qui avait été mis en place à l’automne 2012 par les groupes de l’opposition armée et certains groupes civils.
À cette époque, plus d’1,5 millions de personnes vivaient dans ces régions.
Ce conseil était renouvelé tous les ans et comptait vingt-cinq élus. Les élections étaient organisées via des listes parmi lesquelles votaient des assemblées regroupant soixante-trois conseils de quartiers de la zone libérée. La dernière élection a eu lieu en novembre 2015. Le Conseil local administrait le territoire et était responsable de la gestion des besoins de base des habitants : éducation, infrastructures civiles, hôpitaux, entretien de la voirie, etc. Les représentants du conseil organisaient des rencontres avec les conseils de quartiers pour prendre connaissance des besoins des habitants. Il y avait six cents employés qui travaillaient au sein des conseils de quartiers[5]. Là encore, cela ne signifie en rien que tout était parfait ; il y avait par exemple un déficit de participation des femmes aux hautes responsabilités du conseil local.
De nombreuses organisations populaires ont vu le jour également, organisant de nombreuses activités démocratiques, sociales, éducatives et culturelles (théâtres, concerts, festivals), tandis que des médias locaux – radios et journaux particulièrement – furent créés. De nombreuses campagnes populaires et démocratiques s’opposant au régime et aux forces islamiques fondamentalistes étaient organisés. Dans le même temps, les activistes et organisations populaires s’acharnaient à délivrer un message inclusif contre le confessionnalisme et le racisme. Ce sont ces activistes qui ont défié au début les pratiques autoritaires de certains groupes armés, mais surtout – en lien avec les populations locales – se sont opposés aux mouvements fondamentalistes islamiques.
Installé dans la ville en 2013, Daech en a ainsi été chassé début 2014 à la suite de mobilisations massives populaires, et de l’offensive de groupes de l’opposition armée liés à l’ASL.
Ce fut ensuite au tour de Jabhat al-Nusra à l’époque de subir l’opposition du mouvement populaire dans la ville pour ses pratiques réactionnaires et autoritaires, d’où d’ailleurs sa faible présence dans ces régions.
Ces exemples d’Alep Est peuvent être retrouvés dans d’autres régions libérées de Syrie, encore aujourd’hui, et c’est pour cette raison qu’elles sont et ont été la cible première du régime Assad et de ses alliés. Alep a subi un déluge de feu depuis l’été 2013, d’abord par les forces du régime puis accompagné par les forces aériennes russes à partir d’octobre 2015. Ces bombardements sont symptomatiques de la barbarie employée pour mettre fin à toute forme de résistance populaire dans le pays. La population des quartiers libérés de la ville d’Alep est passé d’environ 1,5 million d’habitant·e·s au début l’été 2013, avec une riche société civile d’organisations populaires, à 250 000 personnes manquant de tout à l’été 2016.
Toutes les villes et les quartiers dans lesquels existait une alternative populaire, démocratique et inclusive, ont été visés comme dans le cas de la ville de Daraya, dans la province de Damas, il y a quelque mois par exemple, et continuent à être visés, de même que les infrastructures civiles sur lesquelles se fondent ces expériences. Par exemple, 382 attaques ont eu lieu contre des installations médicales en Syrie entre mars 2011 et juin 2016, dont 90% des bombardements ont été menés par les forces de Damas et de Moscou.[6] Elles ont ainsi tué plus de 700 travailleurs·euses du personnel médical en Syrie. Cela sans oublier les multiples bombardements d’institutions civiles, comme celles des défenses civiles, connus sous le nom de « casques blancs », des boulangeries, écoles, usines, etc.
Ce sont ces exemples d’auto-organisations populaires et démocratiques, y compris avec leurs imperfections, qui sont craints par dessus tout par le régime depuis 2011. Non pas l’opposition officielle – en exil, corrompue et liée à des États autoritaires de la région –, ni les forces fondamentalistes islamiques qui constituent de fait un allié objectif du régime, dont ce dernier a d’ailleurs favorisé le développement, par ses pratiques autoritaires et confessionnelles.
Pour preuve, la reconquête par Daech de la ville de Palmyre est intervenue le 11 décembre, malgré la présence des forces russes, et n’a pas inquiété outre mesure le régime, qui concentrait ses forces et celle de ses alliés sur Alep Est. Ces dernières ont dû évacuer Palmyre juste avant l’entrée des combattants de Daech. Ces derniers ont trouvé dans la ville des réserves d’armes lourdes, dont des armes anti-aériennes. Les dirigeants officiels du régime ont déclaré à plusieurs reprises que Daech ne constituait pas une priorité, tandis que l’aviation russe a concentré ses frappes dans sa grande majorité sur les zones dans lesquelles les forces de Daech n’étaient pas présentes.
Le peuple syrien en lutte sans alliés au niveau international et régional…
Les puissances occidentales se bornent à exprimer leurs regrets, mais n’agissent même pas sur un plan humanitaire. Le 19 décembre dernier, le Conseil de sécurité a certes voté à l’unanimité, y compris la Russie, de déployer des observateurs de l’ONU et d’autres organisations à Alep pour y superviser les évacuations et garantir la sécurité des civils. Cela ne change néanmoins pas l’orientation politique générale des États-Unis et des États européens qui, loin de prôner un processus démocratique en Syrie, ne s’opposent pas au dictateur Assad et à sa clique malgré leurs crimes. En outre, la coalition internationale sous la direction des États-Unis, qui bombarde des positions de Daech en Syrie et en Irak depuis août 2014 a causé la mort de plus de 1 900 civils dans les deux pays depuis le début des frappes.
Il existe une tendance générale, au niveau mondial, qui vise à « liquider » la révolution syrienne et ses aspirations démocratiques au nom de la « guerre contre le terrorisme ».
La victoire de Donald Trump aux États-Unis renforce cette tendance, lui qui a en effet déclaré à plusieurs reprises qu’il souhaite conclure des accords avec Poutine sur la Syrie. Malgré le manque de continuité et la volatilité des positions de Trump en matières de politique internationale, la nomination récente de Rex Tillerson, patron du géant pétrolier ExxonMobil, au poste de Secrétaire d’État (équivalent du ministre des Affaires Etrangères), confirme la tendance évoquée. C’est une personnalité en effet connue pour ses positions pro-russes, qui a d’ailleurs reçu en 2013 des mains de Poutine la plus haute distinction russe pour un civil (l’ordre de l’Amitié).
Dans ce contexte, la conquête d’Alep s’inscrit dans la volonté du régime d’Assad et de ses alliés, russe et iranien, de bénéficier d’un fait accompli lors de l’entrée en fonction du nouveau président à Washington le 20 janvier 2017. Le problème des États occidentaux, voire de certaines forces de gauche, dans leur politique dite « réaliste », est de penser qu’on peut réussir à se débarrasser de Daech et de ses semblables, considérés comme ennemis principaux en Syrie et ailleurs, avec les mêmes éléments qui ont nourri leur développement : soit l’appui au maintien de régimes ou de groupes autoritaires et confessionnels, soit le soutien apporté à des politiques néolibérales et des interventions militaires…
Or il ne suffit pas de mettre fin militairement aux capacités de nuisance de Daech et consorts, au risque de les voir réapparaître à l’avenir comme ce fut le cas dans le passé ; il s’agit de s’attaquer aux conditions politiques et socio-économiques qui ont permis leur développement. Il faut se rappeler que Daech, élément fondamental de la contre-révolution, a connu une progression sans précédent à la suite de l’écrasement des mouvements populaires, en se nourrissant de la répression massive perpétrée par les régimes autoritaires d’Assad et consorts, et en attisant les haines religieuses.
L’interventionnisme des États de la région ou au-delà, conjugué aux politiques néolibérales – qui n’ont cessé d’appauvrir les classes populaires – et à la répression des forces démocratiques et syndicales, ont grandement contribué, et contribuent toujours, au développement de Daech. Il s’agit de lutter contre ces éléments, tout en soutenant les mouvements populaires démocratiques et non confessionnels qui, malgré des reculs importants, persistent dans la région, défiant à la fois les régimes autoritaires et les organisations fondamentalistes religieuses.
Nos destins sont liés
Face à la guerre et aux crimes sans fin du régime d’Assad et de ses alliés contre le peuple syrien, face à la volonté croissante des puissants de liquider les aspirations démocratiques de la révolution syrienne, il nous faut réaffirmer notre soutien à la lutte du peuple syrien pour la démocratie, la justice sociale et l’égalité, contre toutes les formes de confessionnalisme et de racisme.
Dans cette perspective, il est aussi crucial de ne pas séparer la lutte pour l’autodétermination des Kurdes de la dynamique de la révolution syrienne. C’est la mobilisation populaire massive de toutes les composantes du peuple syrien qui a contraint le régime d’Assad, durant l’été 2012, à se retirer de certains régions à majorité kurde du nord de la Syrie et à conclure un accord pragmatique et temporaire de non confrontation avec les forces du PYD, n’empêchant néanmoins pas des combats sporadiques entre les deux acteurs, pour concentrer sa répression criminelle sur d’autres régions en révolte. La défaite de la révolution syrienne marquera le retour de l’oppression des populations kurdes sous un régime chauvin et autoritaire qui a toujours affirmé son opposition à toute forme de reconnaissance des droits du peuple kurde en Syrie.
Pour cela, l’urgence absolue est d’arrêter la guerre, qui ne cesse de créer des souffrances terribles, empêche le retour des réfugié·e·s et des déplacé·e·s internes, et ne profite qu’aux forces contre-révolutionnaires issues des deux bords. Il importe également de dénoncer toutes les interventions étrangères qui s’opposent aux aspirations à des changements démocratiques en Syrie, que ce soit sous la forme d’un soutien au régime (Russie, Iran, Hezbollah) ou en se proclamant « amis du peuple syrien» (Arabie Saoudite, Qatar et Turquie). Une nouvelle fois, comme nous l’avons vu, le peuple syrien en lutte pour la liberté et la dignité n’a pas d’amis dans son combat…
De même, nous devons refuser toutes les tentatives, qui se multiplient actuellement, de légitimer à nouveau le régime d’Assad au niveau international, visant à permettre à ce dernier de jouer un rôle dans le futur du pays. En outre, un blanc-seing donné aujourd’hui à Assad et à ses crimes accroîtrait immanquablement le sentiment d’impunité des États autoritaires, de la région et d’ailleurs, leur permettant d’écraser à leur tour leurs populations si celles-ci venaient à se révolter.
Il nous faut donc réaffirmer notre solidarité avec les forces démocratiques et progressistes qui luttent contre le régime criminel d’Assad et les forces fondamentalistes religieuses, tout en exigeant des protections pour les civils.
Dans cette perspective, il est urgent de renforcer toutes les mobilisations qui, à travers le monde, visent à recréer une véritable solidarité internationaliste et progressiste, dénoncent toutes les puissances impérialistes internationales et régionales sans exception, ennemies des peuples en luttes, tout en s’opposant aux politiques néolibérales, sécuritaires et racistes, en particulier les politiques criminelles de fermeture des frontières des États européens qui ont transformé la Méditerranée en vaste cimetière pour les personnes fuyant les guerres, les dictatures et la misère.
Ici, là-bas : inexorablement, nos destins sont liés…
Illustration : photo by Haleem Kawa. Source: Haleem Kawa Facebook page. Link: bit.ly/2hTlXzc. Traduction : « Aime moi, loin de la terre d’oppression et de frustration … loin de notre ville qui a eu assez de mort » Alep assiégé, dernier jour, 15/12/2016″.
23 décembre 2016- Contretemps
Notes:
[1] Voir : http://rudaw.net/english/middleeast/syria/221220161.
[2] Voir : http://www.almodon.com/arabworld/2016/12/19/إحراق-حافلات-الفوعة-وكفريا-الفاعلون-جند-الأقصى.
[3] Voir https://godottoldus.wordpress.com/2016/12/15/quick-notes-on-the-doomsday-of-aleppo/#more-248; http://www.mei.edu/content/at/under-pressure-syrias-rebels-face-al-nusra-quandary; http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-combatants-factb-idUSKBN14124R ; https://syriafreedomforever.wordpress.com/2016/12/12/conference-debat-avec-brita-hagi-hasan-president-du-conseil-local-dalep-est/ http://syriadirect.org/news/rebels-surrender-east-aleppo-evacuations-begin/ http://www.noria-research.com/wp-content/uploads/2016/10/pdf-Noria-Legrand-sept-2016_FR.pdf
[4] Voir : http://www.syriahr.com/en/?p=57538.
[5] Voir http://orientxxi.info/magazine/comment-s-organise-la-population-d-alep,1607; http://carnegieendowment.org/files/syrian_state1.pdf ; https://www.facebook.com/TheLocalCouncilOfAleppoCity/.
[6] Voir : http://www.vox.com/world/2016/9/22/13000276/assad-putin-bombing-syrian-hospitals-aleppo.
-
L’Egypte de Sissi se plie devant Israel, cette fois sur ordre de Trump (Anti-k)

Titre original, peu explicite: « Le Caire accepte le report d’un vote à l’ONU ».
L’Egypte plie après une intervention de Donald Trump auprès d’Abdel Fattah al-Sissi. Israël a eu des contacts avec l’équipe de transition du président étasunien élu.
Le gouvernement israélien a demandé à Donald Trump d’intervenir: Washington semblait jeudi sur le point de s’abstenir sur le projet de résolution qui réclame l’arrêt des implantations juives présenté par l’Egypte au Conseil de sécurité de l’ONU.Selon un haut responsable israélien, les autorités israéliennes ont contacté l’équipe de transition mise en place par le futur président des Etats-Unis lorsqu’il est apparu qu’elles ne pourraient pas convaincre l’administration Obama de poser son veto au projet égyptien.
Lors de ce contact «à haut niveau», les Israéliens ont demandé l’intervention de Donald Trump, qui succédera à Barack Obama à la Maison Blanche le 20 janvier prochain.D’après deux diplomates occidentaux, Obama, qui avait opté pour un veto en février 2011 sur un projet de résolution similaire, était cette fois décidé à s’abstenir. Dans les faits, Washington aurait ainsi permis l’adoption du texte par les 14 autres Etats membres du Conseil. Pour les Israéliens, a poursuivi ce haut responsable israélien, cette abstention américaine aurait constitué une «violation de son engagement fondamental à protéger Israël à l’ONU».Le gouvernement israélien, a ajouté cette source, est convaincu que l’administration Obama, qui entretient des relations difficiles avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avait programmé de longue date cette abstention et s’est coordonnée avec la partie palestinienne.
Affaire pas terminée
L’Egypte a finalement décidé de repousser la mise aux voix de son projet. Elle a indiqué vendredi avoir accepté que le vote d’un projet de résolution à l’ONU soit reporté après une intervention du président américain élu Donald Trump auprès d’Abdel Fattah al-Sissi.La présidence égyptienne a parallèlement fait savoir que Donald Trump et Abdel Fattah al Sissi s’étaient entretenus par téléphone. «Les présidents sont convenus de l’importance de donner à la nouvelle administration américaine toutes les chances de traiter toutes les dimensions du dossier palestinien dans l’optique de parvenir à un accord total et définitif», a dit un porte-parole du président égyptien.
Le retournement du président égyptien a surpris mais il fait suite à de nombreuses preuves d’admiration pour M. Trump de la part de M. Sissi. Cet ancien officier de l’armée avait renversé son prédécesseur islamiste en 2013, un acte condamné par l’actuel président Barack Obama.Pour autant, l’affaire n’est peut-être pas terminée: quatre autres membres du Conseil de sécurité se sont dits prêts à déposer eux-mêmes le projet de résolution en cas de refus de l’Egypte. Les ambassadeurs arabes se sont eux réunis en urgence à l’ONU. L’ambassadeur palestinien, Riyad Mansour, a estimé que M. Trump «agissait au nom de Netanyahu».
Vendredi 23 décembre 2016 Le Courrier/ATS
-
« La chute d’Alep, c’est la victoire de la propagande complotiste » par Marie Peltier (Souria Houria)
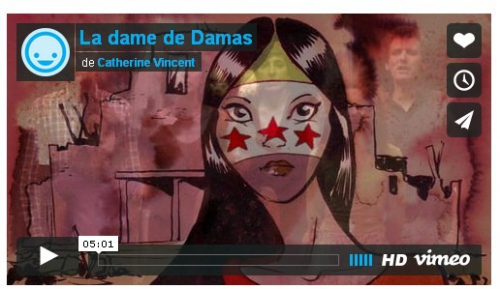
A l’heure où le régime d’Assad et son allié russe sont en train de liquider l’opposition syrienne, c’est un récit des événements falsifié qui est en train de l’emporter, estime l’historienne Marie Peltier.
L’un des enjeux principaux du débat public actuel réside dans la capacité à offrir un récit porteur à la fois de sens, d’éthique et d’un rapport aux faits ajusté. Dans un contexte où les marqueurs symboliques et géopolitiques qui avaient structuré l’imaginaire collectif depuis plusieurs décennies sont en train de basculer, nous observons l’offensive d’une narration de substitution portée par des acteurs politiques identifiés à travers la scène internationale. Ce récit prétendument alternatif est au service de nouveaux rapports d’oppression et met en danger nos libertés.
La modification des rapports de force à la faveur d’un récit falsifié peut s’observer à l’aune de récents événements lourdement chargés symboliquement. Il en est ainsi de la chute d’Alep, fait politique dont on n’a sans doute pas encore pris la mesure du caractère majeur et fondateur, tant dans le débat public, ici, que sur le plan de la reconfiguration politique dont il est à l’origine, au Proche-Orient et à l’échelle internationale.
Symbole d’une débâcle sur un plan éthique – l’Europe et les Etats-Unis ayant, par leur désengagement, accordé de facto un blanc-seing au régime Assad et à ses alliés. Triomphe aussi sur le plan de la propagande et de la confusion. Au moment où les civils d’Alep-Est, massacrés à grande échelle par les pouvoirs de Damas et Moscou, tentent de fuir les bombardements aveugles, une narration d’inversion des réalités semble à certains égards l’emporter.
L’ère du désaveu
Depuis plusieurs décennies, ce qui avait structuré le débat public trouvait ses racines profondes dans la mémoire de la seconde guerre mondiale. Le rapport à l’oppression, aux faits, aux valeurs restait calqué sur ce qui avait permis de mettre fin à la barbarie nazie. Nos imaginaires restaient cernés par les contours historiques et politiques de ce conflit auquel nous étions décidés à ne « plus jamais » revenir. La guerre froide avait même « réussi » à consolider ce socle commun. Le maintien d’un ennemi identifié dans l’imaginaire collectif, s’il n’était pas sans dévoiements et sans compromissions, avait en un sens permis de protéger un positionnement presque « naturellement » antifasciste.
La rupture originelle ayant ouvert la phase que nous traversons actuellement s’ancre dans le traumatisme qu’a suscité dans nos imaginaires le 11 septembre 2001. Cet événement mis en avant politiquement et médiatiquement pour scénariser à l’échelle internationale une confrontation à tournure « civilisationnelle » a progressivement modifié la structuration du débat public. Les interventions américaines en Irak et en Afghanistan, les politiques sécuritaires au sein même de nos sociétés, la focalisation à la fois sur le « problème musulman » et en miroir sur les dérives de l’Occident, tout cela a progressivement ouvert une nouvelle ère : celle du désaveu.
Un désaveu citoyen de plus en plus grand à l’égard de la parole publique, perçue comme mensongère et mise au service de l’oppression. A l’échelle historique, un des cristallisateurs de cette rupture de confiance est sans conteste la vague de manifestations massives de mars 2003 contre la volonté de l’administration Bush de mener l’offensive en Irak. Une interpellation citoyenne qui non seulement a été vouée au mépris mais qui, de surcroît, n’a pas suffi à contrer le mensonge du président américain et la fable des armes de destruction massive. Double trahison : les citoyens n’ont pas été entendus et ont pu avoir la preuve tangible qu’« on » les avait dupés.
Une double haine a été réactivée : celle du musulman, celle du juif
C’est sur cette défiance, devenue pour beaucoup de nos concitoyens véritable « horizon », que certains acteurs politiques ont réussi à surfer pour offrir un narratif de la revanche : Vladimir Poutine en tête, Bachar Al-Assad aussi de manière centrale au Proche-Orient. Pourfendant en bloc « médias » et « politiques » occidentaux, les rendant symboliquement responsables de ce discrédit, surfant parallèlement sur l’obsession désormais centrale en Occident à l’égard de l’islam et de l’islamisme, c’est en fait une narration sous-tendue par une double haine qui a progressivement gagné du terrain, à travers une nébuleuse de sites Internet prétendument « alternatifs » et disant vouloir « révéler la vérité cachée ».
Car c’est bien une double haine, ancienne et profonde dans nos sociétés, qui a été réactivée : la haine du musulman, venant elle-même se calquer sur l’histoire du colonialisme et sur sa mémoire non réglée. La haine du juif, venant épouser une position « anti-impérialiste » rendue paradigmatique, régulièrement « obsessionnalisée » à travers la haine d’Israël.
C’est sur ces deux éléments narratifs et sémantiques que la propagande de Vladimir Poutine et de Bachar Al-Assad ont pu faire mouche, rendant possible la débâcle morale et politique que constitue la chute d’Alep.
Présentant les opposants politiques syriens tantôt comme des « islamistes », tantôt comme des « agents de l’Occident », épousant cet imaginaire antisystème qui a désormais le vent en poupe, depuis les Etats-Unis de Donald Trump jusqu’en Europe et en France, où chaque candidat à la présidentielle cherche à se présenter comme candidat antisystème, privilégiant par ailleurs une lecture exclusivement géopolitique des conflits, gommant les humains et leurs luttes à la faveur d’un discours dépolitisant qui ne voit plus que « gaz » et « pétrole » – même là où il n’y en a pas –, des régimes autoritaires et liberticides ont pu imposer leur propre récit. Un récit se nourrissant de la terreur, de la confusion, de l’inversion des réalités et d’une lâcheté désormais largement partagée.
La chute de notre propre récit
A cette lumière, la chute d’Alep est aussi la chute d’un héritage : celui du narratif des libertés. Elle est la chute de notre propre récit, que nous avons laissé gagner par la propagande d’acteurs extra-occidentaux dont les porte-voix sont désormais de plus en plus nombreux à l’intérieur même de nos sociétés, qu’ils prétendent pourfendre ou « restaurer ». A l’ère du désaveu a désormais succédé celle de la falsification des faits. Celle de la réactivation de haines et de douleurs anciennes. Celle de l’évacuation de la question morale face à l’oppression.
Si nous voulons barrer la route à cette ère de la propagande et de la confusion, nous devons appréhender la chute d’Alep comme un marqueur. Central, inexorable, implacable. Saurons-nous remobiliser la lutte pour les droits humains – ceux-là même que nous brandissons comme un ADN depuis plusieurs décennies ? Saurons-nous quitter cette posture du « doute systématique » qui a substitué l’hypercritique déshumanisante à un sain questionnement sur les faits et les sources ? Saurons-nous relever Alep ?
Car c’est de nos libertés qu’il est question. Et de nos droits. Et de nos vies. De manière tangible, concrète, imminente. Et pour plusieurs générations.
Marie Peltier est l’auteure de L’Ere du complotisme. La maladie d’une société fracturée (Editions Les Petits Matins, 144 p., 16 euros)
LE MONDE 14.12.2016 Marie Peltier (Historienne, chercheuse et enseignante à l’Institut de pédagogie de Bruxelles)
Souria Houria le 22 décembre 2016
-
Laïcité Algérie (PST Constantine)

-
Paris Alep



