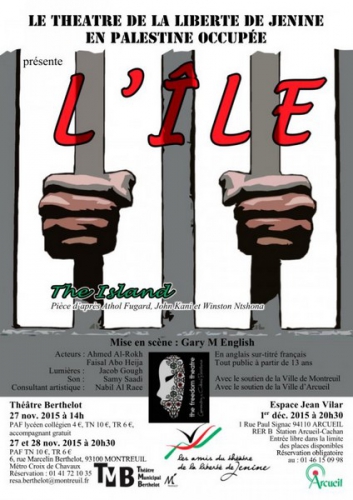En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.






C’est d’une rencontre hasardeuse en 2009 entre Anna Roussillon et Farraj, paysan de la vallée du Nil, près de Louxor, qu’est née chez la réalisatrice –- qui a grandi en Égypte et en parle la langue —, l’idée d’un documentaire sur la vie dans son petit village de Haute-Égypte. Puis, en janvier 2011, survient la révolution, qui impose un remaniement du scénario. Dès lors, c’est la perception des événements par Farraj et son entourage qui deviendra l’ossature du film, à travers le quotidien des habitants du village.
Dans Je suis le peuple, si les lieux de la révolution ne constituent pas la scène de l’action, cette dernière n’en demeure pas moins l’arrière-plan omniprésent dans le monde où évolue Farraj. Dans sa maison, Anna filme Marwa et sa mère, Harrajaya, alors qu’elles sont en train de préparer le pain autour d’un four traditionnel. « Que ceux qui veulent se faire cramer viennent dans notre four ! », dit la fille à sa mère. Car l’immolation par le feu devant le Parlement fait des adeptes en ce début de l’année 20111. L’onde de choc créée par l’immolation de Mohamed Bouazizi en Tunisie est arrivée en Égypte. La scène est filmée à ce moment-là. Anna est alors en Égypte, d’où elle partira le 27 janvier 2011 pour Paris.
Le film comporte plusieurs séquences à des moments différents. D’abord, la période pré-révolutionnaire. On assiste à des discussions anodines sur les difficultés liées à l’irrigation de la terre, on suit une balade en calèche avec Farraj. Cette première séquence ne présage en rien la révolution qui va suivre et les débats qu’elle suscitera deviendront l’objet principal du film. Les autres séquences ont été filmées successivement à l’été 2011, puis au printemps 2012, à l’hiver 2012 et enfin à l’été 2013. Chacune d’entre elles est liée à des événements politiques, révolutionnaires ou électoraux, qui ont à chaque fois suscité de vifs débats dans la société égyptienne.
La révolution fait irruption dans le film à la onzième minute. Soudain, des images sont retransmises, diffusées à l’écran depuis la place Tahrir au Caire, probablement celles de la fameuse « bataille des chameaux » du 2 février 20112. On entend Anna Roussillon fredonner en tentant de capter une communication par Skype, « Putain, je suis partie la veille de la révolution, mais je rêve, je ne sais pas comment je vais m’en remettre ». Et à l’autre bout, la voix de Farraj, sceptique et moqueur, déconseillant presque à Anna — qui veut voir et vivre la révolution — de venir en Égypte et lui suggérant de la regarder plutôt comme lui, à la télévision. À son retour, en Égypte, au mois de mars 2011, Anna ne vivra pas la révolution au Caire depuis la place Tahrir. Elle retournera dans le village de Farraj, car sa décision est prise : elle filmera de là-bas les événements au prisme de la lecture qu’en font les villageois.
C’est donc avec Farraj que le spectateur est amené à percevoir ce qui se passe en Égypte au cours de cet événement révolutionnaire et de ses évolutions au cours des deux années qui précèdent au fameux discours de « mandat » du maréchal Abdel Fattah Al-Sissi de l’été 20133 sur lequel le film se termine. Farraj se place en commentateur des événements, et Anna Roussillon nous fait suivre comment cette révolution lointaine, vue du village d’Al-Jezira d’où il est originaire, s’invite dans le quotidien des habitants et devient même leur sujet de discussion quotidien. Les avis diffèrent, entre l’entourage de Farraj, sa femme et sa fille, sa voisine Bataa, ses collaborateurs et amis ; mais ils s’expriment dans une ambiance de complicité mélangeant le sérieux et la rigolade.
Ce premier documentaire long métrage d’Anna Roussillon reprend le nom de la chanson d’Oum Kalthoum diffusée en boucle sur la chaîne Al-Jazira pendant les premières journées révolutionnaires. Il met l’accent sur « le peuple qui veut », cet acteur-clé né de la révolution dont Farraj fait partie. Avec lui, le film nous montre le contraste inhérent entre une révolution faite au nom d’un peuple, de sa liberté, de sa dignité, de la justice sociale, et la vie de ce paysan qui n’a à aucun moment fait partie des débats houleux qui ont entouré l’événement révolutionnaire, tant la lutte pour le partage du pouvoir a eu tendance à marginaliser toute discussion d’ordre social.
Avec Farraj et les habitants du village, nous partageons pour un temps le quotidien des Égyptiens obligés de recourir à la débrouille et à l’informel pour pouvoir arrondir des fins de mois souvent difficiles, leurs difficultés pour faire démarrer la pompe à eau qui permet d’irriguer leurs terres, les négociations houleuses des femmes pour s’octroyer une bouteille de gaz très souvent en crise de livraison…
La révolution se passe en ville, pas au village. À Louxor, dans les premiers moments révolutionnaires, une seule manifestation a eu lieu en soutien à Hosni Moubarak. Mais elle s’impose dans les discussions politiques au village. Elle est omniprésente par la télévision et grâce aux chaînes satellitaires qui diffusent en direct tous les événements depuis la place Tahrir. On voit l’évolution du débat politique avec Farraj, influencé en quelque sorte par l’arrivée de la parabole qu’il s’offre pendant l’été 2011 pour pouvoir justement capter les images et les sons du Caire. Ce sont d’ailleurs ces images incessantes d’affrontements et de violence exercée par les forces de maintien de l’ordre sous la direction du Conseil suprême des forces armées (connu sous l’acronyme SCAF pour Supreme Council of the Armed Forces) et la présidence de Mohamed Morsi. Mais à travers cet écran, on voit aussi Farraj interagir avec les événements institutionnels et débattre autour de la Constitution, autour des élections4.
Ce documentaire est construit sur deux cheminements qui se croisent : celui de la réalisatrice Anna Roussillon et celui de Farraj, qui regardent tous deux la révolution avec le même média d’information, à savoir la télévision. De la part de la réalisatrice qui a grandi en Égypte, c’est sans doute un engagement, une façon de participer aux événements : présenter la révolution et le récit qu’en fait Farraj devient une forme de sa propre implication. La trajectoire de Farraj est l’initiation à la politique d’une personne au départ sceptique face aux événements, quelqu’un qui éprouve de plus en plus d’intérêt pour la chose publique, sans qu’à aucun moment un quelconque agent institutionnel ne l’interpelle ou ne l’y invite.
Le film se finit sur un moment crucial, celui où l’Égypte se scinde suite aux événements du 30 juin, avec le début du discours du maréchal Abdel Fattah Al-Sissi qui demande au peuple de descendre dans la rue pour lui donner un mandat ’’pour lutter contre la violence et le terrorisme des Frères musulmans5’’. Nous n’entendrons pas la fin du discours puisqu’une double fin s’installe, celle de la coupure d’électricité qui fait taire la parole du général, et celle du film qui s’arrête dans le noir de la chambre de Farraj.
Cette fin forte du film scelle une ère d’effervescence et — encore — d’optimisme révolutionnaires, mais nous laisse justement sur notre faim : comment Farraj, son entourage et son village ont-ils réagi ? Il nous reste à imaginer les discussions auxquelles on aurait pu assister…
1Inspirés par Mohamed Bouazizi en Tunisie, des cas similaires d’immolations par le feu de citoyens égyptiens commencent à se produire dès le 17 janvier 2011 devant le Parlement.
2Le 2 février 2011, les manifestants anti-Moubarak occupant la place Tahrir sont l’objet d’une attaque d’abord par des hommes de main, à dos de chameaux et de chevaux, d’où la célèbre appellation de cette journée de la « bataille des chameaux », mais celle-ci en réalité dure 16 heures, avec une inertie et une inaction totales des militaires. Elle représente ainsi l’une des journées marquantes des 18 jours qui mènent vers la destitution de Hosni Moubarak.
3Le 21 juillet 2013, Abdel Fattah Al-Sissi, encore ministre de la défense, appelle les citoyens égyptiens à manifester pour lui procurer un mandat afin de mener un combat contre la violence et en prévention du terrorisme. Il est à noter que ce mandat renvoie à une volonté de légitimation de la répression des sit-in organisés par les Frères musulmans contre la destitution de Mohamed Morsi et qui se soldent le 14 août par le meurtre de plusieurs centaines de personnes sur la place Rabaa al-Adawiya.
4Dans le film, Farraj débat de plusieurs moments : l’élection présidentielle de l’été 2012 qui amène Mohamed Morsi au pouvoir ; le coup de force constitutionnel entre Morsi et l’opposition en décembre 2013.
5Voir note 3.

Il est de tradition, en occident, de fêter le nouvel an le 1er janvier.
Ce nʼest pas le cas de tous les peuples. En Bretagne et dans lʼancien monde celte, la « Samain » était fêtée le 1er novembre, correspondant au premier jour dʼun nouveau cycle des saisons (comme la Toussaint). Pour les Imazighen, le nouvel an est le 12 janvier et sʼappelle « Yennayer » (janvier).
Yennayer est fêté pour deux raisons. La première est culturelle : le 12 janvier est le premier jour du calendrier julien, calendrier agraire, et signifie, après lʼhiver, le renouveau, et donc la reprise de lʼactivité dans la société rurale traditionnelle. Lʼautre raison est plus politique : dans les années 1970, le mouvement berbère de Paris a choisi, pour se démarquer de lʼère chrétienne et de lʼère musulmane, un fait historique pour faire débuter le calendrier berbère. En 950 avant J.-C., le roi berbère Chacnaq (Scheshong 1er) aurait renversé le pharaon, créant ainsi « lʼère Scheshong ». Ainsi, le 12 janvier, les Iamzighen célébreront le nouvel an 2966 !
Contrairement à ce quʼaffirmait Nicolas Sarkozy à Dakar, lʼhomme africain du nord (berbère donc) est entré « depuis longtemps dans lʼhistoire » : 950 ans dʼavance, cʼest beaucoup ! Cʼest pourquoi le caricaturiste Dilem remarquait avec humour le 12 janvier 1995 que la « grève du cartable » (boycott de lʼécole algérienne arabisante par le MCB, mouvement culturel berbère, en Kabylie pendant 7 mois) nʼétait pas pénalisante car les élèves avaient 650 ans dʼavance…
Yennayer est célébré dans les familles là-bas et ici et donne lieu à des événements festifs. En Kabylie, de fait, cʼest un jour férié. LʼAssociation culturelle des Berbères de Bretagne (ACBB) le célèbre à Rennes chaque année autour dʼun couscous festif. Lʼan dernier, le thème était lʼamitié berbero-bretonne (événement que nous relations dans Le Peuple breton de février 2015). Cette année (le 16 janvier), le thème sera « hommage à Matoub Lounès ». Lʼassociation, qui fête ses 20 ans, a en effet eu comme parrain Matoub Lounès lors de la venue du chanteur kabyle à Rennes le 31 mai 1995. LʼACBB a demandé à la mairie de Rennes de baptiser une rue en hommage à ce chanteur dont lʼassassinat avait tant ému.
Les valeurs défendues par Matoub Lounès dans ses poèmes et chansons (tolérance, laïcité, fraternité, culture, liberté, résistance) sont, ô combien dʼactualité. Yennayer est ouvert à tous, vous pouvez vous y inscrire sur le site acbbretagne.org
Assegwas amegas 2966 !

Que la prostitution soit pratique courante dans un pays où la sexualité est fortement encadrée par une morale religieuse et sociale des plus obtuses et hypocrites, pour toute personne ayant vécu au Maroc est une évidence.
Dès leur plus jeune âge, les filles mais aussi les garçons issuEs des classes les plus pauvres n’ont que ce seul recours pour subsister… pour le plus grand plaisir d’une masse d’hommes qui en profitent plus que couramment !!!
Mais qu’un film ose mettre sur la place publique – et internationale, qui plus est ! – la réalité marocaine dans ce domaine et tous les démons machistes se déchaînent. Loubda Abidar, l’actrice qui joue le rôle de l’une des prostituées du film Much loved , de Nabil Ayouch, l’a appris à ses dépens.
Dans une lettre ouverte, publiée par Le Monde , en date du 12/11/2015, elle dénonce la censure conservatrice de l’État : le film a été interdit “avant même que la production demande l’autorisation, de le diffuser”[par]“un ministre qui ne [l’] avait même pas vu”, dit-elle.
Alors, prolifèrent sur les réseaux sociaux insultes et menaces – orchestrées par les forces réactionnaires du pays – qui l’amènent à se cloîtrer chez elle puis à sortir en burka et qui se terminent par une folie barbare de jeunes en goguette qui la forcent à monter dans leur voiture. Quoi de plus héroïque que d’enlever, rouer de coups de pieds au visage et sur tout le corps une “sale pute” de ciné ? Quoi de plus glorieux que des policiers qui se moquent de la victime lorsqu’elle veut porter plainte et qui – après publication de sa lettre ouverte – portent plainte pour diffamation ?
Loubda Abidar n’est pas seulement une “sale pute”, c’est aussi une mauvaise Marocaine : elle a quitté son pays pour s’installer en France. À croire que ce pays dont le roi a voulu, dès 2003, donner aux femmes un statut personnel plus progressiste que celui de la plupart des pays musulmans est rattrapé par les forces conservatrices les plus arriérées, à l’instar de certains autres royaumes proches-orientaux !
Eliane Paul-Di Vincenzo mardi 22 décembre 2015





Pour la première fois, un rapport* de l’Organisation internationale du travail étudie les spécificités de la fuite des cerveaux dans les pays du Maghreb. Qui part et pourquoi faire ? El Watan Week-End a décortiqué le rapport pour vous.
Le sociologue du Cread, Karim Khaled, rappelle que l’immigration des compétences algériennes existe depuis 1830 et peut être divisée en quatre périodes. La dernière période qui commence dans les années 1990 est celle de la désillusion, selon lui. Il estime que les intellectuels ont vécu une crise, notamment liée à la «déception» des élites après avoir été «emballées et prisonnières par le discours développementiste des années 1970» ainsi qu’aux «échecs» des luttes politiques des années 1980, 90 et 2000 qui «n’ont pas pu basculer l’équilibre des formes identitaires idéologiques dominantes depuis l’indépendance».
Pour les universitaires, «l’emprise du politique dominant» a fait de l’université «une institution anomique incapable de se reproduire d’une manière autonome et reste aliénée par rapport à sa propre histoire et à l’histoire de tout son environnement». Selon lui, malgré toutes les politiques de formation à l’étranger et les multiples reformes, «l’enseignement supérieur algérien ne peut être que producteur de foyers migratoires». Cette période se caractérise par une forte concentration de l’intelligentsia algérienne dans les pays du Golfe et dans l’espace de la francophonie, notamment la France et le Canada.
«Des destinations dans un contexte mondialisé, où des voies nouvelles se présentent aux élites professionnelles algériennes. Il s’agit vraiment d’une nouvelle ère de circulation internationale accélérée par l’avènement des technologies de l’information et de la communication mais avec des reconfigurations et le retour du ‘‘pouvoir de l’identité’’ comme forme de résistance au rythme imposé aux déclassés dans cette révolution numérique», explique le sociologue. Malgré cette diversification dans les destinations des élites intellectuelles algériennes dans les années 2000, la France reste toujours la destination dominante pour des raisons historiques, familiales et linguistiques.
Au-delà du sentiment de désillusion, le rapport énumère plusieurs facteurs importants de départ : d’abord, les limites d’une carrière professionnelle ou universitaire et les besoins de recherche dans des domaines scientifiques, techniques et technologiques de pointe expliquent en grande partie les départs continus de cadres et d’étudiants à l’étranger. Ensuite, outre le prestige et le rayonnement dans la société, les diplômes d’universités étrangères offrent plus de chance de recrutement à l’international.
Les lourdeurs administratives, les blocages bureaucratiques, les difficultés socioéconomiques et les limites d’épanouissement culturel motivent également le départ de cadres et d’universitaires. Le taux de chômage très important des diplômés du supérieur, le souci d’assurer un meilleur avenir à ses enfants et les raisons sécuritaires sont enfin d’autres facteurs importants dans le départ.
Ceux qui quittent l’Algérie ont en majorité entre 25 et 45 ans. Les docteurs en santé représentent la plus grande part des effectifs des diplômés les plus élevés exerçant en France. Ils se situent presque au même niveau que les ingénieurs. Ensuite viennent les personnes ayant obtenu un DESS et un master professionnel puis les DEA et masters.
Ces diplômés sont pour la plupart en activité dans leur pays d’accueil. Ils connaissent certes le chômage, mais nettement moins que ceux qui n’ont pas de formation universitaire. Ils occupent pour la majorité des postes d’emploi dans des professions libérales et intellectuelles. Plus de la moitié des immigrés algériens qualifiés avait un contrat de travail à durée indéterminée, 11% exerçaient des professions libérales et 9,2% étaient au chômage.
On constate que 34% d’Algériens installés en France sont des cadres ou exercent des professions intellectuelles, contre 14% qui sont des «employés». On observe aussi un niveau assez faible de «brain waste» - soit à travers des emplois n’exigeant pas de niveau supérieur ou alors ils sont sous-employés avec une faible rémunération. 6% d’immigrés faisant le métier d’ouvrier.
Il y a aussi le «brain waste» relatif, non mesurable encore, c’est la situation qui équivaut à la déqualification des diplômés, en les affectant à des postes de niveau inférieur à leurs qualifications. Le niveau des salaires peut être un indicateur : 35% des personnes perçoivent moins de 1500 euros par mois, 25% entre 1500 et 2500 euros et puis 37% gagnent plus de 2500 euros.
«L’Algérie n’est pas en situation de pénurie de médecins, elle a formé et forme encore un nombre important de praticiens», explique Ahcène Zehnati, chercheur au Cread. Le nombre de diplômés en médecine a plus que doublé entre 2001 et 2011, il passe de 1714 à 4023. Même chose pour les médecins spécialistes qui sont 897 en 2005 et 1929 en 2013. 11 629 médecins sont formés dans les spécialités médicales et chirurgicales entre 2005 et 2013.
A titre de comparaison, la Tunisie forme 8 fois moins de généralistes et 4 fois moins de spécialistes que l’Algérie. Cette amélioration de la formation ne concerne cependant pas le personnel paramédical, puisque le rapport entre le nombre de personnel paramédical et les médecins a baissé : Il passe de 3,4 en 1998 à 2,47 en 2012. Pourtant, les médecins constituent la première catégories d’Algériens nés en Algérie et exerçant à l’étranger. Le taux de fuite est supérieur à ceux enregistrés en Afrique du Sud ou au Ghana, par exemple et le nombre de médecins qui quittent l’Algérie augmente constamment depuis 1997. «La destination privilégiée des médecins algériens reste majoritairement la France pour des raisons historiques, culturelles, système de formation, conventions inter-universitaires», rappelle le rapport.
Près d’un médecin né en Algérie sur 4 exerce, en effet, en France. Les effectifs de médecins spécialistes ne sont pas touchés de la même manière. Pour les médecins nés en Algérie, quel que soit leur lieu de formation, le «taux de fuite» est de 43% pour la psychiatrie. Viennent ensuite l’ophtalmologie, la radiologie et l’anesthésie-réanimation. Pour les médecins nés et formés en Algérie, les taux sont moins importants, mais les spécialités les plus concernées sont là aussi la psychiatrie, la radiologie, l’ophtalmologie et l’anesthésie-réanimation. De manière générale, les médecins qui travaillent dans le secteur public sont plus touchés par le départ que ceux du privé.
Le rapport ne présente pas les raisons de départ des médecins, mais estime que les salaires pourraient être l’un des facteurs. En 2013, un médecin non hospitalo-universitaire touchait 77 000 DA par mois pour un généraliste, 110 000 pour un spécialiste. Un maître-assistant dans un CHU est payé 90 500 DA et un professeur 183 000 DA. L’étude souligne que ces salaires sont en moyenne une fois et demie plus élevés que les salaires des cadres des entreprises nationales algériennes.
Les migrations intellectuelles marocaines remontent au XIXe siècle et elles sont aujourd’hui souvent le fait d’élites intellectuelles, de chercheurs ou d’étudiants et de sportifs, avec un taux de retour faible. «Malgré le développement de nouvelles destinations, comme c’est le cas pour la Belgique, le Canada, les Etats-Unis ou les pays de l’ancien bloc de l’Est, la France draine toujours le plus grand nombre d’étudiants marocains», rappelle le rapport. Ils représentent la première population estudiantine étrangère dans les universités françaises avec plus de 15% en 2004. A titre de comparaison, les Algériens représentent 8,5%.
Aujourd’hui, l’arabisation, la suspension des bourses du gouvernement et les conditions d’inscription plus difficiles ont fait diminuer le nombre de départs, qui reste malgré tout important. Désormais, on part pour préparer un troisième cycle plus que pour faire des études de premier et deuxième cycles. Dans tous les cas, une partie des étudiants à l’étranger, une fois leur cursus universitaire achevé, demeure sur place, pour des raisons familiales ou professionnelles.
Les meilleurs sont repérés dans les grandes écoles ou laboratoires et sollicités pour intégrer des emplois, parfois même avant l’obtention de leur diplôme. Les autorités ont tenté dans les années 1990 de limiter cette immigration avec des mesures restrictives. Aujourd’hui, l’Etat tente au contraire de structurer la diaspora scientifique marocaine pour favoriser le retour et la collaboration des élites installées à l’étranger avec le Maroc.
Plus de 70 000 diplômés mauritaniens vivent aujourd’hui à l’étranger, toutes spécialités confondues. Dans un pays où le taux de chômage officiel est de 10% et où le salaire des fonctionnaires, l’équivalent de 5000 DA par mois, n’attire pas les diplômés, plus de la moitié des diplômés mauritaniens à l’étranger finissent par s’installer temporairement ou définitivement dans leur pays d’accueil. La plupart d’ente eux sont des ingénieurs, scientifiques, universitaires, financiers, qui ont souvent accès à l’étranger à des emplois de haut niveau, notamment dans des organisations internationales, des universités ou des compagnies privées.
Le départ des diplômés a été poussé par les crises politiques de 1987 avec le Front Polisario et 1989 avec le Sénégal, ainsi que par le plan d’ajustement structurel des années 1980. Le pays octroie des bourses aux étudiants mauritaniens qui veulent étudier à l’étranger, dopant implicitement dans le futur la migration des compétences scientifiques, selon le rapport. Ces bourses sont d’ailleurs à l’origine en grande partie de la mise en place de la diaspora scientifique mauritanienne établie à l’étranger.
Traditionnellement, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et les pays d’Afrique de l’Ouest particulièrement le Sénégal, la Côte d’Ivoire constituent les principales destinations des boursiers mauritaniens. Face au nombre de diplômés chômeurs très important, «la plupart des étudiants en fin de cycle- notamment ceux des filières francophones- cherchent des inscriptions dans des universités françaises ou se lancent dans l’aventure aux USA, en Australie ou au Canada».
Leïla Beratto El Watan, 6 novembre 2015
http://www.algeria-watch.org/fr/article/eco/soc/fuite_cerveaux.htm
L’enseignement de tamazight a été élargi, en ce début d’année scolaire, à 22 wilayas. «La généralisation est en cours pour la 23e wilaya, Relizane, avec 8 divisions ouvertes», a annoncé M. Merad, directeur de l’enseignement moyen au ministère de l’Education nationale.
Contrairement à ce qui a été promis par le ministère, concernant l’élargissement de tamazight à la wilaya d’Alger, aucune nouvelle classe ni recrutement n’ont été effectués. Les directions de l’éducation de la capitale n’ont pas mis en place la procédure nécessaire pour la création de sections d’apprentissage de cette langue, contrairement à ce qui s’est réalisé dans les wilayas concernées par l’enseignement.
«Il n’y a pas de blocage», assure M. Merad. Il explique que pour l’ouverture d’une section, la direction de l’éducation fait, au préalable, un état des lieux et soumet clairement le choix aux parents d’élèves en procédant à la collecte des choix favorables exprimés avant d’engager les moyens humains nécessaires.
Or, expliquent des représentants de parents d’élèves de la capitale, «cette procédure n’a jamais été faite au niveau des établissements de la wilaya d’Alger». Le ministère, à travers les directions de l’éducation, est chargé de mener les campagnes de sensibilisation pour l’enseignement de tamazight auprès des élèves.
«Dans les wilayas concernées par l’ouverture des nouvelles classes de tamazight. C’est au mois de février que les démarches ont été entamées pour la création des sections à ouvrir en septembre», explique le directeur de l’enseignement moyen.
Et d’ajouter que le rôle du ministère est «purement pédagogique», c’est-à-dire fournir les enseignants et le manuel scolaire et suivre la matière enseignée conformément à la réglementation. Pour ce responsable, l’enseignement de tamazight doit bénéficier de toute l’attention nécessaire, étant un facteur de cohésion «tout comme les autres constantes nationales».
Dans les cycles primaire et moyen, le secteur compte 1700 enseignants de tamazight. L’enseignement a démarré en 1995 dans 16 wilayas. Le nombre d’élèves est passé de 37 690 en 1995 à 234 690 ces dernières années.
Effraction
Si la langue amazighe peine à trouver son chemin au niveau des écoles d’Alger, c’est à travers les cours d’alphabétisation que les Algérois peuvent enfin apprendre à lire et écrire la langue de Mouloud Mammeri. Les cours de tamazight débuteront, selon le secrétaire général du HCA, aujourd’hui. Trois sections seront mises en place, dont une au niveau du siège du HCA.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire via internet. Une campagne d’affichage est menée par le HCA au niveau des stands du Salon international du livre et sur le site web de la structure. Les cours seront dispensés une fois par semaine, gratuitement. La tablette Azul dotée d’applications d’apprentissage de tamazight sera offerte ainsi que le manuel Aseghmigh pour consolider cet apprentissage.
L’année de formation se déroule de novembre à juin et le cursus sera sanctionné par une attestation de niveau. C’est en partenariat avec l’association algérienne d’alphabétisation Iqraa que l’enseignement de tamazight pour adultes a été lancé, et ce, conformément à la convention-cadre paraphée le 20 avril 2015 à Alger.
S’agissant des enseignants qui accompliront cette mission, le HCA a assuré que des sessions de formation de l’enseignement de cette langue concernera comme première étape, 9 wilayas, à savoir Alger, Oran, Ghardaïa, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira, Sétif et Batna. D’autres wilayas intégreront ce processus au fur et à mesure selon un plan de généralisation couvrant tout le territoire national, ajoute le HCA .